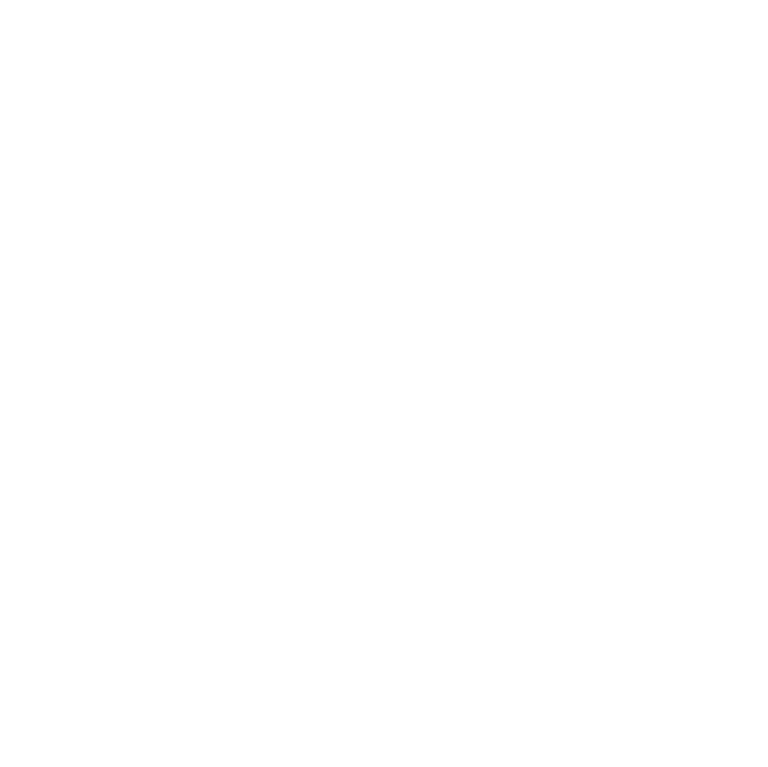Marlhes sous la révolution
Therese-Louise Champagnat et Les Sœurs de Saint-Joseph
F. André Lanfrey – 25/05/2019
Une influence certaine mais difficile à évaluer
Le chapitre 1 de la Vie du P. Champagnat nous apprend que Marcellin enfant a été éduqué par sa mère et sa tante « personne d’une éminente piété et d’une grande vertu […] chassée de son couvent par les hommes qui couvraient alors la France de sang et de ruines ». Le F. Jean-Baptiste ne nous en dira guère plus sur cette tante, sœur de Saint Joseph, née en 1752 et qui ne mourra qu’en 1824.
L’ouvrage récent Les Marlhiens et leurs notaires au XVIII° siècle1nous renseigne sur l’histoire de la communauté des Sœurs de Saint Joseph établie à Marlhes dès 1651 et qui va exister en ce lieu jusque vers 1970. Le F. Gabriel Michel a aussi évoqué l’histoire des sœurs Saint Joseph et leur influence sur nos origines dans l’ouvrage intitulé Pour mieux connaître Marcellin Champagnat 2, qui rassemble des conférences et des articles divers3 . Dans Les années obscures de Marcellin Champagnat4, il avait déjà fait quelques allusions aux sœurs de Saint Joseph. Mon intention est donc de me baser sur ces travaux anciens et nouveaux pour aller un peu plus loin dans la connaissance d’une communauté et surtout d’une tante qui paraissent avoir fortement influencé Marcellin Champagnat.
Les sœurs Saint Joseph à l’aube de la Révolution
Quand il recense les habitants de Marlhes en 1790, le curé Alirot établit la liste des Sœurs de Saint Joseph au bourg. La plupart d’entre elles se retrouveront dans un second recensement, en 18085. La communauté a donc réussi à survivre aux événements révolutionnaires.
|
Recensement Alirot (1790) |
Recensement Alirot de 1808 et Informations complémentaires |
|
Marie-Madeleine Peyrard, 68 ans, supérieure |
Absente en 1808 : probablement décédée |
|
Jeanne Champagnat, 66 ans. |
Grande tante de Marcellin Champagnat. Née le 31 décembre 17226, elle décède à Marlhes. le 16 septembre 1798 |
|
Madeleine Lardon, 64 ans |
Certainement décédée avant le recensement de 1808. |
|
Marie-Anne Berton, 50 ans |
Encore présente en 1808, 68 ans. Dans les actes on lui donne le prénom de Catherine. |
|
Marguerite Frapa, 44 ans |
Encore présente en 1808, 62 ans. |
|
Thérèse Champagnat, 37 ans. Son prénom de baptême est « Louise »7. |
Tante de Marcellin Champagnat. Présente en 1808, 55 ans. Née le 10 décembre 17528. elle décédera le 13 mai 1824 à 72 ans. |
|
Anne-Marie Ravel, 36 ans, |
Encore présente en 1808, 54 ans. |
|
Claudine Tardy, 28 ans |
Absente du recensement de 1808. Décédée ou sorite du couvent. |
|
Marie Frachon, 25 ans, |
Encore présente en 1808, 43 ans. |
En 1808 la communauté connaît un renouveau puisque trois jeunes sœurs figurent dans le recensement : Jeanne-Marie Daneroles (22 ans), Louise (21 ans) et Marie (20 ans) Coupat.
Des Sœurs : pas des religieuses !
En 1790 la maison des sœurs n’est pas à proprement parler un couvent et elles ne sont pas, canoniquement parlant, des religieuses puisqu’elles ne font pas de vœux solennels et ne sont pas cloîtrées, comme dans les ordres religieux classiques qui sont des « communautés régulières ». Elles sont simplement des « sœurs » c’est-à-dire de pieuses filles groupées en « communautés séculières ». Elles n’ont pas de chapelle ni d’aumônier, mais fréquentent l’église paroissiale et sont sous l’autorité du curé. Elles ont certes des temps de prière, mais ne sont pas des contemplatives : elles vivent de leur travail, soignent les malades, instruisent les filles… Comme dit la soeur Marguerite Vacher, leur historienne, elles sont « des régulières dans le siècle »9 c’est-à-dire qu’elles pratiquent un style hybride entre la vie religieuse et la vie laïque. En les nommant « filles rubanières » les notaires ne font que reconnaître leur statut économique même s’ils savent fort bien qu’elles constituent une association religieuse. Elles sont une sorte de couvent-atelier comme il en existera encore tant dans la première partie du XIX° siècle.
N’étant pas des moniales, elles ne sont pas davantage des béates qui sont aussi appelées des « sœurs ». Celles-ci, de milieu plus modeste, rapidement formées au Puy par les Demoiselles de l’Instruction, vivent seules dans une maison dite de l’Assemblée où elles accueillent les jeunes filles de quelques hameaux pour leur enseigner le catéchisme, les prières, la lecture et la rubanerie. Elles assurent aussi des soins aux malades. Les sœurs de Saint Joseph font à peu près la même chose, mais au bourg et en communauté.
En somme, l’espace éducatif pour les filles, et souvent les petits garçons, est réparti en un centre et plusieurs périphéries. Ainsi, dans la paroisse de Marlhes, comme en bien des milieux ruraux, l’éducation des filles est mieux assurée que celle des garçons. En établissant des Frères, Champagnat visera à réduire cette distorsion. Ceci dit, il s’agit d’éducation religieuse et 10 technique plus que d’instruction. En général, chez les sœurs on ne va pas jusqu’à l’enseignement de l’écriture, parce que l’on peut apprendre à lire, chanter des cantiques et réciter catéchisme et prières tout en travaillant de ses mains à la rubanerie. L’écriture est, pour les jeunes filles et les femmes, une technique bien moins utile et rémunératrice que le tissage. Mais à Marlhes les sœurs ont dû aussi initier des filles à l’écriture.
Les dots et les testaments
Pierre Piat auteur de Marlhes et son église. (Marlhes et les Marlhiens p. 128). cite les noms des supérieures successives des Sœurs de Saint Joseph dont Anne Pollet (la 5°), Marie-Madelaine Peyrard (6°) et Marie-Claire Seut (7°). Marie Celle, citée dans certains actes, est décédée le 19/02/1751. En 1753 (p. 88) Anne Pollet et Madelaine Sovignet, probablement la supérieure et l’intendante, « filles rubanières » achètent au bourg de Marlhes, pour 200 livres, un petit jardin de 120 m2. Les deux mêmes sœurs louent le 22/01/1758. à Louis Rivier, journalier, et à son frère Antoine « enterreurs, sonneurs de cloches» et souvent témoins dans les actes paroissiaux11, une chambre, un jardin et un coin de cave. Un acte de 1763 nous apprend l’existence d’un « bois des filles Saint Joseph » (Amis de Marlhes, p. 91) au-dessus du hameau de Brodillon.
Contrairement aux béates issues de milieux très modestes et qui n’ont guère de patrimoine, les Sœurs de Saint Joseph doivent disposer d’une dot dont elles demeurent propriétaires puisque leurs vœux simples n’ont pas de valeur juridique, contrairement aux vœux solennels. La constitution de la dot détermine un âge d’entrée relativement tardif. Si la postulante a moins de 25 ans, elle doit être juridiquement émancipée de l’autorité paternelle (Les Marlhiens et leurs notaires… p. 53…) la majorité matrimoniale étant de 25 ans pour les filles ; 30 ans pour les garçons12. Le fils ou la fille majeur(e) ou émancipé(e) dispose alors d’une partie des biens famiIiaux qu’il (elle) pourra administrer indépendamment. En 1767 Marguerite Frappa (p. 58) 22 ans, sollicite cette émancipation et ses parents lui accordent une dot de 1000 livres payable en 10 fois ainsi que deux habits, linge, literie, garde-robe. Puis « elle a très humblement supplié Anne Paulet et Madelaine Sovignet, filles rubanières de ladite société de Saint Joseph de la recevoir en icelle ». Les conditions d’entrée de Marianne Ravel (Anne-Marie Ravel en 1790) en 1773 (p. 130) sont semblables. La supérieure est alors Marie-Claire Seut. La dot est constituée de 700 livres, deux habits, un lit garni, une garde-robe et seize métans13 de blé-seigle.
En somme la dot est répartie en trois postes : le trousseau, comme pour une mariée ; des ressources en nature ; de l’argent. Nous pouvons supposer que la grande tante et la tante de Marcellin Champagnat ont joui de dots assez semblables lors de leur entrée en communauté. Le F. Avit nous dit (Annales, T. 1 p. 5 § 17) que Jeanne Champagnat aurait donné à son couvent un petit bois de pins encore nommé « la pinée (pinède) Champagnat ». En somme, les Sœurs de Saint Joseph viennent de familles jouissant d’une modeste aisance, même si leur dot ne suffit pas à les entretenir. Nous pouvons supposer qu’Anne Champagnat, née en 1722, est entrée chez les Sœurs entre 1745 et 1750 et que sa nièce Thérèse, née en 1752, l’a fait entre 1775 et 1780.
La communauté n’ayant pas d’existence juridique, chaque sœur de St Joseph reste propriétaire des biens apportés dans la communauté, même si la gestion en est confiée à une responsable. Pour que les biens apportés par les dots restent dans la communauté, chaque sœur lègue à une de ses consoeurs l’essentiel des biens apportés. Ainsi, Catherine Berthon, dans son testament du 10 décembre 1762, donne 10 livres à son père et à sa mère et 5 sols à ses autres parents. Le reste, c’est-à-dire presque tout, va à Anne Pollet ou Magdelaine Sovignet, les responsables de la communauté. Marguerite Frapa semble moins généreuse envers la communauté : le 30 juin 1770 elle lègue 300 livres à son père et autant à sa mère. Le reste va à Madelaine Sovignet ou Anne Pollet ou encore Louize Celle (qui ne figure plus dans la communauté en 1790). Anne Pollet née en 1712 au Creux, qui deviendra supérieure vers 1770, a rédigé son testament en 1756 : elle donne 5 sols à chacun de ses parents ayant droit à succession, c’est-à-dire une somme purement symbolique. Son héritière universelle sera Madelaine Sovignet ou Catherine Chorin. Ainsi, le système dot-testament, qui suppose une grande confiance entre membres de la communauté et une habile gestion, permet une certaine aisance d’autant que la rubanerie apporte des ressources complémentaires.
Les filles rubanières dévotes et les autres
Le lien religieux ne doit pas occulter le fait que les Sœurs de Saint Joseph sont une communauté de « filles rubanières ». Il existe d’ailleurs des communautés de rubanières sans motivation religieuse explicite, dont les Amis de Marlhes (p. 135) nous donnent un exemple. En 1782, Antoinette Petit, Jeanne-Marie Murgue, et Jeanne Boyer qui auront respectivement 50, 43 et 30 ans dans le recensement de 1790, ont décidé de constituer une société partageant travail, gîte et couvert, sans aucune obligation religieuse mentionnée. La société sera dirigée par Antoinette Petit qui accueille les deux autres au bourg dans sa maison. En cas de décès ou mariage de l’une ou l’autre, chacune reprend son indépendance. Comme ces trois associées figurent au recensement de 1790 sans que le curé précise leur métier, il se peut que d’autres communautés de rubanières existent dans la paroisse. En 1808 cette communauté n’existera plus, ce qui n’a rien d’étonnant vu l’âge de deux des sociétaires.
Mais en général la rubanerie est, dans les familles, une ressource d’appoint assurée par les femmes et les grandes filles se préparant au mariage. En 1790, le curé Allirot, mentionne en effet une quinzaine de rubanières, la plupart entre 15 et 25 ans. Le recensement de 1808 ne mentionne que deux rubanières, l’une de 40 ans à La Fayole ; une autre de 24 ans au hameau de La Faye, qui sont peut-être des béates14. Est-ce un signe de crise ou un simple désintérêt du curé ?
Les placements financiers des soeurs
Grâce à la rémunération de leur travail et aux dots, les Sœurs de Saint Joseph, dans un monde économique où l’argent est rare, sont en mesure de prêter des sommes non négligeables tout en s’assurant des rentes solides. Ainsi, le 14 mai 1760 J.B. Champagnat et Marianne Ducros son épouse (grands parents de Marcellin) s’engagent à verser annuellement aux sœurs une rente de 25 livres en raison d’un prêt de 500 livres consenti par Anne Pollet et Madelaine Sovignet « filles associées, rubanières ». Pour obtenir ce prêt ils ont hypothéqué leur domaine du Rozey. Le même jour les deux mêmes sœurs prêtent 200 livres à Jacques Berthon, sabotier. Une semaine après, le 21 mai 1760, elles prêtent 200 livres à Jean Fournel, maitre maçon et sa femme, qui s’engagent à payer une rente de 10 Livres par an. Un mois plus tard, le 22 juin 1760 elles prêtent 800 livres à Barthélemy Ploton marchand de St Genest, probablement contre une rente de 5 % soit 40 Livres.
L’année 1760 a-t-elle été particulièrement faste pour les Sœurs de Saint Joseph ou bien ces prêts rapprochés traduisent-ils une activité plus habituelle ? En tout cas les sœurs n’agissent pas comme des banquières, mais pratiquent des placements sûrs auprès de leurs relations proches tandis que les débiteurs empruntent à un taux raisonnable (5 %) sans risque d’être contraints à des remboursements intempestifs. D’ailleurs, c’est plutôt l’inverse qui se passe (Amis de Marlhes p. 133) : ce n’est qu’en 1766 que Jacques Bayle rembourse les 20 livres d’un prêt consenti en 1725. Et puis les sœurs ont aussi des charges, notamment les droits de succession (p. 160). En 1768 Anne Paulet et Magdelaine Sovignet héritières de leur supérieure Izabeau Lardon et des autres sœurs de Marlhes présentent au fermier (percepteur) du comte de Roussillon une quittance de 30 livres établie en 1741 « pour les droits de demy lods15 de la maison à elles appartenant, scize au lieu de Marlhes, dues par le décès de la sœur Villette » qui paraît avoir été juridiquement la propriétaire de la maison.
Economie et politique en temps de révolution
Evidemment la Révolution perturbera les sœurs de Saint Joseph sur le plan religieux mais aussi –on y pense moins – sur le plan économique. Je vais donc donner un aperçu sommaire de l’évolution politico-économique de ces dix années (1789-1799) extrêmement chaotiques avant de traiter des aspects religieux. Sœurs de Saint Joseph et Béates ne sont pas atteintes par la mise à la disposition de la nation des biens du clergé le 2 novembre 1789. Elles ne le sont pas davantage par l’interdiction des vœux religieux (solennels) le 13 février 1790 qui va provoquer de grandes perturbations dans les couvents. Elles ne le seront qu’indirectement par le vote de la Constitution civile du clergé le 12 juillet, que le pape condamnera le 10 mars 1791. Leur soutien au clergé réfractaire à la Constitution civile leur causera ensuite bien des persécutions. Mais c’est d’abord en tant que « filles rubanières » qu’elles subiront les conséquences de la Révolution. Ainsi dit le F.Gabriel Michel (Les années obscures… p. 64) :
« L’abolition des douanes intérieures (2 novembre 1790), puis celle des octrois16 (1° mai 1791) avait d’abord causé l’euphorie, et la vente des soieries fabriquées en France avait beaucoup progressé. Mais […] dans la séance du 17 novembre 1792, le Conseil municipal de Marlhes évoque les ouvrages de rubans « qui cessent de toutes parts17 ».
La situation s’est durcie à partir du 20 avril, la France révolutionnaire déclarant pratiquement la guerre à l’Europe. Le 10 août 1792 c’est la chute de la royauté, suivie de massacres à Paris et de la proclamation de la république le 21 septembre. Au mois d’août sont supprimées les congrégations séculières et les confréries. Aucune partie de l’enseignement public ne doit être confiée aux maisons des ci-devant congrégations (Françoise Mayeur) . C’est ensuite la montée de la Terreur avec exécution du roi le 21 janvier 1793, guerre civile, réquisitions, dévaluations monétaires, déchristianisation violente, marasme économique, … La Terreur rend dangereux les voyages des marchands qui apportent aux rubanières le fil à tisser et récupèrent le produit fini pour le commercialiser:
« Le 18 septembre 1793, Camille Dugas, rubanier de St. Chamond18 s’était trouvé à St. Genest. La guerre battait déjà son plein et, même s’il faisait valoir 600 métiers dans le village, ce n’était pas un motif suffisant pour se promener. […] Il s’en tire en donnant 200 livres pour manifester son zèle patriotique 19»
Sans être idylliques les années 1795-97 sont politiquement assez calmes. Mais « le début de 1795 est très dur […] et dès la fin de ventôse (mi-mars), le pain fait défaut. Comme il faut trouver du travail pour les gens, des bourgeois comme Fournas20 ou Dugas, marchands de rubans de St. Chamond, obtiennent des passeports pour aller « en Suisse et autres pays conquis par la République, à l’effet d’y exporter les objets de luxe pour échanger, soit contre des objets de première nécessité, soit des matières premières21 ».
La situation économique s’améliorant, le 4 février 1797 l’assignat, dont personne ne veut plus, est remplacé par la monnaie métallique. Mais, les royalistes ayant relevé la tête, le coup d’Etat républicain du 18 Fructidor (4 septembre 1797) instaure une nouvelle terreur révolutionnaire, antiroyaliste et antichrétienne qui peine à imposer sa loi. Et des régions entières, dont celle de Marlhes, vivent en semi-anarchie où cohabitent autorités civiles, bandes royalistes, banditisme, déserteurs et prêtres réfractaires. C’est aussi le désordre économique. Le 24 prairial An VI (12 juin 1798), J.B. Champagnat nous en donne, pour Marlhes, un aperçu remarquablement synthétique :
« Si le recouvrement des impositions est lent, c’est que le numéraire –la monnaie métallique- est rare ; il y a très peu de bois. Depuis trois ans, gelée et grêle ont emporté la récolte ; la fabrication du ruban ne va plus… ».
Ce marasme économique durera jusqu’au coup d’Etat de Bonaparte le 18 Brumaire (9 novembre 1799) qui permettra de rétablir l’autorité de l’Etat, la prospérité économique et la religion catholique, grâce au concordat de 1802.
Prospérité économique des sœurs de Saint Joseph ?
Quelques documents notariés présentés par les Amis de Marlhes nous apprennent que la communauté des sœurs fonctionne toujours et que sa situation financière n’est pas mauvaise puisqu’en juillet 1793 J.B. Courbon22 emprunte à Marguerite Frapa et Catherine Berthon, rubanières, un capital de 3000 livres en assignats23. Le 26 décembre 1795 il veut rembourser la somme totale, augmentée de 150 livres d’intérêts. Mais les sœurs refusent le remboursement car, l’assignat ayant été très dévalué entretemps, elles y perdraient trop. Le 10 février 1798, Courbon proposera de rembourser en monnaie métallique. Mais Marguerite Frapa hésite et nous ne savons ni comment ni quand l’affaire a été résolue.
La communauté des sœurs de Saint Joseph n’a donc pas été entièrement dissoute puisque nous la voyons fonctionner en 1793, 1795, 1798 sous la direction de Marguerite Frappa et Catherine Berthon. Et celles-ci vivent ensemble puisqu’en 1795 et 1798, Courbon, le notaire et deux témoins se rendent « dans le domicile de Marguerite Frappa et Catherine Berthon » pour les persuader d’accepter la transaction. Il est probable que d’autres sœurs vivent avec elles car, en septembre 179, c’est Marguerite Frappa24 qui signale à l’agent municipal de Marlhes le décès de Jeanne Champagnat, rubanière, « décédée en son domicile » qui est sans doute la maison des Sœurs de St Joseph. Mais est-ce la même maison qu’en 1790 ?
Sœur Thérèse et la famille Champagnat
Cette permanence de la communauté des sœurs semble contredire la tradition des Frères Maristes (Vie ch. 1 p. 4) disant que Thérèse Champagnat, tante de Marcellin, recueillie par son frère au Rozey, en 1791 « était une religieuse qui, comme tant d’autres, avait été chassée de son couvent »25. Ce n’est sans doute ni complètement faux ni tout à fait vrai. Thérèse s’est bien réfugiée chez son frère mais plus probablement sous la Terreur, à la fin de 1793 ou au début de 1794, parce que sa liberté et sa vie étaient menacées par les autorités révolutionnaires qui la considéraient comme « béate ».
En effet, dans la région de Saint Etienne et la Haute-Loire, les autorités révolutionnaires et déchristianisatrices ont créé un mythe de la béate définie comme une dévote fanatique prompte à cacher les prêtres, à les ravitailler et à les seconder dans leur apostolat clandestin. Dans les Annales de l’institut (Tome 1 p. 10, § 38) le F. Avit cite d’ailleurs un document du 11 octobre 1793 enjoignant au « citoyen Champagnac », de surveiller avec l’aide de son cousin Ducros, les communes du canton de Marlhes et notamment « de faire arrêter et transférer dans les prisons de Saint Etienne toutes les filles béates et fanatiques et tous les prêtres réfractaires ». On est alors, juste après la promulgation de la loi des suspects du 17 septembre qui permet d’arrêter tous ceux qui sont soupçonnés de s’opposer à la République. Et les autorités trouvent Champagnat trop mou dans l’application de cette loi terroriste.
Dans la paroisse voisine de Jonzieux les activistes révolutionnaires se sont montrés plus décidés. Le F. Gabriel Michel cite le témoignage de Mademoiselle Rosalie Massardier, du hameau de Rebaudes, à propos des sœurs de la commune, qui, au cours de l’année 1794, sont conduites à Feurs en char à bœufs « pour y être emprisonnées en attendant la guillotine ».
« C’est un nommé Ravel qui est chargé de la corvée. Le char est escorté par un peloton de gendarmerie. Au lieu-dit « la Chavanne », les Bleus s’arrêtent pour boire. Le char continue et arrive à un endroit broussailleux. Ravel dit alors sans se retourner :’’Si quelqu’une voulait se sauver, ce n’est pas moi qui la verrais’’. Une jeune religieuse, Jouve de Massardière, en profite. Elle restera cachée dans sa famille et rejoindra ensuite ses compagnes sauvées par la mort de Robespierre »26.
La loi des suspects va être aggravée par le décret du 26 février 1794 (8 Ventôse de l’an II) qui ordonne de mettre sous séquestre les biens des suspects. Mais jusqu’à quel point cette mesure a-t-elle été appliquée aux sœurs de Marlhes ? Pour éviter de tomber sous le coup de la loi, elles ont dû procéder à une dispersion partielle car Marie-Madeleine Peyrard, Anne Champagnat, Madeleine Lardon âgées respectivement de 68, 66 et 64 ans en 1790 ne peuvent être considérées comme suspectes. Même Marie-Anne Berton et Marguerite Frapa (respectivement 50 et 44 ans en 1790) semblent vues comme des femmes âgées. Et puis, les « ci-devant sœurs de Saint Joseph » peuvent prétendre que leur vie commune est justifiée par leur activité de « filles rubanières ».
Les quatre sœurs plus jeunes, dont la plus âgée est Thérèse Champagnat, 37 ans, peuvent davantage être soupçonnées de menées subversives et doivent trouver des lieux de refuge familiaux ou autres. Et c’est sans doute entre octobre 1793 et février 1794 que Thérèse-Louise Champagnat vient habiter chez son frère. Cet éloignement est dû aux circonstances mais aussi, dans les petites communautés de « sœurs agrégées » des bourgs et villages, la vie quotidienne en communauté n’était pas un impératif absolu (M. Vacher p. 341-361). D’ailleurs le recensement de 1808 signale, au hameau de Montaron, Marie Clapeyron , 67 ans, « sœur de Saint Joseph », qui vit seule.
Nous avons un indice sur la présence de Thérèse au Rozey vers 1794-95 par l’anecdote sur Marcellin enfant demandant si la Révolution est une personne ou une bête (Vie, ch. 1). A quoi la tante aurait répondu qu’elle est « plus cruelle qu’aucune bête qui soit au monde ». Si cet épisode est authentique27 il suppose chez Marcellin la naïveté et la curiosité d’un enfant de moins de sept ans, à une époque où les ravages de la Révolution justifient amplement les propos de sa tante.
C’est après le coup d’Etat du 18 Fructidor (4 septembre 1797) qui reprend une politique de déchristianisation que, dans sa séance du 7 brumaire (28 octobre 1797) de l’an six, le conseil municipal annoncera la mise en vente de « plusieurs biens nationaux entre autres une maison, jardin et un bois situés en cette commune, appartenant aux ci-devant28 Sœurs de St. Joseph de Marlhes, qui seront vendus le 13 (brumaire) en présence de l’administration du district. Elles (les mises en vente) ont été de suite affichées». Il est difficile de savoir si la vente a eu lieu car ce nouveau gouvernement peine à imposer son autorité et on peut même supposer le rachat de la maison par un homme de paille des sœurs.
Thérèse Champagnat cachée chez son frère ou seulement retirée ?
Acceptons donc l’idée que Thérèse a vécu chez son frère durant la Terreur. On peut supposer qu’en 1793-94 elle lui imposait une vie clandestine ou au moins très discrète pour éviter qu’une dénonciation ne crée des ennuis à son frère de sérieux ennuis. Mais dans les années 1795-97 la persécution a cessé : les prêtres exilés rentrent ; les prêtres cachés réapparaissent. L’Eglise se reconstitue prudemment car la situation demeure précaire. Mais c’est aussi l’époque où J.B. Champagnat, qui a perdu toute influence politique, se trouve menacé d’arrestation ou même d’assassinat par les bandes royalistes et contre-révolutionnaires. C’est ce qui arrive à son cousin Ducros, assassiné par une bande contre-révolutionnaire dans la prison de St Etienne le 3 juin 1795. Ainsi, en 1795-97 les rôles de Jean-Baptiste et de Thérèse Champagnat ont pu s’inverser : cette fois c’est la « béate » qui protège le jacobin et sa famille contre les tentatives de vengeance. Nous avons vu ci-dessus qu’ensuite le temps de la seconde terreur (1797-1799) ne permettait guère à Thérèse de rentrer dans sa communauté. Son retour définitif pourrait se situer entre 1800 et la publication du concordat, en avril 1802.
Il faudrait se demander aussi quels accords financiers ont été passés entre les sœurs Saint Joseph et Jean-Baptiste Champagnat. Thérèse pouvait d’ailleurs disposer de sa dot pour acquitter un prix de pension. Elle exerçait certainement aussi son métier de rubanière tout en aidant au ménage et à l’éducation des enfants. Il me paraît en tout cas improbable que Thérèse ait longuement résidé chez un frère ayant de nombreux enfants à charge sans qu’aient existé entre eux des arrangements financiers.
Une éducation de la sœur Thérèse plus poussée que ne le croient les Frères ?
Cette question financière pose la question d’une Thérèse exerçant à domicile les fonctions d’une maîtresse d’école. Il est vrai que les sources maristes sont loin de voir Thérèse sous cet angle : la Vie du Fondateur (Ch. 1 p. 4-5) dresse de la tante un portrait fort conventionnel : c’est une personne « d’une éminente piété et d’une grande vertu », qui enseigne à Marcellin « les mystères de notre sainte religion », lui faisant faire ses prières, lui contant « des histoires tirées de la vie des saints », l’initiant à la dévotion à la Sainte Vierge, aux saints anges gardiens, et aux âmes du purgatoire ». Il est vrai que « souvent pendant sa vie on l’a entendu (le Fondateur) parler de sa pieuse tante et des instructions qu’elle lui avait faites dans son enfance […] et il conservait pour elle une reconnaissance et une affection qui devaient durer autant que sa vie ». Mais là encore, le F. Jean-Baptiste demeure très imprécis. Et il estime fort peu la science profane de la mère et de la tante qui, n’ayant pu apprendre qu’imparfaitement la lecture à Marcellin, « on l’envoya chez un maître d’école pour se perfectionner dans la lecture et pour lui apprendre à écrire ».
Cependant, l’affaire de la première communion de Marcellin pose un problème chronologique : Le F. Jean-Baptiste et le F. Avit nous disent que Marcellin fait sa première communion à onze ans, soit en 1800, alors que l’âge normal est treize ans29. Si tel est le cas, l’instruction donnée par la tante aurait pu être de niveau un peu plus élevé que ne le pensent les Frères30. Mais la date la plus vraisemblable serait plutôt 1801 ou 1802, après que Marcellin ait fréquenté une école dont la fonction principale était d’enseigner catéchisme et lecture avant la première communion. Il aurait donc fréquenté l’école du bourg plusieurs années (1800-1801 ?) puis, rebuté par une méthode brutale et peu efficace, refusé d’y retourner après sa première communion. La tradition qui considère Thérèse seulement comme une mère spirituelle et celle qu’il affirme qu’il a très vite quitté l’école sont à prendre avec prudence. Il reste cependant que Marcellin Champagnat a déclaré par la suite que son instruction première avait été manquée.
Thérèse, la famille Champagnat et les enfants du Rozey
Le Fr&eegrave;res Jean-Baptiste parle de l’influence de Thérèse comme si Champagnat avait été fils unique. Mais, quand elle arrive dans la maison Champagnat, probablement à la fin de 1793, les plus grands enfants Champagnat (Marie-Anne née en 1775 ; Barthélemy né en 1777 ; Anne-Marie en 1779 😉 ont respectivement 18, 16, 14 ans et Marguerite-Rose, née en 1782, a une dizaine d’années. L’influence de Thérèse sur eux a été réduite et en tout cas, aucune des filles ne deviendra sœur de Saint Joseph. C’est sur les derniers enfants : Jean-Pierre (1787) et Marcellin (1789), sans compter Joseph Benoît, qui mourra à 13 ans, que pourra s’exercer l’influence de la tante.
Mais il se peut que durant la période 1793-1800 la présence de Thérèse dans la famille Champagnat se soit rapprochée du modèle des béates, vivant de la rubanerie tout en catéchisant et instruisant les enfants et adultes de l’entourage et même servant d’agent de liaison avec le curé Allirot exerçant clandestinement son apostolat. L’histoire de la Révolution est d’ailleurs pleine d’exemples de laïcs ou d’anciennes religieuses très actifs dans la résistance à la Révolution. Il en est même un dans la paroisse voisine de Jonzieux où la famille Duplay, au hameau de Rebaudes a constitué un véritable centre pastoral :
« Des catéchismes, préparatoires à la première Communion, se faisaient à Rebaudes. Des enfants y venaient de fort loin. Mme Stanislas Chaurain, religieuse des Sœurs de Jésus, à Saint-Didier, et Sœur des Pères Chaurain, Maristes, nous a raconté souvent que sa mère et sa sœur, originaires de Jonzieux, allaient recevoir, dans la famille Duplay, des leçons de catéchisme, qui leur étaient données en même temps qu’a Claude et à Jean-Louis Duplay. Quelquefois c’étaient des prêtres qui expliquaient le catéchisme ; Jean Duplay et Julienne La Vialle faisaient souvent aussi l’office de catéchistes. Le plus souvent, cette fonction incombait à une ancienne religieuse, chargée en outre de visiter les malades, de les préparer à la réception des Sacrements, de faire les lectures édifiantes dans les assemblées religieuses, quand les prêtres n’y pouvaient paraître sans danger 31. »
Thérèse aurait pu jouer un rôle semblable au hameau du Rozey. Donner une éducation collective et familière était d’ailleurs une fonction qu’elle avait pratiquée au bourg. Il est vrai que sa présence au foyer d’un Jean-Baptiste Champagnat partisan de la Révolution devait être quelque peu problématique. En même temps, comme je l’ai dit, elle avait des avantages : J.B. Champagnat et sa sœur se protégeaient l’un l’autre. Et le contact pouvait être maintenu avec M. Allirot caché quelque part. Il ne faut certainement pas aller jusqu’à faire de la maison Champagnat un foyer de résistance mais, comme bien des familles dans les temps troublés, les Champagnat ont joué sur les deux tableaux, par conviction certainement et aussi par réalisme. Ainsi, chez les Champagnat on ne risquait guère, comme dans la plupart des foyers de résistance à la révolution, d’amalgamer la cause catholique et la cause royale. Et en somme Jean-Baptiste et Thérèse Champagnat ont constitué une fratrie fondée sur une distinction du politique et du religieux bien rare dans cette région à l’époque. Et en 1804, l’envoi par M. Allirot des recruteurs du séminaire à la famille Champagnat peut passer pour une approbation discrète d’une telle attitude.
Thérèse inspiratrice de la pédagogie de Marcellin ?
Sur le rôle de Thérèse Champagnat comme éducatrice au Rozey, il est possible d’avancer quelques arguments. Tout d’abord, si l’on en croit la tradition mariste, Marcellin a inculqué aux Frères l’exemple de sa tante comme modèle d’éducation chrétienne et celle du maître d’école du bourg de Marlhes comme anti-modèle. Et le contraste entre cette première éducation à base de relation confiante et celle, plus brutale, de l’école paroissiale aurait contribué à faire naître la vocation éducative de Marcellin. Mais aussi, Champagnat, séminariste, n’a-t-il pas repris une tradition instaurée par sa tante ?
Julienne Epalle, (Enquête diocésaine, p. 199) témoin au procès de béatification de Marcellin rappelle en effet que, devenu grand séminariste, il rassemblait du monde pour l’instruire durant ses vacances.
« Dès la première semaine des vacances du grand séminaire, il (Champagnat) dit à quelques habitants du Rozey : Si vous veniez, je vous ferais le catéchisme, je vous dirais comment il faut passer votre vie. La petite chambre se remplit. Les dimanches suivants on accourait des hameaux de La Frache, Ecotay, Malcognière, Montaron, L’Allier et, la chambre étant trop petite, il se tenait sur le seuil de la porte et parlait à l’auditoire qui remplissait la chambre et une pièce voisine […] Bon nombre de personnes du bourg de Marlhes venaient l’entendre. On remarquait surtout la Supérieure des sœurs de Saint Joseph ».
Julienne Epalle, qui exagère sans doute le rayonnement de Marcellin jeune séminariste, ajoute que « pour faire plaisir à mes parents, qui étaient voisins de la maison Champagnat, il consacrait tous les jours quelques heures à nous instruire »32.
En agissant ainsi, Champagnat se comporte comme un séminariste au zèle plus qu’ordinaire. Mais ne reprend-il pas la tradition pastorale inaugurée par la Sœur Thérèse, faisant du hameau du Rozey, et plus précisément de la maison Champagnat, un pôle pastoral ? D’ailleurs, en venant écouter Marcellin dans la maison où sœur Thérèse, toujours vivante, avait exercé une vingtaine d’années auparavant, la supérieure des sœurs de Saint Joseph paraît authentifier une tradition. Et c’est au moins avec l’accord tacite du curé que ces réunions ont lieu. Et puis, lorsque Champagnat enverra des frères catéchiser les hameaux de La Valla, Marcellin ne copiera-t-il pas le modèle qu’il a connu, et même pratiqué, dans son propre hameau et dans sa maison ?
Quoique ces hypothèses soient fragiles nous devons admettre que Thérèse a joué, dans l’éducation du jeune Marcellin un rôle structurant, sans doute moins par l’instruction donnée, que par un style éducatif basé sur une bonne relation adulte-l’enfant. Ne peut-on émettre l’hypothèse que c’est sur ce fondement, d’abord plus ressenti que conceptualisé, que Marcellin construira un projet exprimé dès 1816 dans le « Il nous faut des Frères » ? Voit-il alors les Frères comme le double masculin des sœurs de St Joseph ? Ce n’est pas impensable, car, avec sa tante, il a expérimenté, à un âge où les impressions se gravent en profondeur, un style éducatif à la fois christianisant et efficace, transmis au sein de petites communautés apostoliques.
Une éducatrice de Marcellin encore trop mal connue.
Il faut enfin nous interroger sur le fait que les sources maristes ne parlent de la tante Thérèse qu’en évoquant l’enfance de leur fondateur. Les Annales de l’institut signalent néanmoins la date de sa mort le 2 mai à 72 ans33 (tome 1 p. 13, § 42). au moment où son neveu Marcellin, devenu prêtre, âgé de 35 ans, entreprend de construire l’Hermitage. Nous ne savons donc rien des rapports entre Thérèse et son neveu durant plus d’un quart de siècle. Il serait hasardeux d’y voir un signe de brouille entre eux. C’est plutôt un exemple de plus de la grande discrétion entretenue par Marcellin sur sa famille. Ceci dit, la déclaration du décès de Thérèse a de quoi surprendre. Comme elle est très différente du procès-verbal de décès de sa tante Jeanne, il vaut la peine de placer côte à côte, ces deux documents nous révélant des moments très différents de l’histoire des Sœurs Saint Joseph de Marlhes en même temps que le destin final de la grande tante et de la tante de Marcellin.
|
Décès de Jeanne Champagnat (16 septembre 1798) |
Décès de Thérèse Champagnat |
|
Le trente fructidor de l’an six de la Rép (ublique) françoise (sic), sur les dix heures du matin, devant nous, agent municipal de la commune de Marlhes, a comparu Margueritte Frappa de la commune de Marlhes, laquelle a déclaré que Jeanne Champaignat, rubanière, demeurante en ce lieu est décédée ce jour d’hui dans son domicile âgée de soixante-quinze ans, d’après laquelle déclaration m’étant assuré du décès, de lad(ite) Champaignat ai rédigé le présent acte que j’ai signé avec lad(ite) Frappa. |
Ce jour d’hui quinze mai dix-huit cent-vingt -quatre à neuf heures du matin par devers nous maire et officier de l’état-civil de la commune de Marlhes ont comparu Jean B(aptis)te Augustin Viallette âgé de trente neuf ans, cabaretier, et Guillaume Cheyret âgé de trente-sept ans, maréchal ferrant, demeurant tous deux au bourg de Marlhes, qui nous ont dit que Louise Champagnat, native de cette commune, dite sœur Thérèse de la congrégation de St Joseph, âgée de soixante et douze ans, rubanière, demeurant au bourg de Marlhes, est décédée le jour d’avant-hier à six heures du soir au bourg de Marlhes dans son domicile susd(it) ; après nous être assuré du décès ci-dessus déclaré, nous avons rédigé le présent acte dont nous avons donné lecture aux comparants qui ont signé avec nous. |
Quand meurt Jeanne Champagnat, Marlhes n’est pas une commune mais fait partie d’un ensemble administratif plus vaste, présidé par J.B. Champagnat. Il est un peu étrange qu’une seule personne – et une femme – fasse la déclaration de décès et qu’aucun membre de la famille Champagnat ne soit présent. En tout cas, Margueritte Frappa est Sœur de Saint Joseph, ce qui signifie que le lien entre elle et la défunte a été maintenu et que les deux femmes vivent ensemble ou au moins en contact étroit. En ce temps de retour de la persécution religieuse (la terreur fructidorienne) on se garde bien de faire allusion aux Sœurs de Saint Joseph. Par contre le titre de rubanière, d’ailleurs traditionnel, ne fait pas difficulté.
Le procès-verbal du décès de Thérèse Champagnat est écrit en contexte pacifique mais ne présente pas moins d’étrangetés. Cette fois, aucune sœur de Saint Joseph n’intervient, mais un cabaretier et un maréchal ferrant, sans doute ses voisins. Leur déclaration est tardive, comme si le décès de sœur Thérèse n’avait pas été découvert immédiatement. En tout cas, les deux témoins paraissent fort bien renseignés sur la défunte : ils savent qu’elle a deux prénoms : l’un officiel (Louise) l’autre usuel ; ils connaissent son âge et son appartenance aux Sœurs de Saint Joseph mais ni celles-ci ni la famille Champagnat n’interviennent. On a l’impression que Thérèse, au moment de son décès, vivait en marge de sa communauté et de sa famille. Ainsi, à peine évoquée par la tradition des Frères Maristes, Thérèse garde jusqu’au bout sa part de mystère.
_______________
F. André Lanfrey, décembre 2018
1 Publié par Les Amis de Marlhes en juin 2011
2 Publié sous forme de Cahier A4 par la maison généralice à Rome, 2001, 292 p.
3 Ouvrage cité p. 187-191.
4 Cahier multigraphié publié par la maison généralice, 182 p. sans date (vers 2000).
5 Les Marlhiens et leurs notaires, p. 128
6 Registre des baptêmes, A. D. de la Loire.
7 Thérèse Champagnat a reçu au baptême un seul prénom, Louise, celui de sa marraine, Louise Crouzet. En principe les Sœurs de St Joseph n’ont pas de nom de religion mais certaines sœurs semblent en choisir un. Les constitutions des Sœurs de Saint Joseph (M. Vacher, p. 417) rappellent qu’elles ont été fondées le 15 octobre 1650 « fête de Sainte Thérèse ». On peut supposer une dévotion particulière de la tante Louise envers Thérèse d’Avila, ou qu’elle est entrée dans la communauté des sœurs le jour de la fête de la sainte.
8 Chronologie mariste, Rome 2010, p.16.
9 Des « régulières » dans le siècle. Les sœurs de Saint Joseph du Père Médaille aux XVII° et XVIII° siècles, Editions Adosa, Clermont-Ferrand, 1991, 464 p.
10 Il y a au moins quatre maisons de béates à Marlhes, notamment à Lallier et La Faye. Elles sont reconnaissables à un clocheton qui permet d’appeler à l’assemblée.
11 Ce sont de pauvres journaliers qui complètent leurs revenus par des fonctions de sous-clercs paroissiaux payés par la fabrique.
12 La loi du 20 septembre 1792 l’établira à 21 ans pour filles et garçons.
13 Mesure de capacité équivalant à 33 litres.
14 A La Faye il existe une ancienne maison de béate encore munie du clocheton caractéristique.
15 Droits féodaux sur les successions.
16 Péages à l’entrée des villes.
17 : Registre des Délibérations. P. 28. Cette crise de 1792 est l’une des conséquences de la guerre déclarée en avril.
18 La famille Dugas figurera parmi les bienfaiteurs du P. Champagnat.
19 Les Années obscures… p. 70.
20 Mademoiselle Fournas sera une bienfaitrice du P. Champagnat.
21 : Joseph de Fréminville, op. cit. p. 160. Cité dans Les années obscures… p. 113.
22 Domicilié au hameau de La Faye, il est maire en 1791-92. Supplanté par Tardy, il redeviendra maire en 1795.
23 Le 11 avril décret interdisant les transactions en numéraire. Les gens se méfient de l’assignat, monnaie papier, qui se dévalue rapidement.
24 Voir le texte du procès-verbal ci-dessous.
25 Annales de l’institut, T. 1, p. 5, § 17. Vie de Champagnat, Ch. 1 p. 4.
26 : Témoignage de Mademoiselle Rosalie Massardier, recueilli par un chercheur anonyme.
27 Il existe une autre version de l’histoire où Marcellin interroge son oncle en demandant si la révolution est un homme ou une femme. Cette version paraît moins fiable car l’emploi de l’article « la » signifie le genre féminin.
28 L’expression « ci-devant » signifie « auparavant, dans l’Ancien-Régime ».
29 Vie, ch. 1 p. 5 ; Annales de l’institut, tome 1, p. 7, § 30. C’est possible mais l’affirmation n’est, à ma connaissance, confirmée par aucun document probant.
30 Dans Les années obscures de Marcellin Champagnat p. 13, le F. Gabriel Michel nous dit que Louise ne signait pas « Champagnat » mais « Champaiat » n’arrivant pas à maîtriser la graphie « gn ». Peut-être. En tout cas elle signe son nom.
31 Abbé J.M. Chausse, Vie de M. l’abbé Jean-Louis Duplay, St Etienne, 1887, tome 1, ch. 3 p. 37
32 Dès 1856 le F. Jean-Baptiste (Vie p. 25) donnait déjà des détails semblables : « Souvent Il réunissait dans sa chambre les enfants de son village, pour leur apprendre le catéchisme et les prières. Les jours de dimanche il réunissait même les grandes personnes ».
33 En fait le 13 mai comme le suggère l’état-civil.
716 visualizações