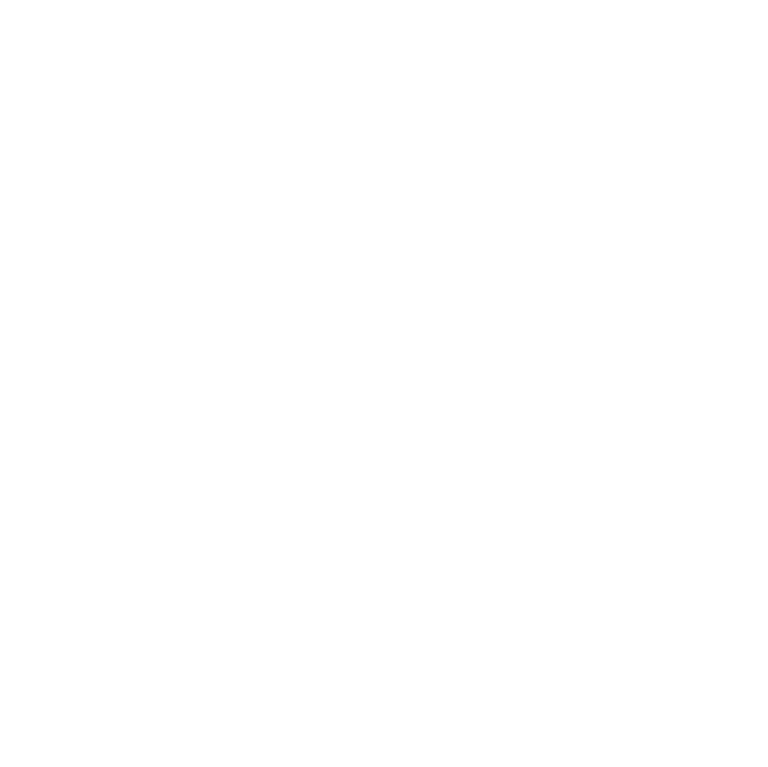Marlhes sous la révolution
La pastorale du curé Allirot en temps de persécution (1791-1802)
F. André Lanfrey – 28/05/2019
Marcellin Champagnat naît dans le diocèse du Puy en mai 1789. Le 12 juillet l’Assemblée constituante vote la Constitution Civile du Clergé et promulguée le 24 août. Et le 24 novembre 1790 la même assemblée impose aux ecclésiastiques fonctionnaires publics un serment de fidélité à cette constitution. Comme les 11 mars et 13 avril 1791 le pape Pie VI condamne la Constitution civile, le clergé de France se divise en constitutionnels, appelés « jureurs » par leurs adversaires qui seront traités de « réfractaires » (rebelles) par les autorités révolutionnaires. La constitution civile a un aspect territorial considérable puisque désormais il y a coïncidence entre frontières départementales et circonscriptions ecclésiastiques. De ce fait le territoire du diocèse du Puy est considérablement modifié. Comme sa bordure Est se trouve intégrée au département de Rhône-e-Loire il perd les paroisses de St Genest-Malifaux, Marlhes et Jonzieux. Sur sa frontière nord il perd la région de St Bonnet le Château, Estivareilles, Usson-en-Forez, Apinac. Dans l’immédiat, seul le clergé constitutionnel reconnaît ce nouveau découpage. Ainsi, à Marlhes le registre des délibérations de la commune dresse un « procès-verbal contre le sieur Allirot curé de la paroisse de Marlhes le 14 ème aoust 1791 » car jusque-là, ni Allirot ni son vicaire n’ont prêté le serment constitutionnel. Mais il n’est pas question de les remplacer par un clergé constitutionnel, ce qui peut paraître étonnant.
En effet, nous dit André Latreille1 : « De la fin de janvier à la fin de mars 1791 à travers la France entière, chaque dimanche se réunirent les citoyens actifs chargés d’élire les nouveaux fonctionnaires ecclésiastiques ». A Lyon l’archevêque constitutionnel Lamourette, inconnu dans le diocèse mais bénéficiant de soutiens politiques, est élu le 2 mars. Ces circonstances assez troubles, puis la condamnation de la Constitution civile par le pape les 10 mars et 23 avril, ne vont pas contribuer à asseoir son autorité. En tout cas, il prend ses fonctions en avril après avoir reçu la consécration épiscopale. Le curé Peyrard de Jonzieux, la commune voisine de Marlhes, ayant été récusé par le gouvernement, M. Linossier est élu curé constitutionnel à une date tardive : le 24 juillet 1791 (Chausse t. 1 p. 25). Et cet acte l’intègre au diocèse de Lyon.
Pour éviter d’être révoqué le curé Allirot s’est montré assez retors comme on le voit par le procès verbal dressé contre lui qui ne concerne pas directement le serment constitutionnel mais la lecture de l’Instruction pastorale de l’archevêque Lamourette du 16 juillet 1791 qui conteste violemment le jugement de la cour de Rome sur la Constitution civile, allant jusqu’à un doute sur l’authenticité des décisions pontificales2. Le 27 juillet une lettre du procureur communal Barrallon, priant Allirot de lire cette instruction à la messe, est restée sans effet. Le 5 août elle est portée à la cure par J.B. Champagnat sur réquisition du même procureur. Allirot prétend ne pouvoir faire cette lecture le 7 août : il veut d’abord « examiner la dite instruction et que d’ailleurs il était trop faible et ne se sentait pas le courage de pouvoir faire cette lecture, que les eaux3 qu’il prend dans le moment l’ont extrêmement affaibli ». Le curé va encore répéter son refus avant la messe et en désespoir de cause les officiers municipaux dressent procès-verbal « pour que aucune faute ne nous soit imputée ». Le 28 août, fort d’un arrêté du district de St Etienne le maire et le secrétaire demandent à Allirot de s’expliquer: veut-il lire le mandement épiscopal « et faire les prières énoncées au mandement » ? Accepter de dire ces prières au prône de la messe c’est déjà reconnaître l’autorité de Lamourette et Allirot refuse : « Nous a répondu qu’l ferait les prières ordinaires » c’est-à-dire celles qui sont traditionnelles dans le diocèse du Puy. On lui suggère de faire lire l’instruction pastorale par le vicaire Laurent ; à quoi le curé répond qu’il ne s’y oppose pas mais ne peut l’y forcer. Interrogé, le vicaire refuse. Un nouveau procès-verbal est donc dressé et envoyé à St Etienne.
Ce double refus aurait dû déclencher la révocation d’Allirot et de son vicaire. Mais il faut croire qu’on a cru plus politique de ne pas insister. A cette époque bien des prêtres assermentés se sont déjà rétractés ; d’autres, bien que nommés, subissent quotidiennement une fort opposition. Et puis, on est à la limite de la Haute-Loire où, dit un auteur, sur 550 insermentés, 300 ont continué leurs fonctions4. Enfin, on est dans les derniers mois de l’Assemblée Constituante. Le 1° octobre ce sera l’ouverture de l’Assemblée législative, premier essai de monarchie constitutionnelle, qui se soldera rapidement par un échec, puisque le 10 août 1792 le pouvoir royal sera renversé et l’assemblée supplantée par une commune parisienne ultra révolutionnaire. Dès le 12 août 1792 est publiée une loi imposant aux fonctionnaires publics un nouveau serment dit de Liberté-Egalité. Le 20 septembre 1792 c’est la fin de l’assemblée législative ; le 21 l’abolition de la royauté et le 25 septembre la proclamation de la République « une et indivisible ».
La cascade de ces événements, qui annoncent la terreur des années 1793-94 obligent Allirot et son vicaire Laurent à sortir de leur refus : le 12 octobre 1792 ils prononcent le serment de Liberté-Egalité qui ne se réfère plus à la Constitution civile du clergé et ne sera jamais condamné par le pape. Mais il va diviser durablement le clergé réfractaire, les plus intransigeants – et ils ne manquent pas dans l’ancien diocèse du Puy – le considérant comme illégitime tandis que M. Emery supérieur de Saint Sulpice, très influent, l’admet et le prononce lui-même. Il estime en effet que ceux qui refusent ce serment se laissent dominer «par des vues de contre-révolution, très mal entendues et pour qui la religion, au lieu d’être une fin, n’est qu’un moyen5 ». Presque tous les évêques en exil, et Mgr. de Galard évêque du Puy en particulier, sont dans le camp intransigeant.
Il est très peu probable qu’Allirot et son vicaire aient été influencés par la pensée de M. Emery qui n’avait pas eu le temps d’être formulée et répandue avant qu’ils ne prononcent le serment. Ils ont donc fait un choix difficile dans l’urgence, Allirot étant certainement à même de raisonner comme M. Emery : c’était pour lui et son vicaire le seul moyen de continuer leur action pastorale.
Mais ce choix a un revers considérable : Allirot et son vicaire sont certainement très minoritaires dans un diocèse du Puy très marqué par l’amalgame catholicisme-royalisme. Dans le diocèse de Lyon l’administrateur Linsolas n’admet pas davantage le serment de liberté-égalité, mais sans confondre autant qu’au Puy les causes royale et catholique. Marlhes serait donc aux marges des diocèses du Puy et de Lyon, non seulement géographiquement, mais encore pastoralement.
La résistance catholique et royaliste dans la région de Marlhes-Jonzieux
La Vie de M. Duplay par l’abbé Chausse évoque cette résistance typique de la région de Marlhes en évoquant particulièrement la commune voisine de Jonzieux, elle aussi rattachée au département de Rhône-et-Loire, où la famille Duplay, au hameau de Rebaudes, paraît l’antithèse de la famille Champagnat.
« Jean Duplay, à cause de sa haute situation dans la commune de Jonzieux, n’avait pu se refuser à être officier municipal. Mais pour ne s’associer à aucune mesure inique, il ne se rendait pas aux séances du Conseil. Ses collègues, qui étaient à peu près tous de braves gens, en faisaient autant. »
« Des documents officiels, empruntés aux archives [31] de Jonzieux, renferment des plaintes amères, formulées par l’agent national, contre les conseillers municipaux qui le laissaient ordinairement seul, à la mairie, au lieu d’aviser avec lui, aux moyens « de purger le pays des prêtres réfractaires qui l’infestent et disent la Messe dans des réunions auxquelles assistent quatre cents, sept cents, mille et même douze cents personnes6 ; ce qui ne peut avoir lieu, ajoutent les rapports de l’agent national, que par l’incivisme, ou la tiédeur des membres du Conseil. »
Malheureusement l’auteur a négligé les dates et cette abstention de Jean Duplay et des modérés concernerait plutôt la période qui suit la chute de Robespierre en 1794-95, moment où, dans un pays troublé, il est dangereux de faire de la politique.
L’abbé Chausse nous décrit en outre « le pays » parcouru par les prêtres réfractaires et les foules croyantes. Son récit est quelque peu idéalisé mais il rend compte d’un phénomène bien connu : une pastorale catholique qui s’organise à l’échelle d’un vaste territoire considéré comme ouvert à des « missionnaires » itinérants et à des populations relativement lointaines. « Les registres de Jonzieux attestent que pendant la Révolution, on baptisait dans cette paroisse des enfants apportés de Saint-Étienne, Le Chambon7, Firminy, Monistrol, Aurec, Saint-Didier-la-Séauve ; etc. ». Les populations des lieux trop surveillées ou sans prêtre réfractaire local se déplacent donc pour les sacrements vers les pôles de résistance ou font appel à un missionnaire itinérant.
L’abbé Chausse nous donne même des détails sur Le domaine de la famille Duplay à Rebaudes, hameau de Jonzieu :
« Jean Duplay et Julienne La Vialle (son époouse) […] avaient organisé un Oratoire dans la grange. […] Julienne La Vialle y venait souvent avec ses enfants. Les prêtres se donnaient rendez-vous dans cette hospitalière demeure. Parmi les confesseurs de la foi qui y ont trouvé un asile, on y a conservé les noms de MM. l’abbé Peyrard, vicaire de la paroisse ;de Rachat, curé de Saint-Didier-la-Séauve; Rouchouze, curé de Saint-Victor-Malescours, l’abbé de Vazeilles, ancien missionnaire ; l’abbé Rouchon, de La Roche8 ; Laurent, vicaire de Marlhes ; Montchovet, vicaire de Saint-Romain-les-Atheux ; Mijollat, plus tard, curé de Saint-Just-Malmont; Limosin, Truchet, Naly, et enfin l’abbé Brive9.»[…] « Dans ces maisons, les prêtres trouvaient la sécurité, le repos, la nourriture, le moyen de célébrer la sainte messe, d’entendre les confessions, de baptiser, de bénir les mariages, de veiller à la préparation des enfants pour la première Communion. »
Evidemment, ce réseau de résistance souffre de la Terreur. Jean Duplay, dénoncé pour incivisme et pour avoir caché des prêtres, est emprisonné à Saint-Etienne, dans le couvent des Minimes transformé en prison, puis transféré à Rive-de-Gier « avec une foule de Foréziens, dénoncés comme contre-révolutionnaires, et quelques habitants du district d’Yssingeaux en Haute-Loire ». Cette captivité de trois mois a dû avoir lieu à l’été 1794 puisque c’est la chute de Robespierre qui provoque sa libération et certainement celle de ses compatriotes, peut-être en août ou septembre.
Mais Rebaudes n’est qu’un des multiples lieux de refuge dont l’abbé Chausse nous donne une liste :
« les Rivaton, de Goyet ; les Planchet, de Jabrin ; les La Vialle ; les Massardier, de Foisset10; les Epalle, de Peybert et du Roset11 ; les Colomb de Gast ; les Roux, des Chavannes ;les Courbon ;les Defours, du Fau ;les Réocreux, de Malmont ; les Duplay, du Fraisse ; les Besson de La Mure ; les du Peloux de Saint- [27] Romain ; les Chausse de Brignon12 ; les Gattet et les Faugier, de Chambaud ; les Convers, de La. Fayolle et de Flaminges13 ; les Durieu, de Fruges ; les Veylon, de Saint-Victor et de Saint-Just, etc., etc., et tant d’autres, dont la reconnaissance publique a gardé le nom. »
Nous ne sommes guère surpris que cette liste d’une vingtaine de familles ne contienne pas les noms des Champagnat, des Rivat, ni des Ducros qui représentent les adhérents à la révolution. Quant aux lieux, en général des hameaux, ils se répartissent sur Jonzieux, Marlhes, St Just Malmont, Riotord, St Sauveur en Rue… une dizaine de paroisses, surtout de la Haute-Loire.
La connivence royalisme-catholicisme
Il y a forte connivence entre la résistance religieuse et la militance royaliste fort active dans ces contrées : la plupart des prêtres « missionnaires » ne font qu’assez peu la différence entre l’une et l’autre. Dans un article des Cahiers Maristes14 j’ai déjà évoqué l’abbé Mijollas15 officiellement vicaire de Marlhes de 1794 à 1799. Il est de famille noble comme l’indique son nom complet : Mijollas du Crouzet. Vers 1792 il s’est exilé en Italie mais semble être rentré à la fin de 1794, après Thermidor. Sa biographie nous dit : « tant que durèrent les mauvais jours il rayonna dans plusieurs parties du département (de la Haute-Loire) mais son séjour habituel était dans les environs de Marlhes, Jonzieux et Saint Genest-Malifaux », trois paroisses du diocèse du Puy rattachées à la Loire. On loue son dévouement pour aller de nuit assister les malades en danger de mort mais on précise « qu’il ne partait jamais seul et qu’il était parfaitement armé, de même que ceux qui l’accompagnaient ».
D’autres prêtres font de même et certains d’entre eux procèdent à des grands rassemblements de fidèles pour braver les autorités révolutionnaires qui ne parviennent pas à contrôler ces terres montagneuses où les prêtres réfractaires évoluent comme des poissons dans l’eau. Ces provocations ne sont sans doute pas du goût de Mgr. de Galard, évêque du Puy en exil, mais il semble que l’autorité de son délégué administrateur M. Berghougnou de Rachat, curé de Tence, ait quelque mal à s’imposer. D’ailleurs l’évêque en exil à St Maurice-en-Valais, en Suisse, manifeste un esprit très intransigeant, considérant que, la Révolution passée, le clergé et aussi la royauté devront être restaurés dans leur autorité et leurs biens16.
Après la Terreur de 1793-94 la tentation de passer à la contre-révolution est forte comme on le voit avec l’histoire de l’arbre de la liberté de Marlhes rapportée par le registre des délibérations de Marlhes et reprise par l’abbé Chausse, qui relate un exploit dont les héros, de sa propre famille, sont à la fois résistants catholiques et ardents royalistes :
« Au Brignon, (un hameau de S. Romain-Lachalm en Haute-Loire à la limite de la commune de Marlhes) la famille Chausse comptait parmi ses membres cinq frères, très hardis royalistes, et très habiles pour un coup de main. ». Le 3 Fructidor an III, (20 août 1795) en pleine nuit, un des fils, aidé d’un domestique coupe l’arbre de la liberté planté sur la place du bourg de Marlhes. Pendant qu’ils abattent l’arbre, les habitants sont dissuadés d’intervenir par des menaces d’être « tirés ». La date de l’événement n’est pas fortuite : c’est le temps de la revanche royaliste après la terreur. J.B. Champagnat et la tendance jacobine ont perdu le contrôle de la mairie de Marlhes. Et la destruction de l’arbre de la liberté est destinée à intimider ceux qui l’ont planté. Un peu plus tôt, le 3 juin 1795, J.P. Ducros, cousin de J.B. Champagnat a été assassiné dans sa prison par une bande royaliste.
Si le vicaire Mijollas me semble un cas assez clair de prêtre missionnaire très zélé mais porté à amalgamer cause royaliste et pastorale catholique le cas de l’autre vicaire de Marlhes, M. Laurent, plus nébuleux. Jusqu’en 1792 il suit fidèlement la politique attentiste de son curé, mais ensuite leurs voies semblent se séparer. Laurent est en contact avec la famille Duplay mais pas Allirot. Surtout, en 1794 et 95 les « Dispositions du diocèse » nomment Laurent comme vicaire de Marlhes mais « sans approbation ». En 1797 il est autorisé « pour la messe seulement ». Et en 1799 il est encore « non approuvé ». Les autorités diocésaines semblent donc le considérer comme un prêtre résidant sur la paroisse de Marlhes sans y exercer de fonctions officielles. Lui reproche-t-on son serment de Liberté-égalité ou est-il tout simplement malade ?
M. Allirot, lui ne figure pas dans la liste des prêtres fréquentant la famille Duplay. Et c’est probablement l’indice qu’il n’évolue pas dans une résistance politico-religieuse dont l’abbé Mijollas est un exemple, mais qu’il a gardé une pastorale plus modérée et probablement plus paroissiale que celle des missions, mise en place par l’administrateur du diocèse. Il est cependant difficile de dépasser le stade de l’hypothèse, même si celle-ci contribuerait à expliquer pourquoi M. Allirot envoie un prêtre recruter un des enfants de Jean-Baptiste Champagnat. Il se pourrait que l’un comme l’autre aient su distinguer les domaines politique et religieux ou au moins faire preuve de modération dans une crise qui portait bien du monde aux extrêmes.
La vie sacramentelle à Marlhes sous la révolution
Les registres de baptêmes, mariages, sépultures ne sont pas une source très intéressante en elle-même pour déterminer l’évolution de la vie religieuse durant la Révolution, mais, en l’absence de sources plus fiables, ils ne sont pas à négliger. Je vais donc présenter ci-dessous les renseignements qu’ils nous donnent.
A Marlhes, les registres que tenait M. Allirot ont été remis à l’officier de l’état civil le 20 février1793 dans un contexte dramatique : le 21 janvier le roi Louis XVI a été guillotiné et la guerre et les oppositions internes entraînent la mise en place d’une politique de terreur. Et le curé commence donc de nouveaux registres qui n’auront plus de caractère officiel. Et les péripéties de la persécution vont rendre difficile la tenue de ces registres.
Baptêmes, mariages et sépultures en 1793
|
Mois |
Baptêmes |
Mariages |
Sépultures |
Total |
|
1 |
0 |
0 |
1 | |
|
F |
1 |
0 |
4 |
5 |
|
M |
6 |
0 |
6 |
12 |
|
A |
10 |
1 |
9 |
20 |
|
M |
7 |
3 |
5 |
15 |
|
J |
4 |
2 |
2 |
8 |
|
J |
6 |
4 |
5 |
15 |
|
A |
4 |
0 |
4 |
8 |
|
2 |
0 |
4 |
6 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
N |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
D |
2 |
1 |
0 |
3 |
|
|
45 |
11 |
39 |
95 |
Il est normal que le curé n’indique presque aucun acte en janvier-février puisqu’en principe ceux-ci sont consignés dans les registres donnés à la commune. Ensuite, jusqu’en juillet les actes semblent reprendre un rythme normal. Mais la distribution des sacrements se dégrade car la politique antireligieuse s’installe. Et l’absence de tout acte sacramentel en octobre prouve que le curé n’exerce plus officiellement ses fonctions. Il a plongé dans la clandestinité.
Baptêmes, mariages et sépultures en 1794
|
Mois |
94/B |
94/M |
94/S |
Total |
|
6 |
1 |
0 |
7 | |
|
F |
5 |
2 |
0 |
7 |
|
M |
1 |
2 |
0 |
3 |
|
A |
12 |
0 |
9 |
21 |
|
M |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J |
5 |
0 |
1 |
6 |
|
J |
2 |
0 |
5 |
7 |
|
A |
3 |
1 |
1 |
5 |
|
S |
5 |
2 |
1 |
8 |
|
O |
4 |
0 |
2 |
6 |
|
N |
2 |
2 |
3 |
7 |
|
D |
1 |
2 |
2 |
5 |
|
|
46 |
12 |
24 |
82 |
Malgré l’ambiance de terreur, le curé de Marlhes réalise tant bien que mal la sacramentalisation de sa paroisse. Mais quelque chose se passe en avril-mai : d’abord une étonnante activité baptismale en avril suivie d’un vide. Comme si Allirot, après un temps de forte activité avait dû rester caché quelque temps au plus fort de la terreur. Il mentionne toujours les sépultures alors que l’église est fermée au culte, sans que l’on sache où et comment se déroulait cet acte. La chute de Robespierre fin juillet n’a aucun effet visible sur sa pastorale car la Terreur ne se desserre que lentement.
La Vie de M. Duplay, qui s’emploie à exalter l’action des prêtres réfractaires montre d’ailleurs que, probablement à la fin de 1793 et au début de 1794 les communautés sont réduites à célébrer des messes blanches pour un public restreint :
« Aux plus mauvais jours, quand on ne pouvait avoir de prêtres, à Rebaudes, le dimanche, les parents de la famille Duplay et un petit nombre d’amis sûrs se réunissaient quand même dans le modeste Oratoire de la grange. Jean Duplay présidait à la récitation des prières, lisait l’ordinaire de la Messe, commentait avec bon sens l’Évangile du jour, rappelait les jours de fête, d’abstinence et de jeûne, pendant que deux ou trois hommes dévoués faisaient sentinelle aux alentours du village pour surveiller l’approche de la force armée. »
Baptêmes, mariages, sépultures en 1795
|
|
95/B |
95/M |
95/S |
Total des actes |
|
J |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
F |
4 |
1 |
0 |
5 |
|
M |
10 |
0 |
0 |
10 |
|
A |
5 |
1 |
11 |
17 |
|
M |
5 |
4 |
8 |
17 |
|
J |
8 |
1 |
1 |
10 |
|
J |
5 |
2 |
5 |
12 |
|
A |
5 |
1 |
1 |
7 |
|
S |
6 |
0 |
1 |
7 |
|
O |
7 |
0 |
2 |
9 |
|
N |
4 |
3 |
3 |
10 |
|
D |
7 |
0 |
2 |
9 |
|
|
67 |
13 |
35 |
115 |
La fin de la terreur permet une nette reprise pastorale avec un certain rattrapage en mars-juillet 1795. Mais l’église n’est toujours pas ouverte et la vie clandestine du curé continue.
Durant ces années 93-95 Marcellin Champagnat passe de 4 à 6 ans accomplis. Il n’a jamais vu l’église ouverte au culte. Il ne connaît probablement pas le curé Alirot. Toute sa culture religieuse lui vient de la famille par sa mère et sa tante. Même s’il a une notion confuse de la politique il n’a pu que ressentir les tensions suscitées par les événements révolutionnaires, en particulier l’exécution du roi. D’où cette question assez typique d’un enfant de six-sept ans : la révolution est-elle une personne ou une bête ?
Catéchisme et première communion après la Terreur
Dans ses registres le curé Alirot ne mentionne pas la première communion, qui suppose au préalable le catéchisme et la confession. En bonne logique il aurait dû réorganiser cet aspect important de la pastorale et peut-être l’a-t-il fait sans en tenir registre. En tout cas l’abbé Chausse nous renseigne sur Jonzieux :
« Le 9 thermidor ralentit l’ardeur de la persécution. Les prêtres proscrits reparurent et offrirent de nouveau le saint Sacrifice dans quelques maisons sûres. Des catéchismes, préparatoires à la première Communion, se faisaient à Rebaudes. Des enfants y venaient de fort loin. Mme Stanislas Chaurain, religieuse des Sœurs de Jésus, à Saint-Didier, et Sœur des Pères Chaurain, Maristes, nous a raconté souvent que sa mère et sa sœur, originaires de Jonzieux, allaient recevoir, dans la famille Duplay, des leçons de catéchisme, qui leur étaient données en même temps qu’à Claude et à Jean-Louis Duplay. Quelquefois c’étaient des prêtres qui expliquaient le catéchisme ; Jean Duplay et Julienne La Vialle faisaient souvent aussi l’office de catéchistes. Le plus souvent, cette fonction incombait à une ancienne religieuse, chargée en outre de visiter les malades, de les préparer à la réception des Sacrements, de faire les lectures édifiantes dans les assemblées religieuses, quand les prêtres n’y pouvaient paraître sans danger. »
Par ces propos l’abbé Chausse ne nous renseigne pas seulement sur l’esprit apostolique de la famille Duplay mais sur le système missionnaire mis en place dans le diocèse du Puy : le catéchisme y est désormais l’affaire des laïcs, des religieuses sécularisées comme des prêtres. Il est très probable que ce système a aussi fonctionné à Marlhes sous le contrôle de M. Allirot.
Baptêmes, mariages, sépultures en 1796
Il paraît étrange que, durant cette année politiquement assez tranquille au point que M. Allirot sort de clandestinité et va réconcilier l’église en fin d’année, presque aucune sépulture n’ait été célébrée.
|
|
96/B |
96/M |
96/S |
Total |
|
J |
8 |
5 |
1 |
14 |
|
F |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
M |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
A |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
M |
4 |
1 |
0 |
5 |
|
J |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
J |
6 |
2 |
0 |
8 |
|
A |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
S |
5 |
4 |
0 |
9 |
|
O |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
N |
5 |
5 |
0 |
10 |
|
D |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
total |
70 |
17 |
1 |
88 |
C’est l’indice de l’application à Marlhes de la stratégie missionnaire qui relativise le territoire paroissial et abandonne la célébration des sépultures, même si elle accorde beaucoup d’importance aux derniers sacrements.
Autre signe d’application d’une politique missionnaire : l’arrivée à Jonzieux en août 1797 de Jean-Pierre Brive, ordonné prêtre en Suisse, le 15 juin 1797, dans la chapelle de l’abbaye de Saint-Maurice-en- Valais par Mgr. de Galard. Il est envoyé à Jonzieux par M. de Rachat, ancien curé de Tence, administrateur du diocèse du Puy pendant l’exil de son évêque. Il y exercera son ministère durant la seconde terreur.
Baptêmes, mariages, sépultures en 1797
La réconciliation de l’église permet le rétablissement du culte public à Marlhes durant presque un an, jusqu’au coup d’Etat de Fructidor en septembre 1797. D’où la reprise des sépultures sur le registre. Marcellin Champagnat, qui atteint ses 8 ans a dû, pour la première fois, fréquenter l’église avec sa famille et peut-être faire connaissance avec le curé Alirot.
|
|
Alirot |
Alirot |
Alirot |
|
Mijollas |
Mijollas |
Mijollas |
Total |
|
|
97/B |
97/M |
97/S |
|
97/B |
97/M |
97/S |
|
|
J |
9 |
3 |
5 |
|
|
|
|
|
|
F |
8 |
4 |
9 |
|
|
|
|
|
|
M |
6 |
0 |
6 |
|
|
|
|
|
|
A |
8 |
0 |
7 |
|
|
|
|
|
|
M |
8 |
0 |
3 |
|
|
|
|
|
|
J |
11 |
1 |
8 |
|
|
|
|
|
|
J |
5 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
A |
4 |
0 |
4 |
|
|
|
|
|
|
S |
4 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
O |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
|
|
|
|
N |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
|
|
|
|
D |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
|
|
|
L’effet du coup d’Etat de Fructidor en septembre 1797 est immédiat. Le 4 septembre 1797 Alirot a célébré une dernière sépulture et il cesse de tenir le registre des baptêmes dès le 23 septembre 1797. Ce coup d’Etat prend par surprise un clergé qui avait pu se croire sorti de l’ère des persécutions. C’est un échec pour la stratégie paroissiale d’Allirot, tandis que celle des missionnaires comme Mijollas, peu préoccupés de territoires paroissiaux, peu pressés de sortir de la clandestinité et peut-être soutenus par les réseaux royalistes, évite un retour précipité dans l’obscurité. L’abbé Mijollas, qui commence à tenir son registre des baptêmes et des mariages en octobre 1797, n’est pas un simple vicaire et un remplaçant : il incarne une pastorale différente de celle d’Allirot.
Baptêmes, mariages, sépultures en 1798
|
|
Allirot |
Allirot |
Allirot |
|
Mijollas |
Mijollas |
Mijollas |
|
|
98/B |
98/M |
98/S |
|
98/B |
98/M |
98/S |
|
J |
8 |
2 |
|
|
0 |
|
|
|
F |
4 |
11 |
|
|
3 |
3 |
|
|
M |
4 |
1 |
|
|
3 |
|
|
|
A |
6 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
M |
0 |
5 |
|
|
3 |
|
|
|
J |
3 |
|
|
|
0 |
|
|
|
J |
0 |
|
|
|
9 |
|
|
|
A |
0 |
|
|
|
1 |
4 |
|
|
S |
0 |
|
|
|
2 |
|
|
|
O |
0 |
|
|
|
2 |
|
|
|
N |
0 |
|
|
|
9 |
3 |
|
|
D |
0 |
|
|
|
7 |
1 |
|
|
total |
25 |
19 |
0 |
|
40 |
11 |
0 |
L’année 1798, durant laquelle sévit la persécution, est étonnante : ni Allirot ni Mijollas ne se préoccupent de funérailles, l’église étant fermée et les fidèles procédant probablement eux-mêmes au service funèbre17. On a l’impression aussi d’un certain partage des tâches durant la première partie de l’année, Allirot assumant la plupart des mariages. Mais ce retour de l’ancien curé est bref : il cesse de signer le registre des mariages en mai 1798 et ne le reprendra que le 7 avril 1799. C’est pourquoi, au fond de la page 9 du registre M. Mijollas écrit ces mots : « L’orage de la persécution ayant éloigné le pasteur de son troupeau il existe une lacune en l’état de ce registre de ses fonctions curiales depuis le 11 juin 1798 jusqu’au 1° avril 1799 ».
Ce long éloignement du curé a lieu durant l’administration de J.B. Champagnat qui a pris ses fonctions de président du canton de Marlhes le 11 février 1798. Mais il est sous la coupe du commissaire Trilland, ardent républicain qui demande sans cesse la chasse aux déserteurs et aux prêtres réfractaires et exige l’organisation de fêtes civiques, notamment dans l’église. A Marlhes la seconde Terreur paraît plus rigoureuse que la première parce que le pouvoir central n’a jamais été aussi impérieux envers le pouvoir local. Mais la stratégie pastorale missionnaire de Mijollas a pu contribuer aussi à éloigner Allirot de sa paroisse.
Baptêmes, mariages, sépultures en 1799.
Bien que le régime de terreur se poursuive, le système pastoral connaît un nouveau changement, Allirot partageant le travail sacramentel avec Mijollas à partir du mois d’avril. Mais est-ce coopération ou concurrence ? En tout cas l’absence de funérailles est le signe de la continuité de la persécution, le coup d’Etat du 18 brumaire (novembre 1799) en fin d’année n’ayant pas d’effet immédiat.
|
|
Alirot |
Alirot |
Alirot |
|
Mijollas |
Mijollas |
Mijollas |
|
|
99/B |
99/M |
99/S |
|
99/B |
99/M |
99/S |
|
J |
|
|
|
|
9 |
8 |
|
|
F |
|
|
|
|
5 |
4 |
|
|
M |
|
|
|
|
5 |
0 |
|
|
A |
9 |
2 |
|
|
0 |
0 |
|
|
M |
6 |
2 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
|
J |
4 |
|
|
|
6 |
0 |
|
|
J |
2 |
4 |
|
|
4 |
0 |
|
|
A |
4 |
1 |
|
|
5 |
0 |
|
|
S |
2 |
3 |
|
|
2 |
2 |
|
|
O |
7 |
|
|
|
1 |
0 |
|
|
N |
0 |
|
|
|
4 |
0 |
|
|
D |
2 |
1 |
|
|
4 |
0 |
|
|
Total |
36 |
13 |
0 |
|
46 |
14 |
0 |
Si Marcellin Champagnat, trop jeune, a certainement gardé une idée vague de la première terreur, (1793-94), les deux années de la terreur fructidorienne (fin 1797-fin 1799), alors qu’il a 8-10 ans, ont dû marquer son esprit et influencer son destin à l’époque où un garçon commence à fréquenter l’école et à apprendre son catéchisme en vue de la première communion.
Baptêmes, mariages, sépultures en 1800
L’année 1800 est celle de la reprise en main de la paroisse par son ancien curé, et de la marginalisation rapide de Mijollas qui a peut-être exercé jusqu’en 1802 les fonctions de vicaire. Un indice du retour au calme sur le plan religieux c’est la reprise des sépultures à partir de juin, soit six mois après le coup d’Etat de Bonaparte. L’église a donc été rouverte au culte et la crainte d’un retour de la persécution s’éloigne, même si aucun accord durable n’existe entre l’Eglise et la République.
|
|
Alirot |
Alirot |
Alirot |
|
Mijollas |
Mijollas |
Mijollas |
|
|
1800/B |
1800/M |
1800/S |
|
1800/B |
1800/M |
1800/S |
|
J |
9 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
F |
3 |
8 |
|
|
1 |
3 |
1 |
|
M |
14 |
|
|
|
0 |
|
|
|
A |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
M |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
J |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
J |
6 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
A |
4 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
S |
14 |
3 |
|
|
3 |
|
1 |
|
O |
5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
N |
7 |
4 |
1 |
|
|
|
1 |
|
D |
6 |
|
4 |
|
|
|
5 |
|
Total |
89 |
17 |
8 |
|
6 |
3 |
10 |
Marcellin aurait-il fait sa première communion cette année-là comme l’affirme le F. Avit (Annales, t 1 p. 7 § 30) ? Ce n’est pas impossible puisque M. Alirot, qui a repris en main sa paroisse au printemps 1799, a disposé d’un peu de temps pour instruire lui-même ou faire instruire par son vicaire une promotion de communiants. Mais la situation religieuse demeure précaire. La reprise des sépultures en juin paraît le signe que l’église n’est rouverte au culte que tardivement. Et puis, Allirot, curé consciencieux et probablement rigoriste, n‘aurait guère eu le temps de connaître et de vérifier le degré d’instruction religieuse des nouveaux communiants. En 1801 la situation s’est éclaircie : on sait qu’un accord entre l’Eglise et l’Etat est en cours de négociation. Et puis, Marcellin aura 12 ans accomplis, âge normal de la première communion. Quoi qu’il en soit, le prêtre catéchiste qui, durant un catéchisme, donne un sobriquet à un enfant indiscipliné (Vie, Ch. 1 p. 6) pourrait être le vicaire Mijollas ou même Laurent.
Registres paroissiaux et état-civil en 1793-1800
Finalement, sur ces huit années la pastorale des baptêmes et mariages a été assez bien assurée.
|
Années |
Baptêmes |
Mariages |
Sépultures |
|
1793 |
45 |
11 |
39 |
|
1794 |
46 |
12 |
24 |
|
1795 |
67 |
13 |
35 |
|
1796 |
70 |
6 |
4 |
|
1797 |
81 |
11 |
45 |
|
1798 |
65 |
30 |
0 |
|
1799 |
82 |
27 |
0 |
|
1800 |
95 |
20 |
18 |
|
Total |
551 |
130 |
165 |
|
Moyenne |
68 |
16 |
20 |
Le baptême étant jugé indispensable au salut, le curé Allirot a-t-il pu baptiser tous les enfants nés à Marlhes ? Grâce à l’Etat-Civil de la Loire disponible sur internet, j’ai procédé à une comparaison baptêmes-naissances à partir de février 1793 (ventôse an II) jusqu’à 1800. Le calendrier révolutionnaire utilisé par l’Etat civil allant de septembre à septembre j’ai gardé ces divisions annuelles.
|
|
Baptêmes Alirot |
Baptêmes Mijollas |
Etat civil |
|
|
Février 1793-septembre 1794 |
47 baptêmes |
|
138 naissances |
An I et II |
|
Octobre 1794-septembre 1795 |
56 baptêmes |
|
100 naissances |
An III |
|
Total |
103 |
0 |
238 |
|
|
Octobre 1795-septembre 1796 |
62 baptêmes |
|
64 naissances |
An IV |
|
Octobre 96-sept. 97 |
53 baptêmes |
|
57 naissances |
AnV |
|
Octobre 97-sept.98 |
|
39 baptêmes |
44 naissances |
An VI |
|
Octobre 98-sept.99 |
28 baptêmes |
37 baptêmes |
60 naissances |
An VI |
|
Octobre 99-sept. 1800 |
73 baptêmes |
15 baptêmes |
56 naissances |
An VIII |
|
|
319 |
91 |
|
|
|
Total général |
319 |
+ 91 = 410 baptêmes |
519 naissances |
|
|
Moyenne |
|
58 baptêmes/an |
74 naissances/an |
|
Les années de Terreur (1793-95) sont donc un temps de désorganisation de la paroisse d’où un fort décalage entre naissances et baptêmes. Mais il est probable que les baptêmes non répertoriés par Allirot ont été célébrés, par lui ou un autre, sans laisser de traces du fait de l’absence de registres. Il se peut aussi que des enfants aient été seulement ondoyés par la sage-femme aussitôt après leur naissance et que le baptême officiel ait été célébré plus tard. Nous constatons en tout cas un nombre de baptêmes plus élevé que les naissances en 1798-1800. Mais c’est un rattrapage modeste puisqu’il subsiste une différence d’environ 110 entre naissances et baptêmes.
Quoi qu’il en soit, il faut admettre que, même si la continuité catholique a été très forte à Marlhes, elle n’a pas complètement évité des difficultés dans la vie des paroissiens. La paroisse est demeurée plusieurs années sans église ouverte au culte. Et quel a été l’effet des sépultures hors de l’église et, sans la présence du curé ? Et qu’a été la catéchèse des enfants durant ces huit ans ? En fait, le temps de gestion paroissiale du curé Alirot a connu trois moments très différents : jusqu’en 1792 c’est encore un fonctionnement d’ancien-régime ; dans les années 1793-1800, domine la persécution avec des alternances de violences et de répits. Après 1800 c’est la reconstruction mais dans un contexte politico-religieux tout autre : l’Eglise est désormais soumise à l’Etat. Même la restauration de la royauté en 1815 ne modifiera guère cette donne. Champagnat était bien placé pour comprendre que la révolution avait ouvert une ère nouvelle, à la fois chance et épreuve pour l’Eglise.
Baptêmes mariages et sépultures sous le Consulat et l’Empire (1801-1815)
Il n’est pas difficile, grâce aux registres de 1801-1816 de documenter les années suivantes : le curé a pris peu à peu l’habitude de donner le total annuel des baptêmes en fin d’année ; à partir de 1812 il y ajoute les mariages. Et le registre des sépultures, indépendant jusqu’en 1814, permet des comptages faciles.
|
Dates |
Baptêmes |
Mariages |
Sépultures |
|
1801 |
95 |
19 |
45 |
|
1802 |
93 |
21 |
41 |
|
1803 |
92 |
12 |
32 |
|
1804 |
? |
18 |
25 |
|
1805 |
79 |
23 |
37 |
|
1806 |
104 |
17 |
26 |
|
1807 |
98 |
20 |
34 |
|
1808 |
99 |
15 |
25 |
|
1809 |
? |
12 |
25 |
|
1810 |
68 |
17 |
43 |
|
1811 |
85 |
? |
27 |
|
1812 |
68 |
14 |
26 |
|
1813 |
98 |
38 |
44 |
|
1814 |
100 |
18 |
29 |
|
1815 |
78 |
11 |
24 |
|
1816 |
75 |
22 |
? |
|
Moyenne |
88 |
18 |
32 |
La moyenne des naissances est nettement supérieure à celle des années de la Révolution mais la différence est partiellement due au fait que les registres ont été tenus plus exactement.
A Marlhes la continuité prévaut
Durant l’année 1800 Alirot reprend ses prérogatives de curé, Mijollas étant ramené aux fonctions de vicaire. Tous deux font encore partie de l’ancien diocèse du Puy. Mais le concordat signé en 1801 va entrer en vigueur en 1802-1803. Désormais les limites des évêchés et des départements devront coïncider et Marlhes fera partie du diocèse de Lyon comme l’annonce officiellement le mandement de l’archevêque de Lyon en janvier 1803. Le curé Allirot, appartenant désormais au diocèse de Lyon, est confirmé dans ses fonctions et c’est peut-être le moment où le vicaire Mijollas devient curé de St Just Malmont à une dizaine de km de Marlhes, dans ce qui n’est plus le diocèse du Puy mais celui de Saint Flour, car on n’a pas voulu reconstituer un diocèse marqué par trop d’opposition au pouvoir central.
Contrairement à bien des paroisses, Marlhes n’a pas été divise entre clergé constitutionnel et clergé réfractaire et le système missionnaire incarné par l’abbé Mijollas ne s’y est manifesté qu’à la marge. Curé depuis 1781 M. Allirot le restera jusqu’en 1822. Dans son « Tableau général des prêtres de Lyon » en 1802, le vicaire général Courbon lui a décerné un bel éloge: « Alirot ex-curé de Marlhes ; y exerçant ; piété, talents plus qu’ordinaire »18 qui justifie amplement son maintien comme curé.
Il reste le problème des vicaires. Les Amis de Marlhes en ont établi une liste en se fondant sur les registres paroissiaux, mais les noms des vicaires y apparaissent très peu, comme si le curé s’était à peu près complètement réservé la célébration des baptêmes, mariages et sépultures. De l’examen de ces registres je tire néanmoins des renseignements non négligeables. Tout d’abord, Jean-Claude Laurent vicaire d’Alirot en 1790-93 est resté dans la paroisse mais sans statut clair 19. Comme nous l’avons vu, en 1797-1800 Mijollas exerce les fonctions de remplaçant puis de vicaire d’Allirot peut-être jusqu’en 1803. En tout cas, il déclare à la fin de son registre, le 28 août 1800 : « Je soussigné vicaire de la paroisse de Marlhes déclare avoir fait tous les actes de baptême et de mariage ci-dessus ». Et il signe « Mijolla prêtre, vic (aire) ». Du vicaire Sagnial (1805-1814) nous avons un procès-verbal de baptême le 17 novembre 1805 et on trouve sa signature de ci de là dans les registres. Les premiers actes de Chabaunay, (1814-1817) apparaissent en juin 1814. Rajat (1817…) semble commencer ses fonctions le 2 janvier 1817 mais il est difficile de savoir jusqu’à quand il exerce, le curé signant tous les actes jusqu’au 7 mai 1822. Enfin, le 13 mai 1822 un acte de baptême est signé de « Alirot vicaire ». C’est le jour-même où ont lieu les funérailles de Jean Antoine Allirot prieur de Marlhes « décédé hier par suite d’une attaque, âgé de environ quatre-vingt deux ans ». Le vicaire Alirot assure l’intérim en mai et juin 1822. La signature de M. Duplay, nouveau curé, apparaît le 29 juin 1822.
Le vicaire Alirot (1822-24) est certainement le propre neveu du curé dont parle la Vie du P. Champagnat à propos de l’installation des Frères à Marlhes à la fin de 1818 ou au début de 1819. (Ch. 8 p.85). C’est donc qu’à cette époque le vicaire Rajat a déjà laissé la place au neveu du curé Alirot qui espérait peut-être que, comme dans l’Ancien-Régime, son oncle pourrait résigner sa cure en sa faveur. En tout cas, le neveu, pas plus que ses prédécesseurs, ne signe les actes du vivant de son oncle20. Et les registres paroissiaux nous font penser à un curé Allirot assez jaloux de son autorité. Ses rapports avec le P. Champagnat donneront une impression semblable.
La vie pastorale et l’enfance de Marcellin
Toute cette chronologie et ces témoignages indirects ne sont pas sans importance pour mieux comprendre l’enfance de Marcellin Champagnat. Dans les années 1793-94 il a 4-5 ans et certainement une connaissance confuse des événements. En 1795-97 il a 6-8 ans et a pu faire connaissance avec M. Alirot. L’église n’ayant été rouverte au culte qu’à la fin de 1796 il a dû la fréquenter jusqu’à la fin de 1797 et y assister à ses premières messes. En somme, jusqu’à l’âge de sept ans il n’a guère connu que l’enseignement et les pratiques familiales inculquées par sa mère et sa tante. Mais entre 7 et 11 ans (1796-1800) il connaît deux phases contradictoires de la vie religieuse : tout d’abord le culte public dans une ambiance relativement calme, puis la persécution antireligieuse au moment où son père assume la présidence du canton au nom d’un gouvernement oppresseur.
Est-ce durant cette époque qu’il commence à fréquenter l’école et le catéchisme ?. Peut-être. Mais l’hypothèse de sa première communion en 1800 (Avit Annales de l’institut, T. 1 p. 7 § 30) alors que M. Allirot est à peine de retour et l’église à peine réouverte, paraît moins vraisemblable qu’en 1801. Quoi qu’il en soit, les troubles révolutionnaires expliquent en grande partie les propos ultérieurs de M. Champagnat sur sa première éducation manquée.
________________
F. André Lanfrey, mai 2019
1 C’est l’année où meurt Anne Champagnat, la grande tante de Marcellin, sœur de Saint Joseph.
2 Cité par le F. Gabriel Michel dans Les années obscures de M. Champagnat, ch. XIX p. 99.
3 Marlhes au long des siècles, Association des amis de Marlhes, 2002, p. 109.
4 Et c’est pourquoi les amis de Marlhes placent le début de ses fonctions en 1822
5 L’Eglise catholique et la Révolution française, tome 1, Editions du Cerf, 1970, p. 108.
6 Jacques Gadille, Histoire du diocèse de Lyon, Beauchesne, 1983, p. 196.
7 Une cure thermale.
8 André Latreille, p. 192.
9 André Latreille, p. 134-135.
10 L’agent exagère peut-être un peu mais des documents nous parlent de réunion nocturnes très nombreuses destinées à défier les autorités révolutionnaires.
11 Probablement Le Chambon-Feugerolles, près de Firmigny.
12 Paroisse de Riotord.
13 Vicaire de Jonzieux arrivé plus tardivement, en 1797, qui aura une influence sur la vocation de l’abbé Duplay.
14 Goyet, Jabrin et Foisset sont des hameaux de Jonzieux.
15 Au recensement de 1790 à Peubert la famille Epalle comprend neuf membres. Quant au Roset, il ne s’agit pas du hameau où habitent les Champagnat où aucune famille ne porte le nom Epalle, mais d’un lieu écarté à l’extrémité est de la commune de Marlhes appelé aussi le Rozet.
16 Jean Chausse l’aîné des fils, a été emprisonné à St Didier-la-Seauve, puis Rive-de-Gier (Vie de M. Duplay p. 36)
17 La Semaine religieuse du Puy cite le nom de Jean-Baptiste Convert, né à Flaminges, paroisse de St Pal de Mons, en 1759. Basé à Félines en Ardèche, il y est prêtre réfractaire durant sept ans avant d’être arrêté et déporté à l’île d’Oléron.
18 N° 25, avril 2008, p. 23-25 j’ai déjà évoqué la figure de ce prêtre.
19 Son nom est orthographié de diverses manières.
20 André Latreille, L’Eglise catholique et la Révolution française, tome 1, 1775-1799, Le Cerf, collection foi vivante, 1970, p. 207.
813 visualizações