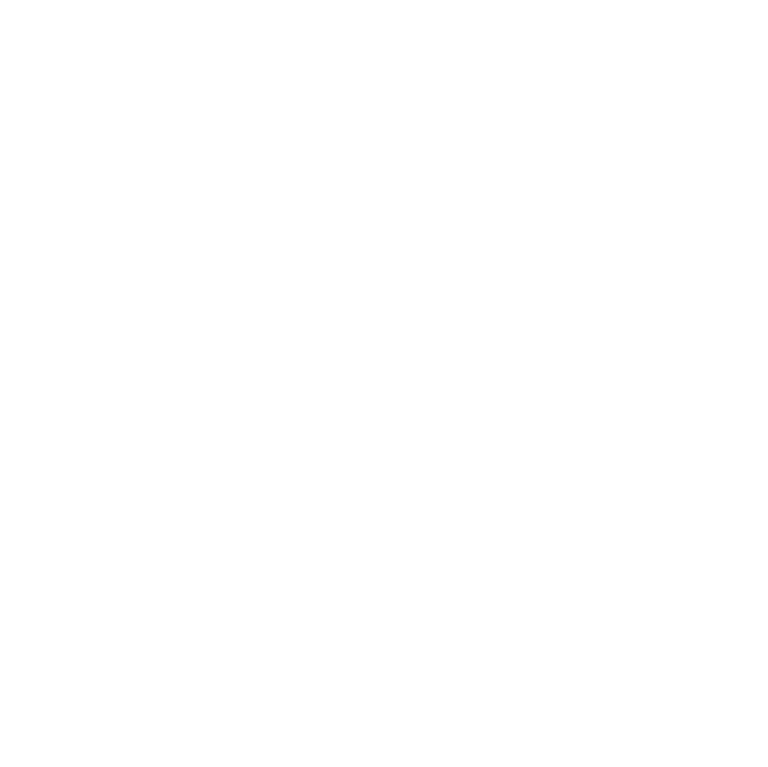Circulaires 202
Théophane
1901-12-21
Souhaits. - Document pontifical. Léon XIII aux Supérieurs des Congrégations. -- Cause du V. Champagnat, -- Le V. Champagnat et l'éducation. -- La Congrégation et la loi du 1ier juillet 1901. -- Missions de Colombie. - Brésil. -- Chine. - Afrique du Sud. .- Visites à la Maison-Mère. - Nominations. - Etablissements fondés en 1901. - Départs des Frères pour les Missions en 1901. - avis divers. - Défunts.
202
1901.2
V. J. M. J.
Saint-Genis-Laval, le 21 décembre 1901.
Fête de Saint Thomas, apôtre.
Mes Très Chers Frères,
Au moment où va commencer une nouvelle année, j'éprouve le besoin de vous exprimer les vœux ardents que je forme pour votre bonheur en cette vie et en l'autre. Ces vœux sont de tous les jours ; comme l'apôtre saint Paul s'adressant aux Colossiens (ch. 1ier), je puis dire : « Mes frères, je ne cesse de prier Dieu pour vous, et de demander qu'il vous remplisse de la connaissance de sa volonté, en vous donnant toute la sagesse et toute l'intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisiez d'une manière digne de Dieu, tâchant de lui plaire en toutes choses, portant les fruits de toutes sortes de bonnes oeuvres, rendant grâce à Dieu le Père, qui, par sa lumière, nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints, nous a arrachés à la puissance des ténèbres, et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par le sang duquel nous avons été rachetés et nous avons reçu le pardon de nos péchés. »
Oui, mes très Chers Frères, rendons grâce à Dieu pour tant de bienfaits reçus dans le courant de l'année qui vient de s'écouler ; excitons-nous au dévouement, à la générosité, à la vaillance dans le service de Dieu et dans l'accomplissement de tous nos devoirs, en nous inspirant des pensées de la foi, en nous appuyant sur les promesses et les mérites de Jésus-Christ ; élevons nos regards et nos aspirations vers le ciel, notre véritable patrie ; il nous est ouvert ; Jésus-Christ en a pris possession pour nous, après avoir accompli l’œuvre rédemptrice. Là, il ne cesse d'intercéder pour nous, et de répandre sur nous l'abondance des grâces qu'il nous a méritées. Quelles ne doivent pas être notre confiance et notre ardeur dans le saint combat de la foi ! Quand un Dieu se fait notre lumière et notre salut, qu'avons-nous à redouter ? Quand il veut bien être le protecteur de notre vie, qu'est-ce qui doit nous causer des alarmes ? Il a compté tous les cheveux de notre tête ; pas un qui se détache sans qu'il le permette. Sans doute, sur le chemin de la vie, la source des larmes est abondante ; mais que sont les adversités et les angoisses du temps, sinon une semence de vertu et de gloire pour l'éternité ? Au lieu de nous en attrister, nous devons plutôt nous en réjouir. La mort même pourrait-elle être pour nous un sujet d'effroi, lorsque Jésus-Christ a triomphé de celui qui en avait l'empire, et qu'il nous a rendu à la liberté ? Ayons donc jusqu'à la fin le même zèle, et rendons-nous les imitateurs de ceux qui, par leur foi et leur patience, sont devenus les héritiers des promesses. Chaque jour, demandons à Jésus, notre force et notre espérance, la grâce de lui rester fidèles jusqu'à notre dernier soupir. Chaque jour aussi, et à toute heure, pensons à Marie, invoquons Marie : elle est toujours pour nous, comme elle l'a été pour notre Vénérable Fondateur, NOTRE RESSOURCE ORDINAIRE. Mais, comme lui, honorons-la, aimons-la, imitons-la, et redoublons de zèle pour répandre son culte.
DOCUMENT PONTIFICAL
A l'occasion de la loi sur les Associations, Notre Saint-Père le Pape a envoyé aux Supérieurs généraux des Instituts religieux, une Lettre que son importance ne me permet pas de vous laisser ignorer. Aussi je me fais un devoir de la reproduire ici, comme étant excellemment propre à vous édifier, à vous consoler, à vous encourager.
LETTRE
DE
SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON XIII
AUX SUPÉRIEURS GÉNÉRAUX
DES ORDRES ET INSTITUTS RELIGIEUX
A Nos chers Fils les Supérieurs des Ordres et Instituts Religieux.
LÉON XIII, PAPE
Chers Fils, salut et bénédiction apostolique.
En tout temps, les familles religieuses ont reçu de ce Siège apostolique des témoignages particuliers de sollicitude affectueuse et prévoyante, soit quand elles jouissaient des bienfaits de la paix, soit surtout dans les jours de dures épreuves comme ceux que vous traversez en ce moment.
Les graves attaques qui, dans quelques pays, ont été récemment dirigées contre les ordres et les instituts soumis à votre autorité, Nous causent une douleur profonde. La Sainte Eglise en gémit, parce qu'elle se sent tout à la fois blessée au vif dans ses droits et sérieusement entravée dans son action qui, pour se déployer librement, a besoin du concours des deux clergés, séculier et régulier; en vérité, qui touche à ses prêtres, la touche à la prunelle de l’œil. Pour Notre part, vous le savez, Nous avons essayé de tous les moyens pour détourner de vous une persécution si indigne, en même temps que pour épargner à ces pays des malheurs aussi grands qu'immérités. C'est pourquoi dans plusieurs occasions, Nous avons plaidé votre cause de tout Notre pouvoir, au nom de la religion, de la justice et de la civilisation. Mais nous espérions en vain que Nos remontrances seraient entendues. Voici, en effet, que dans ces jours-ci, chez une nation singulièrement féconde en vocations religieuses, que Nous avions toujours entourée de soins très particuliers, les pouvoirs publics ont approuvé et promulgué des lois d'exception à propos desquelles Nous avions, il y a peu de mois, élevé la voix dans l'espérance de les conjurer.
Nous souvenant de nos devoirs sacrés et suivant l'exemple de Nos illustres prédécesseurs, Nous réprouvons hautement de telles lois parce qu'elles sont contraires au droit naturel et évangélique, confirmé par une tradition constante, de s'associer pour mener un genre de vie non seulement honnête en lui-même, mais particulièrement saint ; contraires également au droit absolu que l'Eglise a de fonder des instituts religieux exclusivement soumis à son autorité, pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission divine, tout en produisant les plus grands bienfaits d'ordre religieux et civil, à l'avantage particulier de cette très noble nation elle-même.
Et maintenant Nous Nous sentons intérieurement poussé à vous ouvrir Notre cœur paternel, dans le désir de vous donner et de recevoir de vous quelque consolation sainte, et en même temps pour vous adresser des enseignements opportuns, afin que, demeurant plus fermes encore dans l'épreuve, vous en recueilliez des mérites abondants devant Dieu et devant les hommes.
Parmi les nombreux motifs de courage qui naissent de la foi, rappelez-vous, chers fils, cette parole solennelle de Jésus-Christ : Vous serez heureux lorsqu'on vous maudira et qu'on vous persécutera et qu'on mentira de toute manière contre vous à cause de moi. Reproches, calomnies, vexations fondront sur vous à cause de moi : alors vous serez heureux. On a beau, en effet, multiplier contre vous les prétextes d'accusation pour vous abaisser : la triste réalité n'en éclate pas moins à tous les yeux. La véritable raison de vous poursuivre, c'est la haine capitale du monde contre la Cité de Dieu qui est l'Eglise catholique. La véritable intention, c'est de chasser, si c'est possible, de la société, l'action restauratrice du Christ, si universellement bienfaisante et salutaire. Personne n'ignore que les religieux de l'un et de l'autre sexe forment une élite dans la Cité de Dieu ; que ce sont eux qui représentent particulièrement l'esprit et la mortification de Jésus-Christ ; eux qui, par l'observation des conseils évangéliques tendent à porter les vertus chrétiennes au comble de la perfection ; eux qui de bien des manières, secondent puissamment l'action de l'Eglise. Dès lors, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, comme dans d'autres temps, sous d'autres formes iniques, la Cité du monde s'insurge contre eux, surtout les hommes qui, par des pactes sacrilèges, sont plus étroitement liés et plus servilement soumis au Prince du monde lui-même.
Il est clair qu'ils considèrent la dissolution et l'extinction des Ordres religieux comme une manœuvre habile pour réaliser leur dessein préconçu de pousser les nations catholiques dans la voie de l'apostasie et de la rupture avec Jésus-Christ. Mais s'il en est ainsi, on peut dire de vous en toute vérité : Vous êtes heureux, parce que vous n'êtes haïs et poursuivis qu'à cause du genre de vie que vous avez librement choisi par attachement pour le Christ.
Si vous suiviez les maximes et les volontés du monde, il ne vous inquiéterait pas et vous comblerait même de ses faveurs. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous marchez dans des voies opposées aux siennes, vous êtes exposés aux insultes et à là guerre. A cause de cela, le monde vous hait. Le Christ lui-même vous l'a prédit. Aussi vous regarde-t-il avec d'autant plus de complaisance et de prédilection qu'il vous voit plus conformes à lui-même quand vous souffrez pour la justice. Et vous, participant aux souffrances du Christ, réjouissez-vous. Aspirez au courage de ces héros qui s'en allaient joyeux à la vue de l'assemblée, parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir pour Jésus-Christ.
A cette gloire qui vient du témoignage de votre conscience, se joignent, sans que vous les recherchiez, les bénédictions de tous les honnêtes gens. Tous ceux qui s'intéressent vraiment à la paix et à la prospérité du pays, estiment qu'il n'y a pas de citoyens plus honnêtes, plus dévoués et plus utiles à leur patrie que les membres des Congrégations religieuses ; et ils tremblent à la pensée de perdre, en vous perdant, tant de biens précieux qui tiennent à votre existence. C'est une multitude d'indigents, de délaissés, de malheureux au profit desquels vous avez fondé et vous soutenez toutes sortes d'établissements avec une intelligence et une charité admirables. Ce sont les pères de famille qui vous ont confié leurs fils et qui, jusqu'à présent comptaient sur vous pour leur donner l'éducation morale et religieuse, cette éducation saine, vigoureuse et féconde en fortes vertus, qui ne fut jamais plus nécessaire qu'à notre époque ! Ce sont les prêtres qui trouvent en vous d'excellents auxiliaires de leur important et laborieux ministère. Ce sont les hommes de tout rang qui, par ce temps de perversion, trouvent des directions utiles et des encouragements au bien dans vos conseils autorisés par l'intégrité de votre vie. Ce sont surtout les pasteurs sacrés qui vous honorent de leur confiance, qui vous considèrent comme les instituteurs expérimentés du jeune clergé, et reconnaissent en vous ces vrais amis de leurs frères et du peuple, qui offrent pour eux à la clémence divine des prières et des expiations incessantes.
Mais personne ne peut apprécier les mérites insignes des ordres religieux avec plus de justice que Nous, qui, du haut de ce siège, devons veiller aux besoins de l'Eglise universelle.
Déjà, dans d'autres actes, Nous en avons fait une mention particulière. Qu'il nous suffise en ce moment de louer la grande ardeur avec laquelle ils suivent non seulement les directions, mais les moindres désirs du Vicaire de Jésus-Christ, entreprenant toutes les oeuvres d'utilité chrétienne et sociale qu'il leur indique, s'en allant sur les plages les plus inhospitalières, bravant toutes les souffrances et la mort elle-même, comme plusieurs l'ont glorieusement prouvé dans la dernière révolution de Chine.
Si, parmi les plus chers souvenirs de Notre long pontificat, Nous comptons d'avoir élevé par Notre Autorité un grand nombre de serviteurs de Dieu aux honneurs des autels, ce souvenir nous est d'autant plus doux qu'ils appartiennent en majorité aux Instituts réguliers à titre de fondateurs ou de simples religieux.
Nous voulons rappeler encore pour votre consolation que, parmi les hommes du monde, distingués par leur situation et par leurs connaissances des nécessités sociales, il ne manque pas d'esprits droits et impartiaux, qui se lèvent pour louer vos oeuvres, pour défendre votre droit inviolable de citoyens et votre liberté encore plus inviolable de catholiques. Certes, il suffit de n'être pas aveuglé par la passion pour voir combien c'est montrer peu de prévoyance et de noblesse que de frapper des hommes qui, sans rien espérer et sans rien demander pour eux-mêmes, se dépensent tout entiers au service de la société. Que l'on considère seulement avec quel zèle ils s'appliquent à développer chez les enfants du peuple les germes de bonté naturelle qui autrement seraient étouffés, à leur détriment et au détriment d'autrui. Semences précieuses que, la grâce aidant, les religieux cultivent patiemment et assidûment, préservent de toute atteinte mortelle et conduisent à maturité. C'est ainsi que, sous leur influence, s'épanouissent, comme des fruits magnifiques, l'amour éclairé de la vérité, l'honnêteté, le sentiment du devoir, la fermeté du caractère et la générosité dans le sacrifice. Et quoi de plus propre à assurer l'ordre et la prospérité des Etats ?
Cependant, chers fils, puisque la malignité du monde vous poursuit au point de prétendre faire oeuvre utile et louable en foulant aux pieds, dans vos personnes, les droits les plus sacrés, et qu'elle croit ainsi rendre hommage à Dieu, adorez avec une humilité confiante les desseins de Dieu. S'il laisse parfois le droit succomber sous la violence, il ne le permet que dans des vues supérieures de plus grand bien ; de plus, c'est sa coutume de secourir efficacement et par des voies imprévues ceux qui souffrent pour lui et se confient à lui.
S'il place des obstacles et des contradictions sur la route de ceux qui professent par état la perfection chrétienne, c'est afin d'éprouver et de fortifier leur vertu ; c'est plus particulièrement pour affermir et retremper leurs âmes exposées à s'affaiblir dans une longue paix.
Tâchez donc de correspondre à ces vues paternelles de Dieu. Adonnez-vous avec un redoublement d'ardeur à une vie de foi, de prière et d’œuvres saintes. Faites régner parmi vous la discipline régulière, l'union fraternelle des cœurs, l'obéissance humble et empressée, l'austérité du détachement et l'ardeur pieuse pour la louange divine. Que vos pensées soient hautes, vos résolutions généreuses et votre zèle infatigable pour la gloire de Dieu et l'extension de son règne! Puisque, par le malheur des temps, vous vous trouvez ou déjà frappés ou menacés par des lois funestes de dispersion, vous reconnaîtrez que les circonstances vous imposent le devoir dedéfendre avec plus de zèle que jamais l'intégrité de votre esprit religieux contre le contact dissipant du monde, et de vous tenir toujours prêts et aguerris contre toute épreuve.
Sur ce point, Nous vous rappelons que diverses instructions ont été adressées aux Réguliers par ce Siège apostolique, et que d'autres prescriptions sont émanées des supérieurs eux-mêmes. Il faut que les unes et les autres gardent leur pleine vigueur et soient observées en conscience.
Et maintenant, religieux de tout âge, jeunes ou vieux, levez les yeux vers vos illustres fondateurs ! Leurs maximes vous parlent, leurs statuts vous guident, leurs exemples vous précèdent ! Que votre application la plus douce et la plus sainte soit de les écouter, de les suivre, de les imiter ! C'est ainsi qu'ont agi un grand nombre de vos aînés dans les temps les plus durs. C'est ainsi qu'ils vous ont transmis un riche héritage de courage invincible et de vertus sublimes. Montrez-vous dignes de tels pères et de tels frères, afin que vous puissiez dire tous, en vous glorifiant justement : Nous sommes les fils et les frères des saints ! C'est ainsi que vous obtiendrez les plus grands avantages pour vous-mêmes, pour l'Eglise et la société. En vous efforçant d'atteindre le degré de sainteté auquel Dieu vous a appelés, vous remplirez les desseins de sa Providence sur vous et vous mériterez les récompenses surabondantes qu'il vous a promises. L'Eglise, cette mère si tendre, qui a comblé vos instituts de ses faveurs, obtiendra de vous, en échange, une coopération plus fidèle et plus efficace que jamais à sa mission de paix et de salut. La paix, le salut, voilà les deux besoins urgents de la société actuelle travaillée par tant de causes de corruption et d'affaiblissement. Pour la secouer, pour la ramener repentante aux pieds de ce très miséricordieux Rédempteur, il faut des hommes de vertu supérieure, de parole vive, de cœur apostolique, qui aient, en même temps, la puissance d'attirer les grâces célestes. Vous serez de ces hommes, Nous n'en doutons pas, et vous deviendrez ainsi les bienfaiteurs les plus opportuns et les plus insignes de la société.
Chers fils, la charité du Seigneur Nous inspire une dernière parole pour raffermir en vous les sentiments dont vous êtes animés envers tous ceux qui attaquent vos instituts et veulent entraver votre action.
Autant par conscience vous devez garder une attitude ferme et digne, autant par profession vous devez vous montrer toujours doux et indulgents, parce que c'est dans le religieux que doit particulièrement resplendir la perfection de cette vraie charité qui se laisse toucher par la commisération, mais qui ne connaît point la colère. Sans doute, à vous voir ainsi payés d’ingratitude, à vous voir ainsi repoussés, la nature s'attriste, mais, chers fils, que la foi vous réconforte par ses oracles ! Elle vous rappelle l'exhortation sublime : Triomphez du mal par le bien. Elle vous met sous les yeux l'incomparable magnanimité de l'Apôtre : On nous maudit et nous bénissons : on nous persécute et nous supportons ; on blasphème contre nous et nous bénissons. Par-dessus tout, elle vous invite à répéter la supplication du bienfaiteur suprême du genre humain, Jésus, suspendu à la croix: Père, pardonnez-leur !
Donc, chers fils, fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous avez avec vous le Vicaire de Jésus-Christ, vous avez avec vous tout le monde catholique qui vous regarde avec affection, respect et reconnaissance.
Du haut du ciel vos glorieux pères, vos glorieux frères vous encouragent. Votre chef souverain, Jésus-Christ, vous ceint de sa force et vous couvre de sa vertu.
Fils bien-aimés, adressez-vous à son Cœur divin avec une confiance filiale et de ferventes prières. Vous y trouverez toute la force nécessaire pour vaincre les plus furieuses colères du monde. Il y a une parole qui retentit à travers les siècles, toujours vivante, toujours pleine de consolation : Ayez confiance, j'ai vaincu le monde.
Puissiez-vous trouver encore quelque consolation dans Notre bénédiction qu'en ce jour, consacré à la mémoire triomphante des princes des apôtres, Nous sommes heureux d'accorder dans toute sa plénitude à chacun de vous et à toutes et chacune de vos familles, qui nous sont très chères dans le Seigneur.
Donné à Rome près de Saint-Pierre, le 29 juin de l'année 1901, vingt-quatrième de Notre Pontificat.
LÉON XIII, PAPE.
CAUSE DU VÉNÉRABLE MARCELLIN CHAMPAGNAT
Vous apprendrez avec satisfaction, M. T. C. F., que le Tribunal, chargé d'instruire les procès apostoliques dans la Cause de béatification du Vénérable Marcellin Champagnat, a terminé l'audition des témoins dans le procès continuatif sur l'héroïcité des vertus en particulier.
Les pièces de ce procès seront déposées prochainement à la Sacrée Congrégation des Rites, pour être examinées et faire partie des documents sur lesquels sera rendu un jugement d'une grande importance.
Ne cessons de prier pour que le Ciel s'intéresse de plus en plus au succès d'une cause qui nous est si chère. Demandons en particulier à Dieu, par l'intercession de la Sainte Vierge, des miracles qui fassent ressortir de la manière la plus éclatante la sainteté de notre Vénérable Père.
OUVERTURE DU TOMBEAU DU VÉNÉRABLE CHAMPAGNAT.
Le samedi 16 novembre, la Commission diocésaine chargée de la Cause du Vénérable Champagnat, s'est transportée à Notre-Dame de l'Hermitage, maison provinciale des Petits Frères de Marie. Dans la matinée, six témoins étaient cités par le R. P. Lavenaz, Mariste, vice-postulateur. Des dépositions très intéressantes devaient être fournies par M. André Neyrand, de Saint-Chamond, par M. Gallet, ancien maire de Lavalla, et par M. l'abbé Granottier, curé de Valbenoîte, précédemment curé de Marlhes, paroisse natale du Vénérable. Elles ont été reçues par Mgr Neyrat, doyen du Chapitre de la Primatiale, et par MM. les chanoines Delin, Condamin et Buy. M. le vicaire général Pagnon présidait la séance qui a duré plus de deux heures.
Le soir, avait lieu, dans la chapelle, l'ouverture du tombeau qui, depuis le 14 juin 1890, renferme le corps du Vénérable. Aux membres de la Commission et aux témoins s'étaient joints le T. R. Frère Supérieur général de l'Institut et le C. F. Stratonique, Assistant ; les Pères Aumôniers, les Supérieurs de la Province et plusieurs Frères Anciens. La bière en noyer verni et le cercueil de plomb furent retrouvés en parfait état de conservation. On pratiqua une ouverture à la partie supérieure pour vérifier l'état des ossements.
Après une assez longue attente nécessitée par le travail de l'ouvrier plombier, ils apparurent enfin enveloppés d'une légère étoffe. Le crâne était placé par-dessus. Avec la permission de M. le Vicaire général, au milieu de la plus grande émotion, chacun vint en silence près de la table sur laquelle était déposé le précieux fardeau. On voulait voir, toucher, mettre des objets pieux en contact avec ces chères reliques. Mais il fallait se hâter. Le tombeau fut refermé, scellé et reprit bientôt son aspect ordinaire jusqu'au jour, que nous voulons espérer prochain, où ces restes mortels seront de nouveau mis à découvert, mais cette fois, s'il plait à Dieu, pour être offerts publiquement, au nom de l'Eglise, à la vénération des frères en religion et des fils du Vénérable, les Pères et les Frères Maristes.
Malgré l'heure avancée, la Communauté réunie désirait offrir aux membres de la Commission sa respectueuse et profonde gratitude. Le C. F. Visiteur le fit au nom de tous, rappelant très heureusement le souvenir du Souverain Pontife qui a prescrit et béni ces travaux, de notre zélé cardinal, si heureux de voir les causes de canonisation se multiplier dans son diocèse. Au milieu des tristesses de l'heure présente, quelles consolations, quelles espérances viennent apporter aux religieux Maristes les trois causes du B. Chanel, dont le 17 novembre ramène, pour la douzième fois déjà, l'anniversaire de la glorieuse béatification; du Vénérable Champagnat, qui a les honneurs de la journée ; du T. R. P. Colin, dont le T. R. P. Martin, Supérieur général des Pères Maristes, emporte à Rome le premier procès. Le Cher Frère présenta en terminant l'expression de son hommage filial au R. F. Théophane qui, par une touchante coïncidence, célébrait le 56ième anniversaire de sa prise d'habit à l'Hermitage.
En quelques mots, M. le Vicaire général remercia, félicitant les Frères du prodigieux développement de leur Congrégation, les engageant à garder l'esprit du Fondateuravec plus de soin encore qu'ils n'en mettent à conserver ses restes mortels. Il rappela combien il est heureux de vivre en communication de plus en plus intime avec le Vénérable, travaillant pour sa cause depuis plus de douze ans.
Un salut solennel et un Te Deum d'action de grâces clôturèrent dignement cette belle journée.
(Semaine religieuse du diocèse de Lyon, 21novembre 1901.)
LE VENÉRABLE PERE CHAMPAGNAT ET L'ÉDUCATION.
Un des moyens employés par le Père Champagnat pour obtenir la bonne tenue des classes, les progrès des élèves, et pour s'assurer si l'instruction religieuse et l'éducation chrétienne étaient données aux enfants, fut de visiter chaque année les écoles… (Vie du Père, page 599).
Quels que fussent les bons résultats de ses visites et des autres moyens que prenait le Père pour stimuler le zèle des Frères et pour exciter l'émulation parmi les élèves, il comprenait que cela ne suffisait pas pour assurer la prospérité des classes, et qu'il fallait, avant tout, que les maîtres fussent capables. Aussi rien ne peut dire les peines qu'il prit pour les rendre tels. Il leur donnait lui-même des leçons de lecture, d'orthographe, d'arithmétique, d'histoire, de géographie et de chant.
Souvent il arrivait qu'il employait jusqu'au temps des récréations pour les former à quelqu'une de ces spécialités…
Le Père Champagnat, que les intérêts de la religion préoccupaient sans cesse, remarquant que bien souvent les offices divins se faisaient mal dans les églises de campagne, par défaut de chantres, pensa que ce serait contribuer grandement à la gloire de Dieu, à l'édification publique et à la solennité des offices que d'apprendre le chant aux enfants, afin, par ce moyen, de préparer et de former des chantres pour les paroisses.
En introduisant le chant dans nos classes, le Père Champagnat se proposait encore d'attirer et d'attacher les enfants à l'école par le plaisir pur et innocent que leur procure le chant, de les maintenir dans la joie et le contentement, de leur faire goûter les charmes de la vertu, de les instruire agréablement des vérités de la religion, de leur inspirer des sentiments de piété et de bannir les chants profanes. (Vie du Père, page 603).
Le chant fait partie essentielle du culte extérieur. Dieu l'avait prescrit dans l'ancienne loi. On chantait devant le tabernacle les cantiques de Moïse et plus tard, dans le temple, les psaumes de David. Tous les peuples se sont servis de chants dans leurs fêtes religieuses.
L'Eglise en a fait, dès l'origine, l'objet de sa pieuse sollicitude.
On n'oubliera jamais le désir exprimé en ces termes par le Souverain Pontife Pie IX : « Le chant grégorien aidera beaucoup à conserver et à propager la piété et l'esprit de prière, surtout si le nombre des chantres permet de former deux chœurs. »
Nous venons d'éditer un manuel d'accompagnement de nos cantiques à l'usage de nos maisons. On peut se le procurer à nos Procures provinciales. J'espère que par ce moyen, le chant des cantiques sera étudié, dans toute la Congrégation, d'après cette excellente méthode pour la gloire de Dieu, la sanctification des enfants et l'édification du peuple chrétien.
La Circulaire du 27 décembre 1892 recommande les leçons de chant dans nos écoles, et les Frères Provinciaux et Visiteurs sont chargés de veiller à cet enseignement.
LA CONGRÉGATION ET LA LOI DU 1ierJUILLET 1901
(ART. 13, § 2).
Au moment où les Conseils municipaux sont appelés à se prononcer sur les demandes d'autorisation formées en conformité de la loi du 1ierjuillet 1901, je crois à propos, pour dissiper au besoin, les craintes et les inquiétudes qui pourraient résulter de certaines délibérations, de faire connaître ici ce qu'il faut entendre par les établissements congréganistes qui, aux termes de l'article 13, paragraphe 2 de ladite loi, doivent être autorisés par un décret du Conseil d'Etat.
D'après une déclaration ministérielle, on doit entendre par établissement, au sens de la loi du 1ierjuillet 1901 : « Toute maison possédée ou louée par l'association religieuse, où celle-ci agit à ses frais, risques et périls ». Tels un noviciat, un pensionnat, un externat payant, au compte de l'association.
Ne doivent donc pas être considérées comme établissements de congrégation soumis à un décret d'autorisation, les écoles privées congréganistes, fondées par de généreux bienfaiteurs qui sont propriétaires des immeubles, et assurent aux maîtres de leur choix le logement et un salaire convenables.
Le droit d'ouvrir ces sortes d'écoles ne dépend nullement de la loi du 1ierjuillet 1901 ; il reste exclusivement régi par les lois spéciales sur l'enseignement.
C'est ce que le Président du Conseil des Ministres a reconnu en ces termes: « Quant au droit d'ouvrir des écoles primaires, la Chambre sait à merveille qu'il est réglé par une loi spéciale (30 octobre 1886); il suffit d'une simple déclaration… Cette loi garde toute sa force et la loi actuelle n'y touche même pas. » (Séance de la Chambre des députés du 18 mars 1901).
Dès lors, la demande en autorisation ne peut et ne doit avoir pour objet que le corps de la congrégation religieuse et les établissements qui lui sont propres.
Par voie de conséquence, les Conseils municipaux n'ont à se prononcer en aucun sens, lorsqu'il s'agit d'une simple école, pour laquelle la Congrégation n'a à demander aucune autorisation ; et tout avis donné par eux à ce sujet est sans objet, et doit être tenu pour nul et comme devant rester sans effet.
NOS MISSIONS
COLOMBIE.
Un intérêt particulier s'attache à nos établissements de Colombie, en raison de la guerre dont cette contrée de l'Amérique du Sud est le théâtre depuis deux ans. Une insurrection dont on ne peut encore prévoir l'issue, répand la désolation et la ruine dans ce pays. Une faction composée de libéraux, de radicaux, de nègres, de pillards, de gens sans patrie, a entrepris de renverser le parti conservateur et catholique qui est au pouvoir. C'est, comme dans la république de l'Equateur, la guerre de Satan contre le Christ ; c'est le non serviam, proféré par le grand révolté au commencement des temps; c'est la mise en pratique de cette maxime égoïste et révolutionnaire : « Ote-toi de là que je m'y mette. »
Les établissements que nos Frères dirigent dans cette vaste contrée, ont eu et ont encore à souffrir de cette révolution. Celui de Quibdo, fondé en 1895, dans la province de l'Atrato[1], est celui qui a été le plus éprouvé, à cause de sa situation dans une province éloignée du centre.
A l'occasion des épreuves par lesquelles ont passé nos Frères de Quibdo, le C. F. Manuel, directeur, nous a adressé une lettre que nous reproduisons ici.
V. J. M. J,
Cali, le 23 avril 1901.
Mon Très Révérend Frère Supérieur Général,
A moitié remis de ma pénible et mémorable campagne du Choco, je me fais un devoir et un plaisir de venir vous offrir l'hommage de mon filial respect, et de celui de mes Frères et compagnons d'infortune.
Vous n'ignorez pas, mon Très Révérend Frère, que vos enfants de Quibdo viennent de subir une bien longue et dure épreuve, due à la révolution néfaste qui dévaste ce beau pays de Colombie. Je crois répondre au désir de votre cœur paternel en vous envoyant la relation aussi fidèle que possible, des péripéties par lesquelles la Providence a permis que nous ayons passé, pendant ces quatorze longs mois que vous avez été privé de nos nouvelles.
Afin de rendre mon récit moins monotone, je vais le diviser en paragraphes résumant les principaux faits qui peuvent particulièrement vous intéresser.
I. – Préludes de l'occupation du Choco par les Radicaux.
Le Choco (partie de la Colombie comprenant la province de l'Atrato et celle de Saint-Jean) qui, dans les dernières révolutions de 1885 et 1895, était resté paisible, s'agita et prit part à la présente lutte dès les premiers jours du soulèvement général, c'est-à-dire vers la fin d'octobre 1899. Au mois de novembre, les insurgés, au nombre de 300, menacèrent Quibdo, qui n'était défendu que par une quarantaine de conservateurs. Si, à cette époque, ils ne s'en rendirent pas maîtres, et ne nous imposèrent pas leur tyrannique domination, c'est grâce à l'attitude énergique du Préfet, qui avait pris la suprême résolution de réduire la ville en cendres avant de l'abandonner aux ennemis. A cette fin, il avait fait placer en plusieurs endroits des tonneaux de pétrole et de poudre, avec mèches toutes prêtes pour l'incendie. Les principaux commerçants, tous radicaux, effrayés des pertes dont ils étaient menacés, prirent aussitôt le moyen d'écarter le conflit. Par une contribution volontaire, ils réunirent, plus de 600 piastres qu'ils distribuèrent entre les révoltés, et ils obtinrent ainsi leur dispersion.
Le fort de cette première alarme ne dura qu'une semaine ; ensuite la paix se rétablit à peu près, et nous croyions même tout fini ; mais hélas ! nous nous trompions.
Quelques blancs ou blanchis de Quibdo, à tête chaude et qui n'avaient rien à perdre, jugèrent que la révolution pourrait être pour eux une bonne aubaine. Profitant donc d'une certaine liberté que le Préfet par manque d'appui, était obligé de leur laisser, ils se distribuèrent dans différentes directions et soulevèrent de nouveau les nègres, en leur faisant croire que le Gouvernement allait rétablir l'esclavage. Ce grossier mensonge fut le brandon qui alluma la révolution non seulement dans le Choco, mais dans toute la Colombie. Trompés de la sorte, des milliers de nègres se sont fait tuer sur les champs de bataille.
Cependant 200 hommes du Gouvernement vinrent du département d'Antioquia pour prendre notre défense. Mais c'était bien peu pour en imposer aux 100.000 habitants du Choco, dont les neuf dixièmes au moins sont libéraux ; et encore perdîmes-nous bientôt ce secours.
Les principaux chefs n'ayant pu s'entendre avec le Préfet, repartirent après quinze jours avec armes et bagages.
Les radicaux, qui n'étaient pas pour rien dans ce désaccord, redoublèrent d'activité, et bientôt parvinrent à achever leur oeuvre satanique. A la fin de décembre, nous étions privés de toutes communications, tant avec l'intérieur de la République qu'avec l'étranger. Il nous parut dès lors qu'un grand péril était proche. Néanmoins les autorités n'avaient pas l'air de s'effrayer de la situation. Nous fûmes trompés par cette sécurité apparente.
II. – Désarroi dans le camp des Conservateurs de Quibdo.
Le 19 janvier 1900 fut pour les Conservateurs un jour de grande détresse, et, pour les missionnaires, le début d'une vie errante et souffrante. Une bande de vagabonds, à la tête desquels se trouvait un certain général du nom de Rafael Diaz, pénétrèrent dans le Choco et vinrent précipiter les événements. Le Préfet se laissa intimider par les formidables menaces du général, et bientôt le désordre le plus complet régna parmi nos défenseurs. En attendant l'arrivée des renforts qui devaient venir de Carthagène, tous se soulevèrent !… C'en était fait ! il n'y avait plus d'espérance qu'en Dieu !
Par les parlementaires qui étaient allés au camp ennemi, pour traiter des clauses de la capitulation, nous apprîmes que deux Capucins qui étaient en mission aux alentours, étaient faits prisonniers. Nous pouvions nous attendre à subir le même sort dans quelques heures.
III. – Fuite des Pères Capucins et des Frères Maristes.
La situation devenait critique. Pères et Frères pensèrent naturellement à quitter la maison. Malheureusement, deux Capucins étaient convalescents, et moi, je gardais le lit depuis le matin, souffrant d'une fièvre assez violente. Les deux communautés se réunirent dans ma chambre pour délibérer sur le parti à prendre. Je proposai aux Pères et aux Frères de se mettre en sûreté autant que possible et de me laisser sous la garde de la Providence. Mais en cela j'oubliais que la charité pratiquée jusqu'à l'héroïsme est une des premières vertus des bons religieux. Aussi ma proposition n'avait-elle aucune chance d'être accueillie. Cependant il n'y avait pas de temps à perdre : les envahisseurs approchaient ; le bien général exigeait de moi un effort suprême; je me levai donc en disant: Partons ! A la garde de Dieu !
Il était 6 heures du soir. Chacun s'occupa des préparatifs du voyage. Mais, de quel côté nous diriger ? Irions-nous, à travers les bois et les marais, du côté de la Cordillère ? Mais il nous fallait au moins quatre à cinq jours de marche à pied pour arriver en lieu sûr, et les chemins étaient impraticables, et il y avait parmi nous un vieillard et des malades. Chercherions-nous un refuge dans quelques maisons particulières ? Mais elles n'offraient aucune sécurité: leurs habitants eux-mêmes avaient pris la fuite, les uns dans les bois, les autres sur les bords des rivières, un grand nombre avaient pris les armes. Il ne nous restait d'autre alternative que de descendre le fleuve Atrato, quoiqu'il fût aussi occupé par les révolutionnaires. Mais, où trouver une embarcation ? Au pas de course, un Père Capucin va prier le Préfet de nous céder une des grandes canoas (pirogues) qui étaient retenues par des chaînes devant notre maison.
A la préfecture, l'eau-de-vie faisait en ce moment son effet : le Père trouva le Préfet disputant avec un officier antioqueno. Celui–ci criait à tue-tête: « Por la cruz de mi espada ! por las cenizas de mi padre ! por el recuerdo de mi madre ! no me rindo! ! ! Par la croix de mon épée ! Par les cendres de mon père ! Par le souvenir de ma mère, je ne me rends pas ! » Et son interlocuteur, faisant des zigzags, s'écriait « Señores, sírvanme de testigos, el capitan dice que se va. Messieurs, servez-moi de témoins, le capitaine dit qu'il s'en va. » Un autre capitaine antioqueno et quelques-uns des meilleurs soldats venaient de partir pour le département d'Antioquia, en jetant des cris sauvages et en brûlant leurs dernières cartouches en salves. Tout était perdu. Les sollicitations du Révérend Père n'aboutirent à rien: il était bien inutile de chercher encore l'appui de cette ombre d'autorité rabaissée jusqu'à ce point.
Sur ces entrefaites, se présentèrent à nous, s'offrant à nous suivre, deux jeunes gens dont l'un, mon meilleur élève, avait fait preuve depuis deux semaines de résolution et de courage, en passant le jour à l'école et la nuit en faction avec les soldats. Nous les reçûmes bien volontiers, comptant qu'ils pourraient nous rendre service. Aussitôt, nous leur imposâmes la tâche de détacher la meilleure des pirogues qui se trouvaient là sur le bord du fleuve et d'y déposer nos provisions. Malheureusement, ou mieux providentiellement, nos canotiers improvisés, entrepris et émotionnés, perdaient leur temps à courir à droite et à gauche. Alors, pensant que le péril était proche, un Père Capucin nous inspira l'idée d'aller attendre notre embarcation dans une maison située à 1 kilom. ½ de là, sur la rive droite du fleuve. Circonstance inexplicable, cette idée qui, examinée à tête reposée, eût paru insensée, fut admise à l'unanimité et exécutée sur-le-champ.
Nous nous mîmes donc en route entre huit et neuf heures du soir. Mais avec quel serrement de cœur nous abandonnions notre demeure, notre école, ces lieux bénis, témoins de tant de sacrifices, de tant d'actes de vertu, pleins de souvenirs religieux; ces croix, ces statues, ces images, ces livres pieux, enfin tout ce qui nous donnait courage et consolation dans ce coin perdu de la terre américaine ! Nous abandonnions tout à la profanation, au pillage, à la destruction !
La maison que nous avions en vue était habitée par un Turc que je connaissais. Je me fis donc le conducteur de la petite caravane, et nous arrivâmes à destination sans autre incident que la chute d'un Père Capucin qui, en passant sur une poutre, était tombé dans un fossé, mais heureusement sans se blesser.
IV. – Le refuge providentiel.
Nous voici donc arrivés à la demeure du Turc. Mais jugez de notre stupéfaction en nous trouvant, non seulement chez un partisan enthousiaste de la Révolution, mais en présence de trente à quarante femmes radicales, avec leurs enfants, un vrai nid de révolutionnaires et de conspiratrices. Elles étaient réunies là depuis près d'un mois, en apparence pour se protéger mutuellement contre les prétendues violences des conservateurs, mais en réalité pour comploter plus librement contre l'autorité légitime, au moyen de leurs communications secrètes avec les insurgés groupés sur divers points. Il est à remarquer que les femmes du Choco jouent un grand rôle dans les agitations politiques, et en cette circonstance elles ont mis leur influence au service de la révolution.
Voilà donc la société au milieu de laquelle nous arrivions. Comme vous le pensez bien, nous n'étions pas attendus : aussi notre apparition dut-elle être jugée on ne peut plus intempestive. Nous vîmes, en effet, que l'étonnement de tout ce monde n'était pas moindre que le nôtre. A notre vue, les conversations, tout à l'heure si bruyantes et si gaies, sont tout à coup interrompues, les visages se rembrunissent, on se regarde et on semble se demander : Que viennent faire ici ces visiteurs ? Le premier moment de surprise passé, nous nous apercevons cependant que ces gens, que nous croyions d'abord nous être entièrement antipathiques, nous regardent d'un air qui semble nous inspirer confiance. Aussi ne craignons-nous pas de leur faire connaître le motif qui nous amène là, et notre intention de continuer notre route aussitôt qu'arriverait à cet endroit la canoa que nous attendions. Mais alors quelle ne fut pas notre surprise d'entendre tout ce monde s'épuiser en raisonnements pour nous détourner de notre tentative ! Plusieurs femmes argumentaient avec force, en nous représentant les avant-postes de leurs amis placés tout près de, là, et les sentinelles qui avaient ordre de tirer sur toute embarcation qui descendrait le fleuve et ne répondrait pas au qui vive du parti libéral. En même temps le Turc nous invitait à passer la nuit chez lui.
Nous étions donc en face d'un danger imminent. Devions-nous l'affronter sans une véritable nécessité, et refuser le secours qui était offert ? Après réflexion, nous pensâmes qu'il eût été trop téméraire de prendre ce parti; et, malgré notre extrême répugnance à rester dans un tel milieu, nous crûmes répondre aux vues de la Providence en acceptant l'hospitalité qui nous était offerte, et en nous confiant à la garde de Dieu, qui a préservé de tout mal les jeunes Hébreux jetés dans la fournaise.
Après un court entretien propre à écarter de plus en plus de nous la défiance, on nous servit le café ; puis, sur l'invitation du Vice-Président de la Mission, une bonne partie de l'assemblée récita le chapelet avec nous. Prier Dieu et la Sainte Vierge et faire l’œuvre du diable, c'est malheureusement une de ces étranges anomalies qui ne sont pas rares dans ce pays.
Vers 10 heures ½, une chambre réservée fut mise à notre disposition. Notre lit fut vite prêt : il consistait, pour chacun de nous, en une simple natte étendue sur le plancher ; c'était toute la literie que nous devions avoir durant toute la campagne, en santé comme en maladie. Notre repos fut de courte durée; à une heure du matin, nous fûmes réveillés par des cris, des vivats au parti libéral poussés par des jeunes gens de Quibdo qui venaient de ramasser les armes que les conservateurs avaient abandonnées, et qui descendaient l'Atrato. J'étais saisi d'horreur et d'indignation en entendant ces hurlements de triomphe, auxquels faisaient chorus les femmes de la maison qui nous abritait. Ah ! que n'aurais-je pas fait en ce moment pour étouffer ces cris ! Mais la prudence conseillait le silence et la résignation.
V.– L'occupation de Quibdo par les révolutionnaires.
Le 20 janvier, à 9 heures du matin, 200 nègres armés de vieux fusils de chasse et de coutelas, conduits par quelques blancs, tous ivres et répartis dans une huitaine de canoas, débarquaient au Carano, lieu de notre refuge, et, malgré leur hideux aspect, étaient reçus à bras ouverts par notre entourage. Après un semblant d'alignement, ils prirent le chemin par où nous étions venus la veille.
A leur entrée à Quibdo, ils furent reçus comme des héros. Bon nombre de femmes, celles de couleur surtout, accoururent à leur rencontre, en leur jetant des fleurs à profusion, et en les acclamant par des vivats et des chants accompagnés de danses désordonnées.
Si la fête se fût bornée là, c'eût été supportable ; mais les passions excitées par la boisson, ainsi que par les chefs, ne tardèrent pas à se déchaîner d'une manière terrible.
Arrivés sur la place publique et près de la croix qui la domine, les nègres à l'aspect épouvantable se débandent et se précipitent dans toutes les directions, pour saccager les maisons des conservateurs et emprisonner tous ceux qui tombent entre leurs mains. Pendant plusieurs heures, des démagogues fanatisés donnent libre cours à leurs instincts pervers. Le chef des conservateurs est traîné sur la place publique pour être massacré; il n'échappe à la mort que grâce à l'intervention de quelques commerçants influents qui l'arrachent violemment des mains de ces forcenés. Vers midi, presque tous les partisans du Gouvernement étaient dans les fers, étendus dans un corridor, où ils passèrent huit jours au soleil et à la pluie et presque sans nourriture, expiant ainsi leur lâcheté.
VI. – La persécution atteint les Missionnaires.
Les Pères Capucins et les Frères Maristes ne devaient pas être oubliés. Le délit de porter une soutane, de vivre en religieux et de sacrifier son existence pour le bien d'un peuple plus qu'à demi sauvage, dans un pays perdu au milieu des bois, sous l'influence d'un climat des plus malsains, méritait bien la prison ! Les établissements, tant le couvent que l'école, ne tardèrent pas à être envahis par des bandes de scélérats. Beaucoup d'entre eux nous cherchaient pour nous outrager, et tous étaient attirés là par le pillage. Les portes que nous avions laissées fermées, furent toutes enfoncées. Dans le même temps, quelques femmes du Carano étant allées prendre part à ces saturnales, firent même connaître le lieu de notre refuge, car le même jour, quatre hommes armés se présentèrent à la maison du Turc et demandèrent qu'il leur livrât les six à huit révolutionnaires (ainsi étions-nous qualifiés) qui, disaient-ils, étaient cachés chez lui. Ces hommes étaient bien renseignés, car sur les treize religieux de la Mission, nous n'étions là qu'au nombre de huit, dont cinq Capucins et trois Frères Maristes ; des cinq autres, deux étaient prisonniers, et trois partis pour une autre résidence.
A la demande des émissaires, le Turc répondit qu'il n'y avait pas de révolutionnaires chez lui, et il les invita à se retirer, ce qu'ils firent aussitôt. Par deux fois, dans la même journée, d'autres émissaires se présentèrent pour nous emmener; mais à notre grande surprise, ils trouvèrent pour leur résister les femmes qui étaient encore là, et qui, s'étant constituées nos gardiennes, nous défendirent avec courage et énergie, – j'aime à leur rendre cette justice, en priant Dieu de les en récompenser. Au troisième assaut, nous voulions nous présenter, mais elles nous en empêchèrent. Ce n'est pas tout: elles veillaient avec tant de soin sur nous qu'à la moindre alerte elles nous enfermaient sous clef, et il fallait obéir !
La nuit du 20 au 21 fut assez tranquille. Le 21, au matin, arrivèrent encore 400 nègres commandés par le général Rafael Diaz. Parmi les prisonniers qu'il traînait à sa suite se trouvaient les deux Capucins dont j'ai déjà parlé, lesquels devaient, à l'intervention de quelques personnages influents, la permission d'aller nous rejoindre au Carano.
Ce général, comme tous ceux de son parti, en voulait aux religieux. Il nous accusa d'avoir des armes cachées et nous somma de les lui remettre. Sur l'assurance que nous n'avions d'autres armes que nos croix, nos chapelets et quelques autres objets religieux, il insista néanmoins et en vint à menacer notre hôte s'il ne nous obligeait à découvrir nos prétendues armes. Nous voyions bien où il voulait en venir ; mais ses plans furent dérangés par le bruit qui courait en ce moment que le Gouvernement envoyait des renforts de Carthagène.
VII. – Une lueur d'espérance.
La nouvelle apportée à Quibdo, le 23 janvier, de l'approche d'un bateau avec des troupes gouvernementales, sema l'épouvante parmi les insurgés. Leur fameux général s'effaça tout à coup, les autres officiers et le gros de la troupe firent de même ; seuls 80 nègres environ se décidèrent à force d'excitations, à venir se poster près de nous pour attaquer le vaisseau.
Pour notre part, nous pensions pouvoir compter sur notre prochaine délivrance ; mais notre espérance ne fut pas de longue durée. Pendant que tout était désordre et consternation à Quibdo, nos désirés libérateurs, qui n'avaient qu'à paraître pour être victorieux, s'arrêtaient à une petite lieue de nous. Effrayés par les fausses informations qu'ils avaient reçues sur les forces insurrectionnelles, ils n'osèrent pas avancer, et, en toute hâte, repartirent pour Carthagène, laissant derrière eux l'anarchie et le brigandage triomphants.
VIII. – Retour à Quibdo.
L'affligeante nouvelle de notre abandon ne nous trouva pas au Carano ; car, en supposant qu'il y eût eu un combat en cet endroit, notre vie eût été exposée : aussi notre hôte nous avait-il engagés à rentrer dans la ville, et avions-nous suivi ce conseil, encouragés d'ailleurs, par l'espoir d'une prompte délivrance.
Après avoir confié à notre protecteur le peu d'argent que nous avions, nous nous mîmes en route, accompagnés par lui et par six de nos vaillantes et dévouées gardiennes. Nous allions arriver aux premières maisons de la ville lorsque nous rencontrâmes deux individus bien connus dans le pays : Don Leoncio Ferrer, franc-maçon de haut grade, considéré Jusque-là dans le Choco comme chef du parti libéral, et son gendre, Victor Chaux, armés chacun d'un bâton et d'un revolver. Ils se plantèrent devant nous de manière à nous effrayer avec leur figure farouche et leur air exalté. Mais il était dit que nous marcherions de surprise en surprise. Don Ferrer, après avoir frappé un coup de bâton sur le sol, s'écria : « Padres ! Hermanos ! Aquí estamos para defenderos. Aquel que los toque se muere ! No tienen ya casa, ocupen la mía…Pères ! Frères ! nous sommes ici pour vous défendre. Qui vous touche mourra ! Vous n'avez déjà plus de maison, occupez la mienne… » Ce singulier franc-maçon qui venait de se déclarer si éloquemment notre défenseur, tint parole jusqu'au bout : nous lui devons beaucoup de reconnaissance pour les services qu'il nous a rendus.
IX.– La prison.
Nous voici donc revenus à Quibdo. Selon que nous venions de l'apprendre, le couvent et l'école, propriété de l'évêché de Popayán, étaient occupés par des révolutionnaires de la pire espèce. Cependant, pour des raisons que je crois inutile d'énumérer, nous n'acceptâmes pas l'hospitalité offerte par Don Ferrer. Alors notre ami le Turc nous installa provisoirement dans une maison récemment abandonnée par des agents français d'une compagnie minière. D. Ferrer nous accompagna, ainsi que quelques autres personnages; ils étaient une huitaine, presque tous ivres, lorsque nous entrâmes dans la maison. Là, séance tenante, D. Ferrer prit le parti de faire emprisonner le général Diaz qui, par ses procédés hautains et insolents, avait irrité contre lui tous les principaux du pays.
Mais les conjurés que l'on avait vus en notre compagnie, et qui venaient de sortir de notre nouvelle demeure pouvaient, sans le vouloir, nous compromettre sérieusement dans le conflit qui se préparait. Ainsi le comprirent nos fidèles gardiennes. Aussi, sans tarder, nous firent-elles sortir par une porte dérobée, et nous pressèrent-elles de nous cacher dans une maison voisine de plus difficile accès appartenant à l'une d'elles, mère de deux de mes élèves. Elles ne se doutaient pas, ces femmes qu'on ne saurait cependant s'empêcher de louer, que, par cet acte de charité, elles nous donnaient pour asile une prison. Pour notre sécurité, elles nous engagèrent fortement à tenir les portes et les fenêtres soigneusement fermées. De leur côté, les chefs révolutionnaires songèrent aussi à leur manière à notre sécurité, en nous signifiant la défense formelle de communiquer avec les gens du dehors. Nous voilà donc prisonniers et prisonniers en règle !… Dieu l'a permis: que sa sainte volonté soit faite !…
X. – Le pillage et le châtiment d'un profanateur.
Le pillage devait naturellement faire suite à la victoirede ces bandits : ils n'y manquèrent pas, ils commencèrent par les établissements religieux. Une partie de notre mobilier leur échappa cependant par suite des précautions que nous avions prises pour la mettre en lieu sûr; mais il en restait assez pour exciter la convoitise et les déprédations d'un ramassis d'hommes, de femmes et d'enfants poussés par les plus bas instincts. Rien ne fut respecté. Un harmonium que les Pères venaient de recevoir fut mis en pièces; les crucifix, les images religieuses, les livres pieux, furent brisés, brûlés ou jetés dans le fleuve. C'était une rage diabolique contre tout signe religieux.
Entre ces vandales modernes, il y en eut un qui se distingua tout particulièrement : c'était un jeune homme venu d'Antioquia avec le général Diaz, dont il était officier d'ordonnance. Comme ses compagnons avaient encore laissé à leur place quelques tableaux, notamment un qui représentait saint Joseph adorant l'Enfant Jésus dans la crèche, il les arracha avec violence, les lacéra, les brisa et en éparpilla les morceaux. Cet acte d'impiété, poussé jusqu'à la démence et à la fureur, devait, ce jour même, attirer à son auteur un châtiment exemplaire.
Ce que je viens de raconter se passait dans la matinée. Après midi, les nègres, au nombre de 700 environ, étaient réunis sur la place publique, en face de l'église, pour fêter leur triomphe. Les préparatifs faisaient prévoir une soirée des plus orageuses l'eau-de-vie et d'autres liqueurs devaient couler à flot des cris de mort allaient résonner de partout, et des scènes sinistres paraissaient inévitables; mais on comptait sans l'intervention divine.
Un coup de canon devait annoncer le commencement de l'orgie ; les chefs couraient à droite et à gauche en dictant leurs ordres; parmi eux se trouvait le profanateur des images bénies. Par une inadvertance inexplicable, un de ses amis, posté près du canon avec un cigare allumé, mit le feu à la poudre juste au moment où l'énergumène passait devant la pièce. Avec la détonation se confondirent les cris de douleur du malheureux, dont le pied droit avec une partie de la jambe était projeté à plus de vingt mètres. Ce tragique événement eut pour effet de disperser la foule consternée et de lui inspirer d'autres pensées que celle de se livrer à une orgie. Quant au blessé, il mourut la nuit suivante comme il avait vécu.
XI.– Le Conseil de guerre.
Selon que je l'ai dit, les révolutionnaires nous regardaient comme prisonniers ; mais, pour ma part, je ne crus pas devoir me soumettre à la défense qui nous avait été faite de communiquer avec le dehors. Le 25, au matin, je sortis donc résolument et je me rendis à la maison de la Mission occupée par les noirs. Je passai au milieu de la garde, je visitai nos appartements, et personne ne me dit mot, quoique je ne pusse m'empêcher d'apostropher avec indignation ces misérables à la vue du triste tableau que présentait notre habitation.
En visitant les classes, je trouvai le drapeau français déchiré et profané ; aussitôt je me rendis chez un Français dont je m'étais fait un ami, et chez qui j'avais déposé une partie de notre mobilier, et, sur mon invitation, il consentit à m'accompagner à la maison. Là, nous ramassâmes le drapeau lacéré et souillé, avec l'intention de le présenter au général Diaz pour essayer de l'intimider. Arrivés chez lui, nous fûmes invités à attendre dans une antichambre. Bientôt se présenta un homme à face patibulaire, une espèce de colonel, et s'adressant à moi, il me dit : «Savez-vous que j'ai des documents très compromettants contre vous ? – Je ne vois pas, lui répondis-je sèchement, quels pourraient être ces documents. – Est-ce que vous n'êtes pas un capucin ? – Non, je suis Frère Mariste, occupé ici dans l'enseignement. Eh bien, selon les informations de nos chefs vous travaillez, dans vos fonctions, à faire de vos élèves des partisans du gouvernement. » – Je coupai court à la discussion en lui ripostant : « La base de notre enseignement est la religion, et nous restons entièrement étrangers à la politique. D'ailleurs les pères de famille de Quibdo, en majeure partie libéraux, peuvent vous renseigner sur ce que nous enseignons à leurs enfants. »
Sur ces entrefaites, je vois entrer tous les Capucins de la Mission, accompagnés de quelques individus et suivis d'une douzaine de soldats armés, qui restèrent de garde à la porte. La chose devenait sérieuse. Aussitôt nous fûmes introduits devant le général que nous trouvâmes entouré d'une huitaine de chefs révolutionnaires. Bientôt parut aussi D. Léoncio Ferrer, dont j'ai déjà parlé. Le Français qui m'accompagnait s'était retiré.
On nous fit asseoir devant nos juges. Le Général commença alors à débiter, contre les Capucins particulièrement, une longue série d'accusations, assaisonnant son discours de balourdises et d'impiétés sans nombre. A plusieurs reprises, le Vice-Président de la Mission voulut riposter et protester ; mais chaque fois l'insolent Cacique luicoupait la parole.
Dans le cours de cette séance, que je ne sais comment qualifier, un certain individu qu'on appelait colonel Vallejo, lut deux lettres qu'il avait enlevées aux deux Capucins prisonniers : c'était précisément ce qu'on appelait les documents compromettants. Toutes les deux avaient été écrites par un conservateur, ami des Capucins ; la première avait été adressée aux Missionnaires, et la seconde leur était recommandée pour être remise à sa famille qui restait au Choco. Dans les deux il annonçait l'approche de quelques égarés qui venaient du sud d'Antioquia vers la vallée du Cauca, et à la tête desquels se trouvait un général appelé Rafael Diaz. Voilà le crime qu'il fallait punir d'une manière exemplaire !
Après la lecture solennelle de ces deux lettres, le Général les prit entre ses mains, et nous regardant d'un air courroucé, il les jeta à terre avec violence en s'écriant : «Que ferai-je de vous autres ! Je vous châtierai comme vous le méritez. »
En entendant cette menace, D. Ferrer se leva pour partir en disant: « Je ne vois pas le motif de ma présence ic i! Les accusations qu'on vient de formuler, n'ont à ma manière de voir, aucun fondement. Je n'ai donc qu'à me retirer ! » Cette soudaine résolution effraya nos juges qui connaissaient l'influence de l'interlocuteur. Il venait en effet d'en donner une preuve en soulevant en sa faveur trois casernes sur cinq que comptait la place. Diaz lui dit donc incontinent, d'une voix douce et persuasive : « Monsieur Ferrer, pourquoi vous en aller ? Restez, il n'y a plus rien à la charge de ces Messieurs. » Et s'adressant à nous avec la même amabilité: « Je suis bien fâché de vous avoir dérangés. Laissez la politique de côté, je vous en prie, et vous ne serez plus inquiétés. » Puis, se levant, il nous remit à chacun notre chapeau, et nous donna à tous le baiser… de Judas !… Ensuite il expédia les soldats qui attendaient à la porte, et nous accompagna jusqu'à notre maison d'emprunt, où mes deux jeunes Frères m'attendaient avec anxiété.
XII.– Faits divers.
Si je ne craignais, mon Très Révérend Frère, d'être trop long et d'abuser de votre temps, je pourrais vous relater ici une multitude d'épisodes bien propres à mettre en relief l'esprit, les tendances et la civilisation de nos dominateurs. Je ne veux cependant pas passer sous silence quelques-uns de ceux qui nous touchent de plus près.
Nous avions laissé dans notre dortoir quelques paires de souliers. Or il arriva que des nègres s'en emparèrent et s'en chaussèrent. Mais, comme ils ne pouvaient y entrer que le bout de leurs gros pieds, ils en fendirent l'empeigne et les attachèrent avec des ficelles. C'était vraiment comique de voir ces spectres humains se promener tout fiers d'être chaussés comme des blancs.
Mais ce qui n'était pas pour nous risible et, au contraire, nous faisait beaucoup de peine, c'était de voir de mauvais garnements revêtus de nos soutanes, tantôt faisant faction à la porte d'une caserne, tantôt se promenant, le fusil sur l'épaule, d'un poste à l'autre dans les rues de la ville.
Ces actes impies étaient approuvés et quelquefois commandés par les chefs. Ainsi, un jour, il arriva qu'un malandrin reçut l'ordre d'aller s'habiller en capucin et d'aller se présenter ainsi à la maison où stationnait l'Etat-Major. L'ordre fut exécuté aux applaudissements d'une vile multitude, et le comédien allait finir son rôle lorsque D. Léoncio Ferrer, le vieux franc-maçon, le rencontrant sur la place publique, bondit sur lui et lui administra une bastonnade des plus soignées. Puis, s'adressant aux chefs auteurs de l'ordre impie, il les apostropha comme ils le méritaient. En vérité, ce D. Ferrer est bien digne de nos plus chaleureux bravos.
Voici un autre fait
Au commencement de mars, un libéral du département d'Antioquia, dégoûté de la criminelle politique des principaux chefs de son parti, abjura ses idées et s'offrit au gouvernement pour saisir et lui livrer trois généraux et plusieurs autres officiers révolutionnaires, qui avaient passé dans le Choco, après une terrible défaite que leur avaient infligée les troupes conservatrices. A cette fin, il vint à Quibdo, où ces chefs se trouvaient ; mais il ne put mettre assez tôt son plan à exécution. Son changement d'opinion étant connu et son dessein dévoilé, il fut immédiatement emprisonné et dut comparaître devant un Conseil de guerre. Cependant, soit qu'il y eût encore dans ce tribunal un reste d'équité, soit que la peur l'emportât, la culpabilité de l'accusé n'y parut pas suffisamment prouvée. Nonobstant ce doute, les Chocoanos demandèrent qu'on lui infligeât la peine capitale ; et n'ayant pu l'obtenir ils firent croire néanmoins au prisonnier qu'il devait être fusillé dans quelques heures. En conséquence, ils lui proposèrent un Père Capucin pour se confesser, ce qu'il accepta. Peu après, un infâme mulâtre, démoralisé au suprême degré, se présenta, habillé en capucin, dans la chambre obscure du prisonnier, et essaya, mais en vain, de lui arracher les secrets de sa conscience. Ce profanateur expie, lui aussi, son péché – ses pieds tombent en pourriture, et il vient de perdre sa sœur, son seul soutien.
Il y eut aussi, dans ce temps-là, de misérables individus qui, revêtus d'habits religieux, eurent la sacrilège audace de simuler et de parodier l'administration de l'Extrême-Onction à des malades qu'ils visitaient.
Dans les premiers jours les cris de mort lancés contre nous étaient si fréquents, que nous n'y prenions plus garde. Un frère capucin échappa comme par miracle aux coups de revolver de deux mauvais sujets. Un jour que j'étais appuyé sur un balcon, un des principaux chefs m'aperçut et me mit en joue avec sa carabine. Je ne sais ce qui serait arrivé si D. Léoncio Ferrer n'était survenu et ne l'avait arrêté par ses paroles foudroyantes. Et notre église, en quel triste état n'a-t-elle pas été mise, sous prétexte d'y chercher des armes que l'on nous accusait d'y avoir cachées !
Maintenant, si de la tyrannie et des vexations que nous avons endurées, je passais à ce qu'ont souffert la plupart des familles respectables du Choco, combien s'assombrirait encore le tableau que je viens de vous retracer! Mais il faut me borner.
XIII. – La Providence.
Mon Très Révérend Frère Supérieur, quand je songe à la protection si visible, si constante, si efficace, dont mes chers compagnons et moi avons joui pendant cette pénible et mémorable campagne, je sens mon cœur s'attendrir et se remplir des sentiments de la plus vive reconnaissance et de la plus courageuse confiance. Jamais je n'avais éprouvé aussi sensiblement que dans cette dure épreuve, les doux et merveilleux effets des bontés de Dieu et de celles de Marie, notre céleste Mère.
Les faibles ressources qui avaient échappé à la rapacité des révolutionnaires auraient été loin de suffire à nos besoins si nous n'avions eu rien de plus pendant notre longue captivité. Les Pères Capucins ne pouvaient exercer librement leur ministère ; de notre côté, nous étions privés de notre traitement ; d'autre part, par suite de l'interruption des communications avec Carthagène qu'on peut appeler le grenier de Quibdo, les prix des vivresaugmentèrent. Livrés à nous-mêmes, nous eussions donc épuisé en peu de jours nos petites économies. Par bonheur le bon Dieu veillait sur nous, et avant que nous nous fussions rendu compte de notre situation critique, il avait inspiré à une âme généreuse la pensée de nous venir en aide. Une fille de M. Ferrer, si souvent nommé, laquelle avait fait son éducation chez des religieuses à Curaçâo, et pouvait disposer d'un avoir important, se fit, je puis dire, notre mère nourricière pendant les jours les plus calamiteux. A l'effet de nous secourir, elle s'entendit avec la propriétaire de la maison qui nous abritait, et ainsi pendant quatre mois, nos repas nous arrivèrent régulièrement, et nous ignorions quelle était la main charitable et délicate qui nous les faisait parvenir. Nous ne la connûmes que vers la mi-mai, alors que les passions politiques s'étant un peu assoupies, les Pères Capucins purent rouvrir les portes de l'église et remplir quelques fonctions de leur ministère. Nous sûmes de plus que cette bonne demoiselle accomplissait cet acte de charité à l'insu de sa famille. Profondément touchés et reconnaissants de tant de générosité, nous priâmes notre propriétaire de remercier pour nous notre bienfaitrice et de la prier de suspendre ses libéralités, parce qu'ayant encore quelques ressources, nous allions pourvoir à nos provisions de bouche. C'est ce que nous fîmes en effet, et deux Frères Capucins se chargèrent de la cuisine.
Je dois dire que les Révérends Pères Capucins ont eu pour nous, pendant ces mauvais jours, toutes les bontés possibles. Ils n'ont fait d'ailleurs que continuer, à notre égard, ce qu'ils avaient toujours fait depuis notre arrivée à Quibdo. Combien cette parfaite union qui régnait entre eux et nous, a allégé le fardeau des souffrances qui nous venaient du dehors !
Cependant, il faut le dire, malgré les marques d'intérêt que nous donnaient des personnes de cœur, la misère siégea pendant de bien longs jours dans notre demeure. Combien de fois nous avons dû déjeuner d'une demi-tasse de tisane. et d'un peu de banane, et dîner ou souper de quelques cuillerées de racines ou de fruits cuits à l'eau! Bien souvent, avec l'argent en main, nous ne pouvions obtenir qu'on nous vendît quoi que ce fût en fait d'aliments : les mauvais garnements avaient seuls la liberté de circuler et de s'approvisionner; il était entendu qu'on ne vendrait rien aux frailes. Heureusement nous trouvions de temps en temps un ami pour nous procurer le strict nécessaire.
La mauvaise alimentation, ajoutée aux peines morales, engendra des maladies. Dans les sept derniers mois de notre captivité à Quibdo, il ne se passait presque pas un jour sans que trois, quatre, jusqu'à sept d'entre nous, restassent toute la journée étendus sur le plancher, en proie à de violentes fièvres ; aussi, après trois ou quatre mois, la plupart d'entre nous ressemblaient-ils à des squelettes.
Accablés de la sorte par les maladies et les souffrances morales, nous ressentions tous les jours de plus en plus les effets manifestes des soins maternels de la Providence. Plusieurs personnes au cœur bon, compatissant, inondaient notre pauvre demeure de tisanes et de remèdes, chacune faisant valoir sa recette comme la plus efficace… Que le bon Dieu et la bonne Mère daignent récompenser tant d'actes de charité !
XIV. – L'Ecole libre.
Depuis le 19 janvier jusqu'au mois de mai 1900, maintes fois j'ai fait des démarches pour obtenir qu'on nous laissât partir pour Cali, alléguant chaque fois notre neutralité politique, notre qualité d'étrangers, l'impossibilité de vivre sans ressources, etc., mais un No sec était toujours la seule réponse obtenue.
Vers le 18 mai, je revins à la charge, avec la résolution de pousser les choses à bout si on ne nous accordait pas nos passeports. Comme d'habitude, on me répondit négativement. Alors, selon le dessein que j'avais conçu, je réclamai la liberté d'ouvrir une école, et, à mon grand étonnement, cette autorisation me fut accordée. Encouragé par ce premier succès, je sollicitai la permission, que j'obtins également, de disposer du local où avait été l'école des filles, ainsi que du mobilier qui s'y trouvait. En conséquence, le Chef révolutionnaire donna des ordres pour qu'on me laissât ramasser ce qu'il y avait encore de mobilier dans la maison de la Mission.
Mes deux jeunes Frères, Romulo et Rosendo, et moi, malgré notre état d'épuisement nous ouvrîmes l'école le 25 mai. Les premiers élèves qui se présentèrent furent le fils du Chef, celui du Maire et deux des principaux radicaux !… Le petit nombre des conservateurs qui avaient de quoi payer – car l'école était payante – nous envoyèrent aussi leurs enfants.
Les libéraux exaltés tentèrent bien de nous faire échouer ; mais ils n'y réussirent pas les maladies seules devaient amener ce résultat. Hélas nous avions trop présumé de nos forces : malgré toute notre bonne volonté et tout notre courage, nous fûmes forcés d'interrompre nos classes à partir du 25 juillet.
XV.– Départ pour les bouches de l'Atrato.
Dans l'impuissance où nous étions de continuer nos classes, je fis de nouvelles démarches en vue de notre départ ; il en fut de même du côté des Capucins dont le ministère était entravé. Mais, après un mois, nos démarches étaient restées sans résultat. Nous en étions là lorsque, dans les premiers jours du mois d'août, le même Turc qui nous avait donné asile au commencement de la révolution, nous offrit de nouveau un refuge dans une propriété qu'il venait d'acheter près des bouches de l'Atrato.
Nous crûmes devoir accepter cette offre, bien que nous, Frères Maristes, eussions préféré un endroit qui nous rapprochâtde nos maisons du Cauca.
Ce bon Turc et ses amis s'entremirent donc pour obtenir la délivrance de nos passeports ; mais on y mit pour condition que les Capucins, au nombre de sept, payeraient chacun 100 piastres en argent. Aux Frères Maristes on ne demandait rien parce qu'ils travaillaient pour le bien du peuple, et qu'on les reconnaissait pauvres.
Cette faveur, accordée aux Frères, m'enhardit à aller plaider auprès du Chef la cause des Pères. A force d'insister, j'obtins que la taxe fût réduite à 10 piastres pour chacun. Un commerçant turc, neveu de celui que je puis appeler notre bienfaiteur, s'offrit à payer les 70 piastres convenues, et les passeports nous furent délivrés.
Les préparatifs du voyage furent entremêlés de quelques difficultés et incidents qui nous obligèrent à user de ruse ou d'audace. Les braves gens gémissaient de se voir abandonnés par les Missionnaires, la seule consolation qui leur restât sous le joug de la tyrannie radicale. Les méchants, au contraire, s'en réjouissaient et redoublaient de haine contre les semeurs du bon grain. Deux libelles infâmes, d'un caractère presque officiel, parurent, jetant l'insulte tour à tour aux Pères et aux Frères.
Enfin, il fut décidé qu'il y aurait deux départs, pour lesquels nous avions un petit bateau appartenant aux Pères, plus trois pirogues que les deux Turcs dont j'ai parlé plus haut mettaient à notre disposition avec des péons (rameurs). Trois Capucins et les trois Frères Maristes devaient faire partie du premier départ, fixé au 8 septembre ; les quatre autres Capucins devaient s'embarquer le 12.
A Quibdo, il est impossible d'organiser un voyage incognito ; aussi, le jour désigné, une grande partie de la population se trouva-t-elle de bonne heure réunie sur le rivage, assistant à nos préparatifs. Quelques figures trahissaient une joie secrète et maligne ; mais la plupart, surtout celles de nos élèves, manifestaient une véritable tristesse. J’en étais profondément ému, car j'aimais ces enfants. Si je n'avais été forcé de quitter cette ville, qui se montrait à nous en ce moment si inhospitalière pour aller chercher ailleurs un peu de liberté et de santé, non jamais je n'aurais pu abandonner cette jeunesse pour ainsi dire sans soutien au milieu de tant de corruption d'idées et de mœurs. Que Jésus et Marie lui soient en aide, en attendant que des jours meilleurs permettent notre retour auprès d'elle !
XVI. – La navigation de l'Atrato et l'incident de Riosucio.
Nos péons s'étant enivrés, un frère capucin et moi, comme étant les moins faibles, nous dûmes transporter dans les embarcations une partie des malles, des provisions de bouche, les marmites, la vaisselle, tous les ustensiles de ménage, sans lesquels on ne voyage jamais plusieurs jours dans ce pays. La plus grande des canoas (embarcations) dans laquelle devaient s'installer sept voyageurs, mesurait environ 0 m. 80 dans sa plus grande largeur, et une longueur d'une dizaine de mètres.
A 4 heures du soir, le 8 septembre, nous laissâmes Quibdo sans que nos ennemis fissent aucune démonstration. Quant à nos amis, de leurs yeux pleins de larmes ils suivaient nos rustiques pirogues, qui bientôt se perdirent dans le lointain. De notre côté, nous nous éloignions silencieux, le cœur partagé entre la joie et la tristesse.
Je dis que nous étions sept : le septième était un jeune homme de Carthagène. Il était venu à Quibdo avec une quantité considérable de marchandises, et en avait vendu une partie quand arrivèrent les révolutionnaires qui lui volèrent le reste et, par leurs exactions, lui extorquèrent tout l'argent qu'il possédait. Il n'avait même pas pu échapper à la prison ; pendant de longs mois il y avait souffert un vrai martyre ; et, comme souvenir des fers qui avaient macéré ses chairs, et du cachot humide qu'il avait habité, il emportait des rhumatismes qui le rendaient à moitié impotent.
A mesure que nous nous éloignions de Quibdo, les malades se sentaient mieux et paraissaient reprendre leurs forces. Nous en étions à quelques milles lorsque nous rencontrâmes un Yankee bien connu de nous tous. Il venait avec trois grandes barques chargées de denrées et d'autres marchandises. Nous nous informâmes auprès de lui de la situation politique, et, sur notre demande, il nous promit qu'à son retour, il mettrait à notre disposition sa plus grande barque pour continuer notre voyage de Santatà à Carthagène.
La nuit venue, nous nous arrêtâmes dans une cabane de nègres, où l'on nous prépara une abondante soupe de bananes (sancocho) que tous les malades mangèrent de bon appétit et sans en ressentir aucun malaise.
Le 9, un peu avant midi, nous passâmes à Paina, lieu stratégique où un détachement armé attendait depuis bientôt deux ans les bateaux du Gouvernement ! Puis, bien tard, dans la nuit, nous atteignîmes un petit pays appelé Beté, où des nègres déchargèrent notre pirogue et nous aidèrent à franchir la terrible montée qui sépare le fleuve des premières maisons. Dans le même temps, deux femmes se mettaient en quatre pour aider à un frère Capucin dans la préparation du souper, qui consistait dans l'historique soupe de bananes, peu attrayante peut-être pour des gourmets, mais que la faim nous fit trouver excellente. Après ce modeste repas, chacun s'installa le moins mal possible pour prendre un peu de repos. Ainsi devaient se passer les choses dans le reste de notre long et périlleux voyage.
Les autres villages que nous avons rencontrés sur les rives de l'Atrato sont : Vigia del Fuerte, Vigia de Curbarado et Riosucio. Partout nous avons fait une halte de quelques heures, et les Pères y ont administré le baptême à quelques adultes et à un bon nombre d'enfants. Ces braves gens ont fait preuve envers nous d'une bonté vraiment touchante, en nous apportant les quelques poulets et les quelques oeufs qui avaient échappé à la rapacité des troupes radicales.
A Curbarado, nous rencontrâmes un groupe d'insurgés déjà célèbres par leurs brigandages tellement qu'à Quibdo, les honnêtes gens nous avaient souhaité la bonne chance de ne pas les rencontrer. Nous passâmes la nuit en cet endroit sans que ces malfaiteurs eussent l'air de s'occuper de nous; mais au moment de notre départ, ils déposèrent, sans que nous y prissions garde, dans notre canoa de charge, une caisse de pétrole; et contrairement à la résolution qu'ils avaient prise de se rendre à Quibdo, nous les vîmes nous devancer dans la direction de Riosucio, oùils arrivèrent à 7 heures du soir, deux heures avant nous. Ce pays comptant trois ou quatre maisons de conservateurs, nous logeâmes dans l'une d'elles, où l'on nous accueillit et l'on nous soigna d'une manière très charitable et très délicate.
Le 17 septembre, un peu avant dîner, le jeune homme (Martelo) que nous avions accepté pour le compagnon de voyage, demanda au chef de nos péons de l'accompagner chez une connaissance pour régler certaines affaires. Dans cette journée, ils rencontrèrent les malfaiteursqui nous avaient devancés la veille, et avec eux plusieurs nègres. Ces bandits invitèrent notre péon à s'unir à eux ; et, comme il leur demandait ce qu'ils se proposaient, ils lui répondirent en présence de Martelo de manière à faire comprendre que leur intention était de s'emparer des Capucins et des Maristes, et de se livrer à leur égard à des infamies dont l'idée ne saurait naître que dans les cœurs les plus pervers. La chose a parti à notre péon tellement monstrueuse que, quoique criminel de profession et échappé de prison, il a refusé tout d'abord de prendre part au complot ; je dis tout d'abord parce que, plus tard, l'eau-de-vie lui enleva ses scrupules.
Quand Martelo fut rentré au logis, il s'assit à table auprès de moi pour dîner et me dit à l'oreille quelques mots de ce qu'il avait entendu. Il ne put presque pas manger, tant il était consterné de nous voir ainsi exposés aux plus graves outrages, sans pouvoir prendre notre défense, à cause de ses infirmités. Pour moi sans me laisser intimider, je pris la résolution de résister aux agresseurs et de me faire tuer plutôt que de tomber vivant entre leurs mains. Aussitôt j'envoyai dans le bois celui de nos péons qui paraissait le moins abruti, pour y couper une huitaine de solides gourdins ; lorsqu'il les eut apportés, je tâchai de le gagner à ma cause ; mais je m'aperçus bientôt que je ne devais pas compter sur lui: il ne tarda pas, en effet, à aller rejoindre ses compagnons qui buvaient avec les conjurés, et leur annoncer que nous nous armions. Comme ils avaient laissé avec nos bagages deux fusils chargés et deux grands coutelas, je m'en emparai bien vite et je complétai l'armement avec une hache. Tous, Capucins et Maristes, nous étions résolus à nous défendre jusqu'à la mort.
L'heure de partir était arrivée et aucun de nos hommes ne se présentait ; ce ne fut que vers 5 heures que nous pûmes en attraper deux, dont un Antioqueno qui n'avait jamais gouverné une canoa. Nous les obligeâmes à préparer le départ et à s'embarquer. Un individu de la bande vint guetter nos mouvements; il s'assit, à quelques pas de nous, tenant un revolver entre les mains, et s'approcha plus près de nous en nous voyant prendre place dans l'embarcation. Alors, d'un ton élevé et ferme, je lui demandai ce qu'il désirait ; il se contenta de réclamer humblement la caisse de pétrole qui était dans notre canoa; je la lui montrai de la main en lui enjoignant de l'emporter, ce qu'il exécuta. Sans perdre un instant, nous unîmes nos forces à celles de nos deux rameurs improvisés pour diriger notre embarcation au milieu du fleuve ; et nous nous mîmes à naviguer à la vue des conjurés et en faisant la sourde oreille aux cris du chef de nos péons, qui voulait nous faire revenir. Mais, afin d'éviter toute surprise, il fut décidé que nous ferions sentinelle nuit et jour à tour de rôle. Grâce à Dieu, nous pûmes continuer notre chemin sans être inquiétés.
Le 18, à 4 heures du soir, nous arrivions en face de Santatà, où nous abordâmes par un petit canal traversant un marais et des lagunes. Nous 3, fûmes bien reçus par le régisseur qui nous attendait depuis quinze jours.
XVII.– Santatà et voyages à Carthagène.
La Finca (vaste propriété rurale) de Santatà, la seule qui soit de rapport et qui ait du bétail dans la vallée de l'Atrato, appartenait à un conservateur qui, l'ayant vu ravager deux fois par les révolutionnaires, l'avait vendue au Turc qui nous y offrait l'hospitalité. Celui-ci n'y avant rien organisé, elle ne pouvait pas nous offrir beaucoup de ressources ni de commodités. Heureusement, le Noviciat de Quibdo nous avait rendus fort peu exigeants. Nous comptions d'ailleurs sur les promesses du Yankee, et nous ne pensions séjourner là que quinze à vingt jours. Nous l'attendions donc patiemment lorsqu'un beau matin nous apprenons que la barque promise était passée pendant la nuit.
Peu de temps après, nous recevions une lettre de Carthagène, par laquelle le P. Antonio, supérieur des Capucins de Quibdo, nous engageait à prendre patience encore quelques jours au Choco, parce que le Gouvernement ne tarderait pas à y envoyer des forces pour faire tout rentrer dans l'ordre. Cette espérance nous fit manquer plusieurs occasions de sortir de notre triste position. Nous attendîmes en vain pendant deux mois, souffrant la faim, le dénuement le plus complet et la maladie. Nous n'avions presque pour nourriture que des racines que nous allions nous-mêmes déterrer dans les bois et quelques fruits que nous trouvions çà et là ; très rarement nous avions de la viande ou du poisson ; la nécessité nous donna même assez de courage pour manger du singe, et non du moins dégoûtant ! Malgré tout, nous étions contents, tant nous trouvions douce la liberté dont nous jouissions.
Les espérances que nous avait fait concevoir la lettre du P. Antonio ne se réalisant pas, et aucune barque assez grande ne se présentant pour nous transporter tous, il fut décidé qu'un Capucin et moi nous partirions pour étudier la situation, travailler au salut des autres et tâcher de nous procurer des vivres, des habillements et des remèdes, afin d'adoucir l'amertume des jours d'exil qu'il faudrait encore subir.
Depuis les bouches de l'Atrato, nous fîmes la traversée jusqu'à Carthagène en cinq jours. Le bon Dieu nous favorisa d'un temps magnifique. Nous n'eûmes guère à souffrir qu'au sortir du golfe d'Uraba, où notre fragile barque, bousculée par des montagnes d'eau, faillit sombrer.
Arrivés à Carthagène, nous ne trouvâmes que déception le supérieur des Capucins était parti pour Costa Rica, le Gouvernement était tout occupé de la guerre qui avait alors pour principal théâtre le département de Bolivar, et la navigation dans la direction de l'Atrato venait d'être formellement interdite. Le Capucin qui m'accompagnait, découragé, alla rejoindre son supérieur à Costa Rica. Quel désappointement pour moi ! Une lettre du C. F. Assistant, que je trouvai à Carthagène, fut cependant pour moi une douce consolation et un grand encouragement.
Grâce à Dieu et à la bonne Mère, au lieu de me laisser abattre par tous ces contretemps, je m'enhardis à aller trouver toutes les autorités ecclésiastiques, civiles et militaires, pour obtenir les moyens de délivrer, ou au moins de soulager les pauvres captifs du Choco. Je trouvai partout et en particulier chez Mgr l'évêque Brioschi, bon accueil et bonne volonté ; mais tout se borna à des promesses et à des espérances. Je dus passer là deux longs mois dans les angoisses. Il y avait heureusement dans la ville des Pères de la Compagnie de Jésus, comme gardiens du sépulcre de saint Pierre Claver. Ils m'ont donné pendant ce temps la plus charitable hospitalité ; j'ai de plus reçu d'eux 100 piastres comme aumône, et, par leur intermédiaire, 200 de Monseigneur.
Enfin, dans les premiers jours de février, le Gouvernement mit à ma disposition un petit remorqueur armé en guerre et monté par une quarantaine d'hommes. En même temps arriva de Costa Rica le P. Antonio que je décidai à m'accompagner. Nous partîmes le 6 février, emportant des provisions de toute nature. Pendant la seconde nuit de navigation, nous fîmes fausse route, et, quand vint le jour, nous étions en haute mer, ballottés par des vagues gigantesques. Oh ! qu'une telle situation est propre à élever l'âme à Dieu et à inspirer au cœur de pieux sentiments ! Comme on se sent petit, et que la vie paraît frêle au milieu des immensités de l'océan courroucé !
Ce ne fut qu'à 10 heures du matin que la terre se montra par un point noir qui apparut à l'horizon : c'était le Cerro del Aquila qui limite au nord-est le golfe d'Uriba. A quelques milles plus au sud de ce point, notre petit bateau s'approcha de la côte pour saluer par une fusillade Nicocli, petit pays occupé par les révolutionnaires. N'ayant pas reçu de réponse, il continua sa route.
Le 9, vers midi, nous étions en face de Santatà. Quelques nègres ayant donné l'éveil de l'approche d'un vapeur, nos Frères qui étaient encore là, comprirent immédiatement ce que ce pouvait être. Aussi n'étions-nous pas encore à terre que nous voyons accourir ces squelettes ambulants, pieds nus et les soutanes en lambeaux. Quel heureux moment pour eux et pour moi! Vous auriez été touché de nous voir nous jeter délirant de joie dans les bras l'un de l'autre. Ce fut une véritable fête pendant les deux jours laissés à notre disposition avant de nous embarquer pour Carthagène.
Le 11, nous couchâmes à bord, les trois plus malades dans une des deux cabines du bateau, les autres à la belle étoile. Le 12, de bon matin, nous parcourûmes à grande vitesse les quelques lieues qui nous séparaient de la mer. Déjà bien rassurés contre la tyrannie des caciques de Quibdo, nous contemplions dans la paix et le ravissement l'indescriptible beauté de la région inférieure de l'immense vallée de l'Atrato. Des nuées d'oiseaux aux brillantes couleurs, et des troupes de singes animaient ces rives désertes d'habitations humaines et égayaient la majesté des multiples touffes de palmiers parsemées dans cette interminable plaine, presque entièrement inondée par les eaux du fleuve.
Ainsi charmés par la beauté des spectacles de la nature, nous arrivâmes à l'océan sans nous en apercevoir. Mais peut-être jouissions-nous trop sensiblement des dons de Dieu, et ne pensions-nous pas assez à lui rendre les actions de grâces qu'il avait droit d'attendre de nous : en tout cas, quelques petites épreuves bien propres à modérer notre joie nous étaient encore réservées.
A la limite des eaux du fleuve et de celles de la mer, notre petit bateau s'ensabla, et il ne put être renfloué qu'après six heures de manœuvres. A peine sortis de cet embarras, nous eûmes à subir un bien plus fâcheux contretemps. Comme nous étions dans la baie de Turbo, vers une heure du matin, une forte secousse se produisit dans la proue du bateau, et après examen on constata que l'hélice avait disparu. On sonda, pendant onze jours, une grande étendue de la baie, et les recherches restèrent sans résultat. Le onzième jour, un détachement de notre garde, qui avait été à la recherche d'aliments dont nous étions dépourvus, captura une barque de contrebandiers, qui servit providentiellement à transporter les missionnaires à Carthagène. Quatre hommes armés nous accompagnèrent dans le trajet. Cinq jours de la plus heureuse navigation nous dédommagèrent amplement de tout ce que nous avions souffert à Turbo.
Arrivés à Carthagène dans la nuit du 28 février au 1ier mars, nous fûmes de nouveau reçus chez les Révérends Pères Jésuites, et ils nous témoignèrent d'autant plus de joie en nous voyant, que depuis deux semaines, M. le Gouverneur, mal informé, leur avait annoncé que nous avions fait naufrage et péri tous, près du Cerro de Aquila.
Les huit jours qui ont suivi notre arrivée, nous les avons employés à préparer notre voyage à Cali par Colon et Panama. Pendant ce temps, trois Capucins se sont placés dans une paroisse du diocèse de Carthagène, en attendant que la situation leur permette de retourner à Quibdo.
Les quatre autres, dont deux devaient se rendre à Costa Rica et deux à Pasto, se sont embarqués avec nous le 8 mars, sur le transatlantique français, Alexandre Bixio. Nous avons payé 15 francs chacun, sur le pont. 200 soldats colombiens se sont embarqués avec nous à Carthagène, et 200 autres à Sabanilla. Le trajet entre ces villes a été extrêmement pénible, ensuite très heureux jusqu'à Colon, où nous avons débarqué le 12, après avoir fait nos adieux aux deux Capucins qui allaient à Port-Simon. Pour le passage de l'isthme, M. le Préfet de Colon a bien voulu nous accorder des places gratuites en 1ière classe. A peine arrivés à Panama, on nous annonce qu'un bateau va partir pour Buenaventura. Nous nous empressons de profiter de ce départ et de la réduction du tiers que nous accorde M. le Gouverneur sur le tarif des passages.
Le 15 mars, nous étions à Buenaventura, où nous nous sommes séparés des deux Capucins qui allaient à Pasto. Enfin, le 23, nous arrivions à Cali, auprès de nos chers Confrères qui, si longtemps privés de nos nouvelles, avaient éprouvé tant d'inquiétudes sur notre sort. Quel heureux moment ! Quelle joie inondait nos cœurs en revoyant des Frères bien-aimés, après tant de dramatiques et mémorables péripéties ! C'est ce que ma plume est impuissante à vous dépeindre.
Et que rendrons-nous au Seigneur pour la protection dont il nous a entourés pendant ces longs jours d'épreuves ? Ah! quelle douce et consolante expérience nous avons faite du soin qu'il prend de ses serviteurs, des enfants et des protégés de la Vierge Marie ! Parmi ses nombreux bienfaits, je me plais à citer l'assistance religieuse que nous avons toujours trouvée auprès des bons Pères Capucins. C'est à ces sources fécondes des sacrements et de la prière que nous avons puisé le courage et la force dont nous avions tant besoin au milieu de nos épreuves. A Dieu donc nos actions de grâces, notre amour, nos travaux, notre zèle, toute notre vie !
Mais je n'ai garde d'oublier ceux que Dieu dans sa bonté, a suscités pour nous secourir, pour nous faire du bien dans nos jours de détresse. A eux aussi l'expression de notre reconnaissance. Que Dieu se souvienne de leurs bienfaits envers nous, qu'il les en récompense libéralement et en ce monde et en l'autre !
Maintenant, mon Très Révérend Frère, il faut que je vous dise deux mots de notre Œuvre à Quibdo.
Les événements qui se sont déroulés à nos yeux, nous ont mis à même d'apprécier, au moins en partie, les résultats de notre mission dans ce pays. Or, je ne crois pas me faire illusion en disant que, Dieu aidant, nous n'avons pas travaillé en vain. Nous avons observé avec satisfaction, en effet, que, nonobstant toutes sortes d'obstacles et de circonstances défavorables, le bon grain que nous avons semé n'est pas resté infructueux. Nos élèves nous en ont donné les preuves les plus consolantes, par leur assistance volontaire à la messe les dimanches et les jours de fête, par la fréquentation dessacrements, et par leur respect et leur attachement à l'égard des Frères. Je puis ajouter que les familles, en général, nous ont manifesté une confiance qui n'a pas peu contribué à rendre notre tâche moins ardue. Voilà pour le côté moral.
Quant au matériel de l'école, il est en partie détruit ou volé. Ce qui reste est en dépôt chez un habitant de Quibdo, qui est de nationalité française.
Le local que Mgr l'évêque de Popayán faisait construire à ses frais pour l'école des Frères est presque terminé ; nous y avions déjà installé deux classes. La position ne laisse rien à désirer; les paysages d'alentour sont vraiment remarquables par les beautés et les richesses qu'y étale la nature.
Rome vient d'ériger le Choco en Vicariat apostolique ; les Révérends Pères Capucins n'attendent que la pacification du pays pour y retourner.
Que vous dirai-je de vos Petits Frères ? Parlez : ils sont prêts à exécuter vos ordres comme étant l'expression de la volonté de Dieu ; ils se sentent encore assez de courage pour retourner à Quibdo et, avec l'aide de Dieu et la protection de Marie, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réparer les ruines accumulées par la révolution.
Je termine en vous priant de me bénir et d'agréer l'hommage du plus profond respect avec lequel je suis, Mon Très Révérend Frère Supérieur, Votre très humble et très obéissant serviteur,
Frère MANUEL
DERNIÈRES NOUVELLES
D'après une lettre du C. F. Candidien, Visiteur, en date du 1ier novembre, la révolution continue à ravager la Colombie et achève de la plonger dans la misère. Le change était alors de 5.000 %. Cependant les dix écoles restant encore sous la direction des Frères fonctionnaient et réunissaient un bon nombre d'élèves. Mais les traitements n'étaient pas payés bien régulièrement : les caisses du Gouvernement sont à sec. Malgré leurs privations les Frères ne se découragent pas et sont bien à leur affaire.
BRÉSIL.
Déjà, M. T. C. F., les précédentes circulaires vous ont entretenus de nos Missions du Brésil, notamment à l'occasion de la mort du cher et regretté F. Norbert. Depuis ce douloureux événement, deux fondations qui ne manquent pas d'importance sont venues s'ajouter à l'établissement de Congonhas, le premier fondé, dans l'Etat de Minas : celles de Saint-Paul dans l'Etat de ce nom, et de Born Principio dans l'Etat de. Rio Grande do Sul. Cette dernière se trouve au sein d'une colonie allemande desservie par des Pères de la Compagnie de Jésus. D'autres fondations se préparent dans ces trois Etats.
Nous avons donc au Brésil un District en formation, pour lequel nous avons dû songer à l'envoi d'un Visiteur. C'est le cher F. Adorator, précédemment Directeur du pensionnat de Saint-Pourçain, qui au mois d'août dernier, a été nommé pour en exercer les fonctions. Il s'est embarqué à Marseille, le 24 septembre, sur le paquebot la Provence, pour se rendre à sa nouvelle destination, avec le C. F. Joseph-Damase et le C. F. Marie-Chrysophore. Je crois vous être agréable en vous donnant ici des extraits des lettres qu'il nous a adressées.
V. J. M. J.
A bord de la Provence, le 3 octobre 1901.
Très Révérend Frère Supérieur,
Je vous écris des hauteurs du pont, dans les oscillations du vaisseau. Vous excuserez donc le décousu de ma lettre, aussi bien dans les pensées que dans la forme matérielle.
Notre traversée jusqu'ici, sans être orageuse, n'a pas été fort calme. Dès le premier jour, la moitié des passagers n'a pas paru à table. Nous avions aussi une victime dans notre petite communauté: le Jeune F.Marie-Chrysophore. Et comme ce sont toujours les mêmes qui se font tuer, ce sont aussi toujours les mêmes qui ont le mal de mer: le Frère en a fait l'expérience pendant la traversée très mouvementée de Gibraltar à Dakar.
Le F. Joseph-Damase et moi, bien qu'à l'abri des grandes manifestations extérieures du mal de mer, nous en avons souffert par l'estomac, la tête, un malaise général qui diminuait chez nous les charmes de la traversée.
Il est en ce moment midi, et demain vendredi, vers les 10 heures, nous ferons escale à Dakar, mais nous ne descendrons pas à terre. Je remettrai donc cette lettre au commissaire et j'espère qu'elle vous parviendra.
Aujourd'hui le temps est beau, et la communauté est tout à fait sémillante et de bonne humeur : vous pouvez donc être tranquille sur vos Frères faisant voile pour le Brésil…
Nous prions beaucoup, le plus souvent en communauté ; à nos exercices de Règle nous ajoutons le Rosaire. Nous avons du reste pour nous édifier sept Religieuses Dominicaines qui se rendent à Uberaba. Elles sont d'une piété angélique. Hier au soir, sur le pont, comme du reste chaque jour, elles ont chanté leurs cantiques de communauté, en groupe et très discrètement, ce qui n'empêche pas quelques dames pieuses de les écouter de près. Une dame protestante, venant de Lausanne, s'est placée hier tout à côté des Sœurs au moment où elles chantaient ; elle paraissait hypnotisée ; après quelques instants, elle pleurait à chaudes larmes. Le spectacle, du reste, était ravissant : le soleil se couchait dans les feux du soir; l'occident se nuançait de mille teintes qui s'effaçaient peu à peu, et sur le vaisseau, des religieuses chantaient les louanges de Celle qu'on appelle l'Etoile de la mer. La scène que nous avions sous les yeux me paraissait plus belle que celle qu'a si bien décrite Chateaubriand.
Et vos Frères, Très Révérend Frère Supérieur, que faisaient-ils en ce moment ? Ils priaient, le regard tourné vers l'occident. Et lorsque plus tard, la nuit eut étendu ses voiles sur la mer, à notre tour nous nous mîmes à chanter l'Ave maris Stella et quelques cantiques à Marie. Nous pensions à notre famille religieuse, à la patrie, à nos chers parents, et l'émotion nous gagnait…
Il nous est bien dur d'être privés de la messe et de la communion… Nous comptons sur les bonnes prières de la communauté.
Tous trois nous vous saluons très respectueusement, Très Révérend Frère Supérieur, et nous vous assurons de notre filial attachement.
F. Adorator.
Congonhas do Campo, le 20 octobre 1901.
Mon Très Révérend Frère Supérieur,
Me voilà donc à Congonhas ! Ce voyage qui me paraissait ne devoir jamais finir, est enfin terminé ! Que vous dire en ce moment, où les idées et les impressions de toute nature s'entrechoquent dans ma personne, encore, toute ballottée par quatre semaines de voyages ?
Grâce à Dieu, je n'ai rien de désagréable à vous annoncer. Je suis bien heureux d'avoir retrouvé une famille de bons Frères. Il règne dans la maison de Congonhas un esprit de famille délicieux ; les enfants ont bonne façon : ils ont l'air d'être tout à fait chez eux, et ils vous regardent avec deux yeux honnêtes et doux qui inspirent l'affection et la confiance…
Mais il faut que je vous dise quelque chose des péripéties de notre voyage.
Ma dernière relation a été déposée au secrétariat du bord, le 13 octobre. Nous étions en ce moment tout près de Rio de Janeiro; mais lorsque nous sommes arrivés le dimanche 13 octobre, à 5 heures du soir, à l'entrée de la rade, on nous a ordonné d'aller à Ilha Grande, où nous sommes arrivés le lendemain. Là, on nous a laissé languir des heures entières sans répondre à nos signaux. Enfin la Santé paraît et nous dit qu'elle va télégraphier à Rio pour savoir comment il faut nous désinfecter. Il n'y avait pourtant aucune maladie à bord; mais ces messieurs de la Santé sont tout-puissants, et ils se plaisent à le faire voir. Il y avait dans la baie cinq navires logés à notre enseigne.
Dans la soirée, on vient avec du soufre et des chaudrons et on commence l'opération ; mais on en exempte les cabines de 1ière et de 2nde classe. La nuit arrive, point de départ : nos officiers n'avaient reçu aucun ordre et ne savaient quand nous pourrions partir; le commandant rageait. Nous avions heureusement pour nous désennuyer un panorama superbe, puis la promenade imposante des requins, les gambades des marsouins, les allées et venues du vapeur de la Santé qui multipliait ses visites sur les autres navires.
Pourtant, vers le soir, on nous signe nos passeports mais, au lieu d'aller à Rio où l'on a remarqué quelques cas de peste, pour éviter la quarantaine, nous nous sommes rendus à Santos, où nous avons débarqué le lendemain matin. Là, nous apprenons qu'en trois heures on peut aller à Saint-Paul, et que les Sœurs dominicaines se disposent à s'y rendre. Nous étions hésitants sur ce que nous devions faire lorsqu'une dame, qui était sur le port attendant les Sœurs, est venue nous inviter, ou plutôt nous forcer à les suivre, en nous disant qu'elle se chargeait de tout. Elle nous conduit alors chez deux bonnes dévotes de ses amies qui tiennent une école libre, nous fait monter en première, et, après avoir payé nos places, nous donne à chacun notre billet, en refusant absolument que je lui rembourse ce qu'elle a payé.
Cet accueil si hospitalier, fait à vos Petits Frères à leur arrivée sur la terre brésilienne, était, vous le reconnaîtrez, mon Très Révérend Frère, pour eux un bien bon augure. Espérons que l'avenir ne le démentira pas.
Pour en revenir à cette dame, ou plutôt à cette demoiselle, je vous dirai que c'était une créole d'une grande piété qui m'a paru connaître tous les évêques et toutes les religieuses du Brésil. Elle a fait la classe longtemps chez les Sœurs de Saint-Vincent, et elle parle bien le français. Dans ce qu'elle dit ou fait, elle a un air de virilité, un air résolu et cavalier qui semble ne permettre aucune réplique à ce qu'elle veut. – « Vous reviendrez demain, nous dit-elle ; j'ai parlé au capitaine qui m'a dit que votre paquebot ne partira qu’à 3 heures. »
Nous voilà donc partis pour Saint-Paul. Le paysage à travers les montagnes que nous escaladons par un funiculaire est d'un aspect féerique. C'est une végétation nouvelle, véritablement luxuriante. Il serait impossible de faire deux pas dans ces fourrés inextricables. Çà et là des arbres et des arbrisseaux au feuillage varié sont couverts de fleurs, et, semblables à des azalées arborescentes, font de la montagne un gigantesque bouquet de fleurs.
Nous arrivons à Saint-Paul. A la gare, nous trouvons le C. F. Andronic, agréablement surpris de nous voir là si inopinément. Avec quel bonheur on s'embrasse ! et quelle joie on éprouve, après trois semaines de traversée, en revoyant un Frère à 10.000 kilomètres de la mère-patrie !
Arrivés à la maison, nous trouvons une communauté bien aimable, bien gaie, qui nous fait l'accueil le plus cordial.
Après quelques heures passées délicieusement à Saint-Paul, nous avons repris le chemin qui devait nous conduire à Rio. A notre arrivée, le 18 octobre, à Il heures du matin, nous apercevons sur le port le C. F. Frumentinus qui nous attendait. A 5 heures, nous prenons avec lui le chemin de fer, et le lendemain, à 7 heures du matin, à notre descente de wagon, nous trouvons au débarcadère deux Frères, un domestique et sept mules toutes harnachées.
Il s'agissait donc de nous servir de ces mules pour nous rendre à Congonhas. Cela paraissait être une partie de plaisir pour tous mes compagnons de voyage. Mais pour moi… c'était mon premier essai d'équitation, et quel essai ! Une effrayante chevauchée à travers des précipices de toute sorte. Ce n'est pas sans trembler quelque peu que j'ai mis le pied à l'étrier… Cependant je me hâte d'ajouter que le voyage ne fut pas plus malheureux pour moi que pour les autres, et que j'arrivai sain et sauf à destination.
Me voici donc à Congonhas, et au moment où je vous écris, je reviens de la messe célébrée à l'église du Bon-Jésus. Les enfants et les Frères l'ont chantée. Il y a bien quelques voix qui ont besoin d'être perfectionnées mais dans l'ensemble ce n'est pas mal.
Dans l'assistance, j'ai remarqué autant d'hommes que de femmes, de nègres que de blancs. Leur tenue, comme celle de l'officiant (un créole) est respectueuse et digne.
Les hommes qui vont à l'église sont tous porteurs d'un bâton, d'un mouchoir et d'un grand coutelas renfermé dans une gaine : le bâton, pour s'appuyer quand ils sont à genoux ; le mouchoir, pour préserver alors leur pantalon de la poussière ; le coutelas (leur arme favorite), pour se frayer, au besoin, un chemin dans les forêts vierges, ou se défendre dans les rencontres dangereuses.
J'ai passé ma première nuit à Congonhas. Ce matin, je me suis levé encore harassé, brisé, mais néanmoins en bonne santé. Ah ! si je pouvais parler portugais, comme je serais heureux, même à 10.000 kilomètres de tous ceux que je porte dans mon cœur !
Il nous faut des sujets à tout prix : il y a là une belle situation à conquérir.
A Santos, ville de 60.000 âmes, très bien située et dans un état de salubrité excellent, par suite d'importants travaux d'assainissement, il n'y a qu'un curé, qui n'a pour l'aider dans son ministère ni Frères ni Sœurs.
On a dû vous écrire pour Rio de Janeiro, puis pour un nouvel établissement à Saint-Paul. La moisson est grande : le Maître suscitera des ouvriers, espérons-le.
Il faut que je vous dise un mot de la température que nous avons eue depuis notre départ. Jusqu'à présent nous n'avons pas souffert de la chaleur. Pendant notre traversée nous n'avons eu que 28 à 300. Aujourd'hui le temps est très clair et le soleil chauffe passablement. Le printemps commence, les oiseaux chantent à l'aube du jour dans les bois qui nous avoisinent, et, par leursconcerts, rappellent aux Petits Frères de Marie qu'au Brésil comme en France, de leur cœur doit s'élever sans cesse vers le ciel l'hymne de l'adoration, de l'amour et de l'action de grâces.
C'est sur cette pensée que je termine ma lettre en me recommandant aux prières de la Maison-Mère, et en vous offrant, mon Très Révérend Frère Supérieur, l'hommage du profond respect et du filial attachement de tous les Frères de Saint-Paul et de Congonhas, avec l'expression de leurs sentiments respectueux et affectueux pour tous les chers Frères du Régime.
Je suis, mon Très Révérend Frère, avec une entière soumission, etc.
F. Adorator.
BOM PRINCIPIO.
L'établissement de Born Principio, fondé en 1900, est situé dans l'Etat de Rio Grande do Sul, qui a pour capitale Porto Alegre (55.000 habitants), ville qui se trouve au centre géographique de la contrée.
L'Etat de Rio Grande est un des plus florissants du Brésil, à cause des nombreux colons Allemands, Italiens, Français, Suisses, Polonais, Russes, etc., tous travailleurs, amis de l'ordre et de la paix. La Constitution qui régit ces peuples est celle des Etats-Unis.
Les Frères ont à leur disposition une propriété immense qui comprend prairies, bois, verger, jardin potager. Ils y cultivent haricots, pommes de terre, patates, manioc, maïs, canne à sucre, courges, melons, riz. Le sol est très fertile et donne, sans engrais, deux et quelquefois trois récoltes par an.
Le climat est excellent, un peu chaud en été, mais, à part cela, très sain, nullement sujet aux fièvres ou maladies contagieuses.
La Mission de Bom Principio est entièrement allemande. D'après le témoignage du C. F. Weibert, directeur, les habitants, de même que les enfants, se distinguent par la simplicité et la pureté de leurs mœurs, ainsi que par leur attachement à la religion, leur zèle et leur fidélité à pratiquer ses enseignements et ses préceptes. Aussi ces braves colons ont-ils accueilli les Frères avec bonheur, et ont-ils décidé de faire construire et de leur confier un vaste établissement, où les enfants de la colonie pourront recevoir un enseignement primaire professionnel, avec l'éducation religieuse.
L’œuvre confiée à nos Frères dans cette partie du Brésil leur a donc procuré déjà de bien douces consolations ; elle leur donne de plus de belles espérances pour l'avenir, celles mêmes que Mgr Claude Gonçalves, évêque de Rio Grande, exprimait dans une lettre du 29 juillet 1900, adressée au C. F. Climaque, Assistant.
« Bom Principio, écrit-il, veut dire bon commencement. – Connaissant votre communauté et les besoins et les dispositions de mes diocésains, j'espère que ce bon commencement (de la mission des Frères) aura des progrès admirables, pleins de consolations et pour la communauté et pour ce diocèse.
« Ayez la bonté, mon très cher Frère, de remercier de ma part le T. R. F. Théophane, de l'assurer des heureux résultats de la nouvelle fondation, et de le prier instamment de ne point craindre d'envoyer de nombreuses colonies de vos chers Frères en ce diocèse. C'est un pays nouveau, il est vrai, où n'existent pas encore ces fortunes colossales capables de fondations considérables ; mais toutes les bonnes oeuvres y prennent racine et se développent en peu de temps. Les bénédictions du Seigneur sont abondantes…
AUTRES FONDATIONS PROJETÉES DANS L'ETAT DE
RIO GRANDE.
Trois nouvelles fondations se préparent dans l'Etat de Rio Grande, savoir : 1° Une école primaire supérieure (portugaise-allemande), à San Leopoldo[2], à 25 kilomètres environ de Porto Alegre. L'ouverture en est fixée au mois de janvier 1902 ;
2° Une école allemande-portugaise, à Porto Alegre, dont les Frères doivent prendre prochainement la direction.
3° Une école primaire à Conde d’Eu, colonie italienne desservie par les Pères Capucins. On se propose de l'ouvrir en septembre 1902.
En vue de ces fondations, quatre Frères – F. Paulinien, F. Henri-François, F. Marie-Laurentin et F. Henri-Frédéric – se sont embarqués le 15 novembre dernier, à Hambourg, sur le paquebot le Taquary. D'autres départs de Frères auront lieu, s'il plaît à Dieu, vers la fin de la présente année, et en septembre 1902.
A l'occasion du départ du 15 novembre, je me plais à citer ici deux lettres d'un caractère particulièrement religieux et filial, écrites par le C. F. Paulinien.
Nanterre, le 29 octobre 1901.
Mon Très Révérend Frère Supérieur,
Comme je n'ai pas eu le bonheur de vous voir à la retraite et de vous faire mes adieux avant de partir pour le Brésil, je viens d'abord vous remercier de la faveur que vous m'avez faite en m'envoyant en mission, et ensuite vous dire que loin de la France, je vous serai toujours très uni et très fidèle.
Certes, c'est un grand sacrifice pour moi de quitter mes bien-aimés parents, mes chers enfants de Nanterre, les bons Frères de la province du Nord et de nombreux amis ; mais un sacrifice non moins pénible est celui de ne pouvoir vous embrasser avant de quitter notre cher pays.
Il est plus que probable que nous ne nous reverrons plus en ce monde. – Que Dieu bénisse encore ce sacrifice ! – Mon Très Révérend Frère Supérieur, je ne vous oublierai pas dans mes prières. Je demande et je ne cesserai de demander au bon Dieu qu'il bénisse toutes vos entreprises, qu’il vous console dans vos afflictions, et qu'il continue à vous aider à bien gouverner notre cher Institut, à la tête duquel il vous a placé depuis de longues années. Que la Sainte Vierge Marie vous conserve tous les bons Frères dont vous êtes le père, et qu'après une vie si bien remplie, vous receviez dans le ciel la couronne que Dieu accorde à ceux qui ont bien combattu.
Ces vœux, je les déposerai aux pieds de la Sainte Vierge dans son beau sanctuaire de Notre-Dame des Victoires, et dans le Cœur de Jésus, à Montmartre.
J'ai fait mes adieux à ma bonne mère, âgée de 73 ans, à mes trois sœurs et à ceux des bons Frères de la province du Nord que j'ai vus à la première retraite. Pendant la grande retraite, je suis allé faire mon service de vingt-huit jours.
Je quitte donc la France après avoir rempli tous mes devoirs.
J'espère que Dieu m'aidera à faire un peu de bien dans ces pays lointains ; et pour cela je vous supplie de penser à mes confrères et à moi dans vos bonnes prières. Nous n'avons pas de plus grand désir que celui de répondre à vos intentions et de faire toutes choses pour la plusgrande gloire de Dieu.
Je suis avec un profond respect et une entière soumission, etc.
F. Paulinien.
A bord du Taquary, le 20 novembre 1901.
Mon Bien Cher Frère Assistant,
Comme nous allons faire escale à Lisbonne, nous nous faisons un plaisir de vous donner signe de vie.
D'abord je vous dirai que nous allons tous bien et que tout va bien. Deo gratias !
Nous nous sommes embarqués le 15 novembre, à 2 h. ½. Notre vaisseau a belle apparence, c'est un steamer qui a 92 mètres de long, 13 mètres de large et 10 de profondeur. Nous sommes à peine 50 passagers, dont 15 seulement en 1ièreclasse, le reste pêle-mêle en 3e. Le chargement en marchandises est, dit-on, très considérable.
Au dire des officiers, notre navire est un de ceux qui offrent le plus de tranquillité aux passagers. Je veux bien le croire ; toutefois notre cabine n'est pas des plus confortables sous le rapport de l'espace ; nous n'y sommes pas à l'aise quand nous nous y trouvons tous les quatre.
A bord, tout le monde parle allemand. Le propriétaire et le capitaine sont pour nous pleins d'égards. Ce dernier paraît aussi brave homme que bel homme.
Le 16, à midi, pendant le repas, nous avons tous quatre été pris du mal de mer; le plus malade a été le Frère Henri-Frédéric.
Dimanche 17. – Nous allons tous mieux. Faute de prêtre à bord, nous n'avons pas pu avoir de messe. Nous faisons nos exercices de piété sur le pont. Les voyageurs avec lesquels nous sommes se montrent jusqu'ici très convenables. Le soir, nous apercevons les feux des côtes de France et d'Angleterre, des ports de Calais et de Douvres. Notre passage est signalé à Douvres au moyen de la lumière électrique ; c'est quelque chose de féerique.
Lundi. – Temps magnifique. Nous longeons les côtes de Normandie et de Bretagne. Nous récitons un Souvenez-vous pour les personnes aimées que nous laissons en France. Le vent souffle à tout renverser.
Mardi. – Magnifique lever de soleil. Le ciel est serein, mais la mer est toujours bien mouvementée. Les dauphins nous amusent avec leurs sauts, qui ressemblent à des exercices gymnastiques. Il y en a quatre près du bateau qui gambadent avec tant d'ensemble qu'on les prendrait pour quatre soldats manœuvrant sous les ordres d'un caporal. – Pour me distraire un peu, après avoir étudié les langues, ce qui est très monotone, je joue à cache-cache avec un petit garçon de 6 à 7 ans qui se plait singulièrement dans notre société. Il y a parmi nous un personnage beaucoup moins aimable que cet enfant : c'est un gourmand de première classe. Il mange, mange, mange, ne parle que de manger… un vrai gargantua.
Mercredi. – Beau lever de soleil, température bien adoucie. Nous arrivons sur les côtes d'Espagne. Personne de nous n'est ennuyé; on ne peut qu'être content et heureux lorsqu'on fait la volonté de Dieu. Deux choses cependant nous manquent et nous en sentons vivement la privation: c'est la sainte Messe et la sainte Communion. Nous espérons pourtant n'en pas ressentir trop de dommage, grâce aux bonnes prières que l'on fait pour nous.
Au dire des passagers qui ont déjà fait plusieurs fois la traversée, jamais ils n'ont eu une aussi bonne mer. Aujourd'hui pendant le dîner l'un d'eux disait : « C'est extraordinaire que nous ayons une si bonne traversée;il faut qu'il y ait quelqu'un parmi nous, qui attire les bénédictions du Ciel en notre faveur » ; et plusieurs tournaient leurs regards de notre côté. Qu'en dites-vous, Cher Frère Assistant ? Ne serait-ce pas assez pour pousser le diable à nous souffler dans le tuyau de l'oreille que nous sommes de petits saints ? Mais nous savons que c'est un grand menteur, et nous nous gardons bien de l'écouter.
Nous nous recommandons à vos bonnes prières, et nous sommes avec un profond respect, etc.
F. Paulinien.
CHINE.
Loin d'arrêter l'évangélisation de la Chine, les dernières persécutions n'ont fait que donner un nouvel élan au zèle des Missionnaires. Sur tous les points de cet immense empire, ceux-ci s'occupent avec ardeur de restaurer les oeuvres détruites ou d'en fonder d'autres. Aussi les demandes pour de nouvelles écoles nous arrivent-elles fréquentes et pressantes. C'est avec peine que nous nous voyons dans l'impossibilité d'y satisfaire ; car il s'agit d'un bien immense à faire parmi ces populations tant païennes que chrétiennes.
Parmi ces demandes, il en est une qui nous a été faite au nom du vice-roi d'une des plus grandes et des plus riches provinces de la Chine, et une des plus favorisées pour le nombre des chrétiens.
Celles de nos écoles qui existaient au moment de la guerre, ou se relèvent de leurs ruines, ou ont reçu un accroissement d'élèves. Telles sont celles de Pékin, de Tientsin, de Shang-Haï (celle-ci compte 450 élèves) toutes réclament des aides.
Dans le courant de la présente année, nous avons fondé en Chine trois nouveaux établissements, dont deux sur la demande et aux frais du Gouvernement français, savoir : Canton, dans la province de Kouang-tong, et Nan-nin, dans la province de Kouang-Si. La troisième fondation est celle de Soei-fou dans la province de Sutchuen.
Relativement à cette dernière, le C. F. François-Noël, directeur, nous a écrit, à la date du 7 octobre 1901, une lettre dont je vous donne ici quelques extraits[3]:
Dans le courant de septembre, nous dit-il, les élèves sont venus se faire inscrire, et le 30, ils nous ont été présentés officiellement. Non contents de nous présenter leurs solennelles salutations, la plupart ont eu à cœur de nous payer leur bienvenue par de petits présents consistant en gâteaux, poules, canards, fruits de la saison, sapèques même.
Dans nos trois classes, que nous avons ouvertes le 1ier octobre, nous avons présentement 61 élèves, dont une dizaine de chrétiens seulement. Tous payent une rétribution mensuelle d'un taël (3 fr. 50), ils sont très désireux d'apprendre, et le plus vite possible, les langues européennes qui leur procureront de bonnes places.
Nous prévoyons dès maintenant l'importance qu'aura dans l'avenir l'école de Soei-fou, située au cœur d'une province qui va être sillonnée par des chemins de fer. Le plus important est celui que construisent nos amis les Français, et qui, partant du Tonkin et passant par Haiphong, Hanoï, Lao-Kay, etc., aboutira à Soei-fou. Les travaux avancent rapidement. Cette ligne sera pour notre école ce que fut la ligne de Pékin–Han–Kéou pour le collège du Nant'ang. Dans un avenir peut-être peu éloigné, nous pourrons avoir ici jusqu'à huit classes.
Le R. P. de Guébriant, administrateur du Vicariat, en l'absence de Mgr Chatagnon, malade, se montre très satisfait du nombre d'élèves que nous avons. Mais notre local ne pouvant recevoir que 75 élèves, il faudra penser à bâtir bientôt.
Le P. de Guébriant qui nous a pris sous sa protection et se montre prodigue de bontés envers nous, pense que l'école fera un grand bien, non seulement dans la ville, mais dans le Vicariat. Parmi nos élèves, il y en a qui viennent de localités éloignées d'ici de plus de deux jours de marche.
L'influence française est grande au Su-tchuen, grâce aux Pères des Missions étrangères. Nous comptons avoir la visite d'un bateau français plusieurs fois par an. Tchong-King, où l'on nous demande instamment des Frères est port ouvert aux Européens ; Soei-fou sera sous peu ouvert aussi. Il y a deux consuls français au Su-tchuen : l'un à Tchong-King, l'autre à Tcheung-Tou.
Nous allons tous bien, surtout depuis la cessation des grandes chaleurs; nous avions néanmoins hier 2711 dans notre salle d'étude, l'appartement le plus frais de la maison. Nous semons encore des radis, choux, salades, etc. Je me propose encore de planter des pommes de terre que nous récolterons au mois de janvier, si l'essai réussit. C'est le monde renversé…
Priez Dieu pour nous, afin que nous restions d'esprit et de cœur catholiques, Français et religieux Maristes…
V. J. M. J.
Canton – Ecole Pichon – 17 septembre 1901.
Mon Très Révérend Frère Supérieur,
Voilà déjà un mois que j'ai quitté Shang-Haï. Arrivé à Hongkong, le 13 août j'en partais le 15 au matin, pour arriver à Canton l'après-midi du même jour, sous les auspices de la bonne Mère. Une chaise à porteurs m'attendait au débarcadère et me transporta à l'Evêché, où Mgr Mérel me reçut à bras ouverts. Je sollicitai sa bénédiction qu'il me donna affectueusement. Il me témoigna la satisfaction qu'il éprouvait de recevoir les Frères ; et comme l'école est loin de l'église, il daigna nous promettre un aumônier qui résiderait chez nous.
Le consul, M. Hardouin, est un homme actif et énergique, à qui la colonie européenne de Canton doit d'avoir échappé, l'an dernier, aux massacres des Boxeurs. Ils se préparaient à jouer dans cette ville le deuxième acte du drame dont le premier acte avait été exécuté à Pékin, lorsque, par son énergie et l'habileté de ses mesures, il fit échouer leur projet. C'est lui qui a tout fait pour la fondation, l'érection et l'installation de l'école.
Le terrain, mis à notre disposition, avec la maison, est d'une belle étendue ; il a la forme d'un trapèze dont le petit côté a 110 mètres environ. Il est en grande partie couvert de haute et basse futaie, d'arbres séculaires, de broussailles qui lui donnent l'aspect d'une forêt vierge, aspect qui, du reste, contraste agréablement avec cette populeuse ville de Canton, aux rues si étroites et si peu champêtres. Le tout faisait partie de l'ancienne résidence du vice-roi et fut cédé à la France à la suite de la guerre de 1884.
Occuper dans cette grande cité une propriété naguère en possession d'un vice-roi de l'immense empire chinois, quel sujet de réflexions pour des Petits Frères de Marie, partis de l'humble et étroit vallon de l'Hermitage !
Mais voici le revers de la médaille : il faudra du monde et de l'argent pour défricher et entretenir la propriété, et nous n'aurons suffisamment ni l'un ni l'autre, bien que nous ayons cinq employés à notre service : un interprète, un compradore (factotum), un cuisinier, un valet de chambre et un porteur d'eau. Il ne faut donc pas vous attendre, mon Très Révérend Frère, à voir notre clos tenu princièrement quand vous viendrez nous faire une visite.
Nous avons ouvert l'école le 1ierde la 8e lune (13 septembre). La veille, nous avions 21 inscriptions, ce dont M. le Consul était très satisfait ; le lendemain je lui annonçai que l'ouverture s'était faite avec 39 élèves: il trouvait cela magnifique ; mais sa surprise et son contentement ont redoublé lorsque, aujourd'hui, 17 septembre, je lui ai fait savoir que nous avions 61 élèves présents. Or, l'école n'est construite que pour 72 élèves[4]…
Veuillez agréer, etc.
F. Marie-Julien.
PÉKIN.
Par une lettre en date du 18 juin 1901, le C. F. Louis-Michel nous annonçait avec bonheur que la statue du Sacré-Cœur qui se trouvait sur un piédestal dans la cour de Cha-la-Eul, et que les Boxeursavaient jetée dans un puits, avait été, retrouvée après des fouilles faites pendant quatre jours par des ouvriers chinois. Ce fut pour les Frères et leurs élèves le sujet d'une grande joie, et l'occasion d'une pieuse cérémonie de réparation qui s'accomplit solennellement en la fête du Sacré-Cœur, jour auquel 25 enfants de l'école faisaient leur première communion. La statue du Sacré-Cœur, restaurée, a donc sa place sur un beau piédestal dans la cour de leur nouvelle école.
« Les Boxeurs ne nous avaient absolument rien laissé, écrit le C. F. Louis-Michel, et voilà qu'un an après le grand bouleversement dont ils furent les auteurs, il ne nous manque presque plus rien, excepté une maison pour remplacer celle peu commode que nous occupons provisoirement.
« Le règlement des indemnités, ajoute-t-il, pour les missionnaires et les chrétiens, touche à sa fin. Mgr Jarlin, chargé de cette affaire, reçoit tous les jours cinq ou six mandarins. Ils font le plus grand éloge de la manière juste et équitable dont il traite cette question avec eux. »
Le 3 août 1901, le même Frère nous écrit qu'il regarde comme une faveur du Sacré-Cœur l'acquisition qui vient d'être faite par Mgr Favier, de la propriété où est installée la nouvelle école, propriété qui a une étendue de plus de cinq mille mètres carrés, située à proximité du Pétang.
Par une autre lettre du 3 septembre, il nous annonce qu'une nouvelle année scolaire vient de commencer avec 110 élèves, dont 20 païens, parmi lesquels cinq sont bacheliers et deux licenciés. 70 de ces élèves sont âgés de 15 à 25 ans ; ils sont très raisonnables et ne demandent qu'à travailler.
La même lettre annonce que les Frères sont en possession d'un nouveau terrain contigu à celui dont il est parlé ci-dessus, de sorte qu'ils ont à leur disposition unepropriété qui a près de douze mille mètres carrés.
Enfin, une quatrième lettre du 27 octobre nous annonce que l'école, toujours installée dans un local provisoire, comptait alors 155 élèves. Le C. F. Louis-Michel exprime dans cette lettre le plus vif désir de voir cesser ce provisoire qui met les Frères dans une gêne extrême et oblige à restreindre le nombre des élèves. En même temps il dit qu'il espère voir bientôt commencer une construction assez spacieuse pour répondre aux besoins des élèves et des Frères. Il fait des vœux pour la fondation d'un pensionnat dont le programme donnerait une large place à l'enseignement des langues.
Il exprime sa satisfaction relativement à l'esprit de famille et de dévouement qui règne parmi les Frères, et il est heureux de faire savoir que la dévotion au Sacré-Cœur est en honneur dans la maison, et que plusieurs élèves font la communion du premier vendredi.
Il ne reste plus de l'orphelinat de Cha-la-Eul que le jardin loué à des chrétiens qui y récoltent du blé. Les Frères y conservent un souvenir qui leur est cher dans les tombes des chers et regrettés Frères Marie-Candide, Elie-François, Fidélis-Bernardo et Jules-Raphaël.
Un grand mandarin de Toung-tchoo demande deux Frères pour faire l'éducation de ses fils. Un autre mandarin a manifesté l'intention de confier son filsaux Frères qui dirigent l'école de Pékin.
AFRIQUE DU SUD. – TRANSVAAL.
Malgré la guerre dont l'Afrique du Sud est le théâtre, nos écoles de cette région n'ont subi jusqu'ici aucune interruption. Nos Frères n'ont pas été inquiétés ; ceux de Johannesburg seuls ont vu leur école fortement éprouvée en ce que le nombre d'élèves est descendu de 700 à 250.
Le C. F. John, Assistant, s'est embarqué à Londres, le 9 novembre, pour le Cap, avec le dessein et l'espoir de réunir à Uitenhage les Frères des établissements de l'Afrique du Sud, pour leur procurer, avec ses consolations et ses encouragements, le précieux bienfait d'une retraite.
VISITES A LA MAISON-MÈRE
1° Le 7 novembre 1901, plusieurs des respectables membres du Tribunal chargé de l'instruction de la Cause du Vénérable Marcellin Champagnat, ont honoré de leur visite la Communauté de la Maison-Mère, donnant ainsi un témoignage de l'intérêt qu'ils portent à notre Institut et à la Cause qui leur est confiée. Ils nous ont demandé la continuation de nos prières pour l'heureuse issue de la mission dont ils sont chargés.
2° Le 12 du même mois, la Maison-Mère a été favorisée de la visite de Mgr Bonnefoy, archevêque d'Aix. Sa Grandeur, en nous assurant de sa bienveillance à l'égard des Petits Frères de Marie, nous a félicités du beau nom que nous portons, et, dans une h heureuse improvisation, nous a parlé des devoirs qu'il nous impose, et du puissant secours que nous trouvons en Marie, notre modèle et notre protectrice, dans l'œuvre de la perfection à laquelle nous devons aspirer.
3° Le dimanche, 15 décembre, la Communauté a été tout heureuse de posséder au milieu d'elle Mgr Hudrizier, évêque des Seychelles, qui venait d'administrer la sacrement de Confirmation et de présider une prise d'habità notre maison de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Sa Grandeur a bien voulu officier pontificalement dans notre chapelle à la grand'messe, aux vêpres et au salut, et, dans une causerie familière d'abord, puis dans une allocution à la chapelle, nous adresser de ces bonnes paroles réconfortantes, bien propres à nous porter à servir Dieu dans la confiance et la sainte joie, selon que l'Eglise nous y invitait dans ses offices de ce jour, et à adopter pour nous cette devise: « Je ne crains que Dieu ! »
La Communauté a entendu avec plaisir le bon témoignage rendu par Monseigneur des douze Frères qui dirigent avec zèle et succès, dans sa ville épiscopale de Port-Victoria, deux écoles -l'une dite école paroissiale – fréquentées par plus de 400 élèves.
NOMINATIONS
Depuis la dernière circulaire du 18 mai 1901.
Ont été nommés :
1° Le C. F. Urban, Provincial du District d'Australie (Province des Iles);
2° Le C. F. Bénédict, Provincial de la Province des Iles, pour le District comprenant l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande;
3° Le C. F. Stanislaus, Visiteur du District d'Australie ;
4° Le C. F. Constancien, Visiteur de la Province de Saint-Paul-Trois-Châteaux ;
5° Le C. F. Clarence, Visiteur de la Province d'Aubenas;
6° Le C. F. Adorator, Visiteur des deux Districts du Brésil;
7° Le C. F. Félix-Eugène, Visiteur de l'Amérique du Nord;
8° Le C. F. Marie-Abraham, Maître des novices de Notre-Dame de l'Hermitage, en remplacement du C. F. Ignatius, obligé de cesser ses fonctions pour raison de santé.
ÉTABLISSEMENTS FONDÉS EN 1901.
1° En Turquie. – Constantinople(Collège des Mékitaristes); Andrinople (pour Bulgares catholiques) ; Mételin, près de Smyrne ; Adana, par Mersina.
2°En Chine. – Nannin, province de Kouang-si; Canton, province de Kouantong; Soei-fou, province de Su-tchuen.
3° Au Canada. – Chicoutimi: La Malbaie.
4°Au Mexique. – Mexico; Mérida (collège S. Ildefonso); Mérida (collège S. Juan).
5°Au Brésil. – PortoAlegre, San Leopoldo.
6° En Belgique. – Saint–Servais(Namur); Bonsecours (Péruwelz).
7°En Irlande. – Swinford.
8°En Algérie. – Oran.
9° En France. – Saint–Priest – La Prugne (Loire); Amboise (Indre-et-Loire); Clamecy (Nièvre); Fumel (Lot-et-Garonne).
Total : 22.
Etablissements supprimés: Champeix (Puy-de-Dôme) et Ars-en-Ré (Charente- Inférieure).
DÉPART DES FRÈRES POUR LES MISSIONS EN 1901.
1. 7 février. – De Marseille pour Constantinople Frères Paulin-Régis, Marie-Augustin, Emile-Régis.
2. 8 lévrier. – De Bordeaux pour le Brésil; Frères Pierre-Cassien, Marie-Chérubin, Marius-Adrien, Joseph-Lambert, Eustache, accompagnés du C. F. Anaclétus, Provincial de l'Ouest.
3. 23 février. – Du Havre pour New-York: Frères Joseph-Arthur, Désiré-Stanislas.
4. 10 mars. – De Marseille pour la Chine: Frères Louis-Rupert, Louis-Théodat, Paul-Constant, Jean-Philomène, Daniel-Antonin, Subran.
Pour Aden, Frère Pierre-Léon, en remplacement du C. F. Jules-Raphaël, envoyé en Chine.
5. 2 mai. – De Marseille pour Constantinople: Frères Marie-Aymond, Paul-Stanislas, Ostien.
6. 29 juin. – Du Havre pour New-York: Frère Auguste-Victor.
7. 27 juillet. – Du Havre pour New-York: Frères Natal, Charles-Etienne, Paul-Henri.
8. 11 août. – De Barcelone pour le Mexique : Frères Amatus, Ricardo, Rodrigo, Filiberto, Honesto, Trifon, Acacio, Solemnis, Jérémie, Illidius, Bertulle.
9. 22 août. – De Marseille pour Constantinople Frères Marie-Berchmans, Joachim, Joseph-Laurence, Joseph-Amabilis, Louis-Arthur, Louis-Frédéric, Louis-Ildefonse, Marie-Liguori, Marc.
10. 5 septembre. – De Marseille pour Beyrouth Frère Joseph-Archangélus, accompagné des Frères Avit et Florinus qui retournaient à leurs postes.
11. 19 septembre. – De Marseille pour Beyrouth Frères Gerbaud, Viator, accompagnés du C. F. Marie-Athanase qui retournait en Syrie.
12. 24 septembre. – De Marseille pour le Brésil: Frères Adorator, Joseph-Damase, Marie-Chrysophore.
13. 25 septembre. – De Marseille pour les Seychelles Frères Malachy et Justien.
14. 26 septembre. – De Barcelone pour le Mexique : Frères Clémencius, Respice, Gens et Méry.
15. 17 octobre. – De Marseille pour Samsoun : F. Marie-Fabien, avec F. Marie-Bajule qui retournait à Adana.
16. 19 octobre. – Du Havre pour New-York: FF. Gémel, Paul-Acyndinus, Henri-Noël, Marie-Dorothée.
17. 19 octobre. – Du Havre pour New-York: F. Philoménès.
18. 3 novembre. – De Marseille pour la Chine: FF. Jean-Maurice, Paul-Xavier, Joseph-Stanislas, Nicet.
19. 9 novembre. – Pour le Cap : F. Julien-Henri, accompagné par le C. F. John, Assistant.
20. 15 novembre. – De Hambourg pour Rio Grande do Sul (Brésil): FF. Paulinien, Henri-François, Marie-Laurentin, Henri-Frédéric.
21. 12 décembre. – De Marseille pour Constantinople: F. Joseph-Rodriguez, accompagné du C. F. Marie-Raphaël qui retournait à Samsoun.
22. 14 décembre. – Du Havre pour New-York FF. Paul-Gaspard, Joseph-Adjutor, Anthelbert.
23. 31 décembre. – Doivent s'embarquer au Havre pour le Brésil: FF. Paolo, Thomas de Villeneuve, Marie-Druon, Emygdius.
Total : 79.
AVIS DIVERS
1° Notices Biographiques. – Dix-sept notices imprimées sont réunies en Une brochure trop volumineuse pour être expédiée par la poste. On la trouvera dans les Procures provinciales.
Ces notices ayant été composées en vue d'instruire et d'édifier, les Frères sont invités à les lire de manière à répondre à ce but. Ils trouveront profit à se mettre en communication avec les âmes d'élite dont elles retracent les vertus, la magnanimité et la fidélité au service de -Dieu.
2° Listes Electorales. – Les Chers Frères Directeurs sont priés de veiller à ce que tous les Frères qui ont atteint l'âge de 21 ans et qui auront six mois de résidence au 31 mars prochain, soient inscrits sur la liste électorale ; et, à cette fin, de donner leur nom et prénoms à la mairie en janvier. (Voir article 14 de la loi municipale du 5 avril 1884).
3° Journal Pédagogique. – Nous recommandonsà nos Chers Frères Directeurs de prendre, de préférence, comme journal pédagogique, l'Ecole française, devenue la propriété de la librairie Emmanuel Vitte, notre éditeur.
On peut s'abonner soit à la Procure générale, soit à la Procure provinciale.
L'Ecole française annonce régulièrement la collection F. T. D. : nous avons donc intérêt à la favoriser de tout notre pouvoir.
4° Recueil d’accompagnements. – Le recueil d'accompagnements du choix de cantiques, in-4° de 400 pages est en vente dans nos Procures provinciales.
Broché 8 fr.
Relié 10 fr.
5° Comptabilité. – Les arrêtés de comptes mensuels et trimestriels envoyés à la Maison-Mère doivent être signés par le C. F. Directeur et par le C. F. Sous-Directeur ou le C. F. Econome.
Nous prions les CC. FF. Directeurs et Economes de veiller à ce que les livres soient tenus proprement, sans ratures ni surcharges. Les articles du brouillard ne doivent pas être résumés, mais transcrits textuellement au grand livre, par ordre de dates. Il faut mettre en tête le millésime, le mois et le quantième, et faire concorder les pages des recettes et des dépenses, alors même que les articles en recettes ne rempliraient pas la page. Aux dépenses pour voyages, il convient d'indiquer le nom du Frère et l'endroit où il se rend.
6° Cours d'histoire de France. – En suite des instructions officielles qui nous sont parvenues récemment, nous vous informons que nous mettons sous presse une nouvelle édition des cours élémentaire, moyen et supérieur d'Histoire de France.
Nos DÉFUNTS.
F. ENGLEMOND, Obéissant, décédé à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), le 7 mai 1901.
F. JOSEPH-MALACHIE, Profès, décédé à Pékin (Chine), le 16 mai 1901.
F. JOSEPH-THÉODORE, Profès, décédé à Saint-Genis-Laval (Rhône), le 19 mai 1901.
F. VITALIEN, Profès, décédé à Saint-Genis-Laval (Rhône), le 2 mai 1901.
PLAT Elie, Juvéniste, décédé à Serres (Hautes-Alpes), le 29 mai 1901.
F. CHARLES-RAPHAEL, Obéissant, décédé à Arlon (Luxembourg belge), le 14 juin 1901.
F. BENITO-JOSE, Novice, décédé à Villatuerta (Navarre), le 14 juin 1901.
F. EVARISTUS, Profès, décédé à Privas (Ardèche), le 26 juin 1901.
F. MARTIN E, Obéissant, décédé à La Bégude (Ardèche), le 14 juillet 1901.
F. MARIUS-ANSELME, Novice, décédé à Aubenas (Ardèche), le 14 juillet 1901.
F. MARIE-AMPHIEN, Profès, décédé à Lévis (Province de Québec), le 18 juillet 1901.
F. LOUIS-FULGENCE, Novice, décédé à Gelles (Pur de-Dôme), le 20 juillet 1901.
F. NEOPOLE, Profès, décédé à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), le 20 juillet 1901.
F. NIVARD, profès, décédé à Iberville (province de Québec), le 8 août 1901.
F. CHRYSOSTOME, Novice, décédé à Mérida (Mexique), le 8 août 1901.
F. MATHIAS, Obéissant, décédé à Bendigo (Australie), le 8 août 1901.
F. JOSEPH-ANTOINE, Profès, décédé à Varennes-sur-Allier (Allier), le 19 août 1901.
F. THÉOPHILUS, Profès, décédé à Saint-Genis-Laval (Rhône), le 24 août 1901.
F. CALLÉOPPE, Obéissant, décédé à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), le 30 août 1901.
BLANC Louis, Postulant, décédé à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), le 30 août 1901.
F. DOROTEO, Obéissant, décédé à Mérida (Mexique), le 23 septembre 1901.
F. HONORAT, Profès, décédé à Saint-Genis-Laval (Rhône), le 29 septembre 1901
F. ANGE, Profès, décédé à Annonay (Ardèche), le 3 octobre 1901.
F. JOSEPH-AMBROISE, Novice, décédé à Notre-Dame de l'Hermitage (Loire), le 6 octobre 1901.
F. AGGÉE, Novice, décédé à Sauzet (Drôme), le 18 octobre1910.
CHABANIS Léon, Postulant, décédé à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), le 25 octobre 1901.
F. NOVATUS, Profès, décédé à Saint-Genis-Laval (Rhône), le 27 octobre 1901.
F. MODESTE, Profès, décédé à Notre-Dame de l'Hermitage (Loire), le 31 octobre 1901.
F. XIMENES, Profès, décédé à Beaucamps (Nord), le 4 novembre 1901.
F. MARIE-FRUMENCE, Obéissant, décédé à Arfeuilles (Allier), le 8 novembre 1901.
F. AUTBERT, Profès, décédé à Valence (Espagne), le 14 novembre 1901.
F. DANIEL, Profès, décédé à Chagny (Saône-et-Loire), le Il décembre 1901.
En recommandant à vos prières tous nos chers Défunts, et spécialement ceux dont la liste précède, je ne saurais oublier de vous inviter à comprendre dans vos pieux suffrages et vos reconnaissants souvenirs, S. G., Mgr MOREAU, évêque de Saint-Hyacinthe (Canada), décédé en sa ville épiscopale le 24 mai 1901.
Ce saint Prélat est le premier des Evêques du Canada qui a accueilli nos Frères dans son diocèse, qui a béni et encouragé leurs débuts, et, depuis, n'a cessé de leur prodiguer des preuves de sa bienveillance, de favoriser leur développement, de s'intéresser à leurs œuvres et de se faire leur protecteur et leur bienfaiteur.
Mérite également nos pieux souvenirs M. Saint-Georges, curé de Saint-Athanase-d'Iberville (Canada), décédé récemment, un ami dévoué de notre Institut. C'est dans sa paroisse que nos Frères du Canada ont fondé leur premier établissement.
La présente circulaire sera lue en communauté, à l'heure ordinaire de la lecture spirituelle. Dans les maisons de noviciat et les communautés nombreuses, cette lecture se fera d'abord au réfectoire, puis à l'heure de la lecture spirituelle.
Recevez la nouvelle assurance du religieux attachement avec lequel je suis, en Jésus, Marie, Joseph,
Mes très Chers Frères,
Votre très dévoué Frère et serviteur,
F. Théophane.
——————————————–
[1] : Pour plus de détails sur la ville de Quibdo, voir la Circulaire du 24 mai 1898.
[2] : Les Pères Jésuites ont dans cette ville un Gymnase national où ils préparent aux examens universitaires. Ce collège, où il y a 300 élèves internes, est le premier du Brésil.
[3] : Précédemment, deux lettres écrites par le C. F. Louis-Eraste et le cher frère Léon nous avaient donné des détails sur le long voyage de 54 jours de Shang-Haï à Soei-fou, sur la maladie du C. F. François-Noël, sur les divers contretemps que tous trois avaient dû subir avant leur installation à Soei-fou : toutes épreuves qu’ils ont supportées courageusement et en vrais missionnaires.
[4] : Ce maximum est présentement dépassé : aussi faut-il une nouvelle classe et un nouveau Frère.